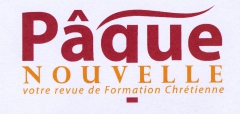Témoins:
Sur zenit.org, Anita Bourdin recueille les propos de Mgr Anatrella* :
Les enjeux anthropologiques du synode sur la famille

par Mgr Tony Anatrella
Le Synode sur la famille alterne entre un travail en Assemblées générales régulières et en divers groupes linguistiques. Il s’agit d’une reprise de plusieurs thèmes déjà abordés lors de la session extraordinaire du Synode 2014. Quelle première analyse peut-on en faire ?
« L’objectif est de parvenir à exposer ce que l’Église propose pour la réussite de la famille qui aujourd’hui est malmenée », explique Mgr Anatrella.
Il avertit aussi que « les enjeux sont anthropologiques et ne peuvent pas être recouverts de bonnes pensées pastorales » et que « la question, ce n’est pas l’accueil et l’accompagnement, qui sont inconditionnels, mais l’idéologie dans laquelle on veut faire entrer toutes les situations ».
Il rappelle que « ce n’est pas parce qu’un écart existe parfois entre l’enseignement du Magistère et les fidèles que l’enseignement est caduque ».
Monseigneur Tony Anatrella, riche de son expérience clinique et de sa connaissance des sciences humaines, répond aux questions de Zenit pour analyser les enjeux.
Voici le premier volet ce cet entretien. Nous publions le second demain, 13 octobre : Mgr Anatrella y évoque les divorcés-remariés, le motu proprio sur les causes de nullité, le rapport entre doctrine et pastorale, la crise de la foi.
Notez-vous une différence entre ce synode « ordinaire » 2015 et le synode « extraordinaire » de 2014 ?
Monseigneur Tony Anatrella - Tout d’abord l’ensemble des participants a été renouvelé, mises à part quelques exceptions comme la présence de certains présidents de Conférences épiscopales qui ont été élus par leurs pairs et des cardinaux de Curie. Ensuite la méthode puisque le travail en groupes linguistiques est plus important. La suppression du rapport intermédiaire qui, une fois remis aux journalistes, avait semé la confusion en 2014 ; d’autant plus qu’il contenait des formules qui n’avaient pas été exprimées par les Pères du Synode comme celles relatives à l’homosexualité et aux divorcés remariés. La deuxième mouture était plus proche de la réalité des débats même si des passages étaient encore ajoutés. C’est pourquoi une certaine méfiance s’est manifestée à l’égard du groupe actuel des rédacteurs. Les échanges en Assemblée générale et en groupes linguistiques reprennent de nombreux sujets qui avaient déjà été abordés l’an passé. Il y a une sorte de répétition et une impression de tourner en rond qui auraient pu être évitées. Mais c’est dans l’ordre des choses de revenir sur des questions récurrentes dans un groupe qui est nouvellement constitué. Enfin, comme lors de la première session, des discussions riches et variées alimentent les débats, avec parfois des hors-sujets comme la suggestion du diaconat ouvert aux femmes ou la possibilité pour des laïcs d’intervenir lors de l’homélie, ce qui n’est pas dans leur rôle de baptisés.
N’a-t-on pas tendance à réduire les débats du synode à l’image de l’opposition politique entre « droite » et « gauche » ?
Monseigneur Tony Anatrella - Le débat n’est pas entre droite et gauche, anciens et modernes, rigoristes et laxistes. Ces clichés ne disent rien sur la façon d’aborder la problématique contemporaine du couple et la famille, mais aussi de la sexualité conjugale et de la complexité qu’il peut y avoir pour certains de l’inscrire dans une dimension relationnelle là où les modèles sociaux incitent à s’exprimer de façon pulsionnelle. Il faudrait ajouter à ce constat, l’irruption dans l’univers familial de l’usage des écrans de toutes sortes qui tentent à modifier la relation à soi et aux autres. J’ai vu récemment dans un restaurant une famille avec deux adolescents. Les uns et les autres ont passé leur temps pendant le déjeuner à regarder leur tablette ou leur téléphone cellulaire sans se parler. Tel est l’univers dans lequel nous sommes.
Malheureusement la façon dont certains médias présentent le travail synodal, même dans la presse chrétienne, en s’inspirant des catégories socio-politiques qui ne sont pas adaptées ici, fausse la compréhension du Synode sur la famille. Parler de progressistes et de conservateurs, de libéraux et d’angoissés, d’oppositions et de conflits, nous oblige à croire que nous sommes à l’Assemblée nationale alors qu’il ne s’agit pas de cela. Le Pape François l’a dit très clairement à l’adresse de tous et en direction des médias : nous ne sommes ni dans un parlement ni dans un parti politique. Bien entendu il y a des approches différentes selon les expériences pastorales des uns et des autres, de leurs motivations intellectuelles et de leur contexte culturel. Mais l’objectif est de parvenir à exposer ce que l’Église propose pour la réussite de la famille qui aujourd’hui est malmenée, abîmée et défigurée par des expériences malheureuses et surtout des lois civiles qui la déstructurent. Seule, l’Église semble avoir le sens de la famille à promouvoir à partir de l’engagement d’un homme et d’une femme dans le mariage qui est la preuve de leur authentique union. Bien des choses sont à rependre comme par exemple souligner que c’est leur lien conjugal qui fait la famille et non pas la venue des enfants qui eux naissent grâce à l’alliance de leurs parents. Il ne faut pas inverser les choses comme on le fait actuellement. La loi civile porte une lourde responsabilité en déplaçant et en dénaturant les réalités.
Le Synode porte sur La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain : quelles sont les questions les plus abordées ?
Monseigneur Tony Anatrella - Elles sont nombreuses. Les Pères du Synode ont évoqué à juste raison, la vision trop européenne de l’Instrumentum laboris des problèmes rencontrés par des familles. La question des divorcés remariés n’est pas la plus importante, et encore moins l’homosexualité. Par exemple pour les énumérer, le problème du déni de l’engagement dans le mariage de nombreux jeunes. Mais aussi des courants idéologiques qui rendent difficile la relation entre les hommes et les femmes. La dévalorisation du mariage favorisée par des lois civiles qui transforment le mariage en contrat de location à durée déterminée. Le Pape utilise la notion de « civilisation du jetable » pour souligner ce phénomène.
En Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, mais aussi en Occident, les questions les plus inquiétantes sont liées au concubinage adolescent qui se prolonge avant d’aboutir à des séparations. Une forme d’immaturité affective perdure sans que des personnes ne sachent pas faire couple et franchir les étapes de son évolution. La polygamie de fait ou indirecte à la suite de séparations multiples, les divorces des personnes mariées au bout de quelques années, les femmes abandonnées avec leurs enfants, des filles en Asie enlevées dans certains pays en direction de la Chine qui est en manque de femmes à cause d’une politique de l’enfant unique et surtout pas de filles qui sont avortées ou négligées lors de la naissance qui se paie aujourd’hui en termes de déficit du taux de natalité. Les violences conjugales et les maltraitances infligées aux femmes. Les agressions sexuelles de toutes sortes contre elles et contre des mineures. Les familles dispersées et parfois brisées par les guerres comme au Moyen-Orient. Un véritable drame humanitaire et un génocide des chrétiens, parmi d’autres personnes, est à l’œuvre dans ces pays. La véritable solution consiste à tout faire pour arrêter la guerre et ce massacre humain et culturel. Les familles sont également touchées par le chômage, la perte du sens de l’autorité à l’égard des enfants, le dialogue intergénérationnel et l’accompagnement des personnes âgées qui, dans certaines sociétés sont laissées à leur solitude. Enfin une autre question est souvent abordée est celle des effets des concepts du genre dans sa version Queer, celle qui nie la différence sexuelle au bénéfice d’une forme d’égalité entre tous les types de sexualité et qui est relayée par le mouvement LGBT. Un phénomène particulièrement grave puisqu’il prend des tournures politiques à travers des lois civiles pour imposer ce modèle à l’ensemble de la société à travers « le mariage pour tous » ou encore une visibilité plus importante de cette indifférenciation sexuelle. Ainsi des agences Onusiennes et des entreprises comme des banques (la BNP en France), des chaînes de télévision (TF1 en France) signent des partenariats avec le lobby LGBT pour assurer leur visibilité au nom de la « tolérance ». Ce sont des groupes minoritaires dominants qui prennent progressivement le pouvoir politique sur la société pour imposer un type de sexualité qui ne participe aucunement au sens du bien commun.
Des questions redoutables : que peuvent dire et faire les évêques pour y répondre ?
Monseigneur Tony Anatrella - Il faut s’armer d’intelligence et ne pas rester dans les bons sentiments et les beaux discours spirituels désincarnés qui coulent comme de l’eau sur de la paraffine. Certains disent ou conseillent aux Pères de changer le discours, de modifier le langage pour se montrer accueillant et compréhensif à l’égard du monde. Selon la mode actuelle, il faut « positiver » en fonction des principes de la méthode Coué et trouver des « mots nouveaux ». Il faut bien considérer que ce sont les problèmes du couple qui fragilisent la famille et la rendent incertaine, ce n’est pas l’inverse. Le diagnostic doit être ajusté pour réfléchir aux hésitations, aux incertitudes et au manque de confiance en soi qui se manifestent dans la crise existentielle contemporaine.
Autrement dit, dans une sorte d’euphorie pour échapper aux malheurs du monde actuel, il faudrait nécessairement saisir les éléments positifs de toutes les situations problématiques quand, en plus, elles ne sont pas dramatiques. Il n’y a pas forcément à chercher des éléments positifs dans des situations qui ne le sont pas. Certains d’ailleurs se demandent comment ils peuvent s’en dégager. Il convient surtout d’accueillir et d’accompagner les personnes tout en évaluant leurs capacités à rebondir. Sinon le slogan actuel du « soyez positifs » est à l’image des textes des chansons populaires interprétés en France entre les deux grandes guerres qui se voulaient optimistes et drôles alors que les ingrédients des conflits se mettaient en place. Le seul qui fut lucide et clairvoyant avant la guerre de 1914, fut Benoît XV qui ne fut pas entendu ; pire même on le ridiculisa. Pourtant, il était parmi les seuls à avoir raison et à prévoir que le conflit engagé une première fois se répéterait par la suite. Il ne suffit donc pas de dire des évidences puisque le monde a changé, il faut trouver des mots nouveaux : ce nominalisme (cf. Guillaume d’Ockham : lorsque le mot construit uniquement ce que l’observateur constate et seul le particulier existe en s’inspirant principalement de l’individuel) remis au goût du jour, veut dire que, pour l’homme, il n’existe que ce qui se voit et peut ainsi nommer. Les Pères, à moins d’être aveugles, ne peuvent pas entrer dans ces perspectives alors que la conception actuelle et partielle de la sexualité, du couple et de la famille, basée sur la précarité du multi-partenariat successif, sur les concepts Queer du genre et ceux des orientations sexuelles, en modifient profondément l’organisation. Les enjeux sont anthropologiques et ne peuvent pas être recouverts de bonnes pensées pastorales. Des mouvements de laïcs au sein même de l’Église font un travail de réflexion considérable et ne sont pas toujours compris, entendus et accompagnés. Une jeune génération d’intellectuels se lève ainsi dans le monde et joue un rôle « d’éveilleurs » des consciences. Ils sont en train d’exercer un véritable « magistère » de référence pour de nombreux chrétiens dans la fidélité à l’enseignement de l’Église. Il serait dommage que les pasteurs les ignorent.
On a vu apparaître ces dernières années des « mots nouveaux », entrés dans le langage courant : doit-on s’en inspirer ?
Monseigneur Tony Anatrella - Certainement pas car accepter ce néo-langage est une façon de donner implicitement son adhésion aux idées dont il est porteur. Sans autre discernement, nous risquons d’entrer dans la problématique soutenue par certains sociologues, notamment en matière familiale, qui affirment que puisque telle ou telle situation existe, il convient de la désigner à travers un néo-langage et de la légitimer. Nous sommes toujours dans le « nominalisme » : seul le particulier (l’individuel) compte au détriment du général (bien commun). C’est dans ce sens, par certains aspects, que va également l’idéologie Care (soin de l’autre) aux États-Unis qui séduit quelques chrétiens qui y voient l’illustration de la parabole du bon samaritain (Luc 10, 25-37). Dans ce néo-langage, on parlera ainsi de la parentalité au lieu de la parenté, ce qui n’est la même chose, de famille recomposée alors que l’enfant n’a pas de multiples parents ou encore de famille homoparentale qui est une cellule enfermante sans altérité et de ce fait inféconde. Toutes ces cellules affectives ont parfois leur intérêt sentimental pour ceux qui la composent, mais sommes-nous vraiment dans le cadre de la famille ?
On demande donc à l’Église de changer son approche et son discours pour se couler dans ce que l’on appelle, à tort, de nouveaux modèles familiaux. Ils ne sont que des conduites individuelles érigées en catégories de normes existentielles. Tel n’est pas le sens de la famille soutenu par l’Église, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’aura pas la préoccupation de ces diverses situations auprès desquelles de nombreux agents pastoraux travaillent. Les paroisses sont très impliquées dans l’accueil et le soutien à toutes ces personnes. La question ce n’est pas l’accueil et l’accompagnement qui sont inconditionnels, mais l’idéologie dans laquelle on veut faire entrer toutes ces situations. Il y a ainsi des idées qui rendent malades les personnes et affaiblissent le cadre porteur de la société. C’est pourquoi, je reprends la formule de Camus quand il dit : « Mal nommer les choses, ajoute aux malheurs du monde ».
Certains commentateurs opposent Christ qui prêche « l’amour » et les règles ecclésiales qui seraient un « joug »?
Monseigneur Tony Anatrella - Elles sont pourtant libératrices puisqu’elles s’inspirent de l’Évangile. Dans notre monde narcissique, ces commentaires ignorent souvent que les paroles du Christ ne viennent pas conforter ce que chacun veut entendre à l’image de la complaisance politique. Elles nous disent Dieu et de ce fait nous interrogent à travers nos modes de vie qui nous permettent ou pas de le rejoindre.
Vous croyez que le Christ a parlé et agi sans nommer les choses ? Quand on lit et que l’on médite l’Évangile, les paroles du Christ vont droit au but et sont souvent source de conflits. Le Christ et ses contemporains, l’Église et la société sont et seront toujours dans une sorte de combat spirituel à l’image de la lutte de Jacob avec l’ange (Genèse 32). L’évangile selon saint Jean est typique de ce constat. Il faut que l’Église soit elle-même et dise ce qu’elle a à dire sans se calquer sur les réflexes mondains et politiques actuels. Cette recherche d’un « nouveau » langage est un faux problème. Elle est simplement l’expression d’un manque de réflexion philosophique et d’une carence de connaissances en anthropologie psychologique. Jusqu’à présent la théologie était basée sur la rationalité philosophique, mais depuis que l’on s’inspire, entre autres, de concepts flous d’une philosophie de la relation à l’autre et d’une spiritualité qui ne s’enracine pas assez dans l’incarnation de humain, elle risque d’être, dans certains cas, un passe-partout pour toutes les situations et faite d’exhortations généreuses qui devraient flatter le désir humain. Il n’est pas étonnant que bon nombre de personnes (clercs et laïcs) manquent de bases rationnelles pour affronter tous ces défis intellectuels. Ce n’est donc pas le moment d’abandonner nos études et nos livres pour les bons sentiments ! À moins que l’on veuille rester dans l’émotion et dans le besoin de reconnaissance qui fait que, sans le réaliser, on perd la distance en privilégiant une relation pastorale fusionnelle et une morale de situation. Faut-il donner raison au père du mensonge qui est d’autant plus présent que la grâce surabonde lors d’un Synode ?
N’oublions pas que ce sont les idées qui, entre autres, mènent le monde. Or depuis quelques années, il faut bien le reconnaître, nombre de clercs et d’agents pastoraux (certes pas tous) ont déserté les fonctions de l’intelligence en matière d’évangélisation. Il existe un anti-intellectualisme qui est dangereux pour la réflexion et la conscience chrétienne qui sont fondés sur l’étude et l’adhésion à la parole de Dieu pour vivre de la foi au Christ. Il suffit d’observer ce qui a été parfois enseigné sur les questions familiales ces dernières années au catéchisme aux enfants et le contenu des enseignements donnés aux chrétiens de base, pour en constater le résultat : un relatif effondrement de la réflexion et de la pensée chrétienne. Il n’est pas étonnant d’avoir assisté à la fermeture de maisons d’éditions et des librairies de livres religieux, et de voir dans quel état sont celles qui tentent actuellement de résister.
La formation intellectuelle des catholiques est une vraie question ?
Monseigneur Tony Anatrella - Sans aucun doute. Déjà de nombreuses initiatives sont prises à ce sujet dans plusieurs diocèses. La dernière Rencontre mondiale des familles à Philadelphie comme les JMJ à Rio de Janeiro (2013) avec le Pape François ont été marquées par de très nombreux enseignements qui enthousiasment les participants, et en particulier les jeunes. En France, le mouvement Even basé sur des enseignements à partir de la parole de Dieu pour les 18-30 remporte un beau succès.
Autrement dit, face à toutes ces questions que soulèvent les Pères du Synode et qui impliquent des enjeux décisifs, on ne peut pas se contenter d’accompagner en faisant de beaux sourires pastoraux : il faut disposer des outils intellectuels pour les affronter sérieusement. Les questions sont aussi graves que pouvait l’être l’arianisme (325-502) qui a changé la représentation de Dieu et de l’homme pendant des siècles laissant Rome seule et recluse jusqu’à Clovis. Des idéologies sont encore présentes avec le marxisme qui asservit les esprits et le libéralisme qui se veut sans normes, lamine tout. Elles font de l’homme pour l’une une production sociale, et pour l’autre un pion ou un consommateur. Il n’a pas d’autonomie propre et d’intériorité psychique, si ce n’est de l’abandonner à l’individualisme. Celui-ci est d’ailleurs une sorte de massification des personnes qui leur fait croire qu’elles sont libres alors qu’elles sont conditionnées par les messages médiatiques et déterminées par des idéologies libertaires. Dans ce contexte d’extra-détermination qui est vraiment autonome ? Des idées qui pèsent sur le sens de la famille ainsi maltraitée.
L’Église doit avoir un rôle prophétique sur le sens de la famille ?
Monseigneur Tony Anatrella - Très certainement et c’est sans doute pour cela que certains Pères ont dit qu’il était temps d’aborder les vrais problèmes de la famille plutôt que d’en rester aux injonctions médiatiques sur les divorcés-remariés et l’homosexualité. Le Pape saint Jean-Paul II avait déjà donné une forte impulsion avec son exhortation apostoliqueFamiliaris Consortio (1981). Elle est toujours d’une grande actualité puisque le même constat avait été fait à l’époque et des indications pastorales avaient été données. Elles sont également très pertinentes pour agir. Les problèmes se sont amplifiés, mais nous sommes dans la même logique. Néanmoins qui a vraiment agi dans ce sens ? Il serait intéressant d’en exploiter les ressources. À n’en pas douter, le Pape François veut relancer cette dynamique en rouvrant tous les dossiers pour continuer le travail.
De la même façon, le Synode de 2014 avait insisté pour que soit davantage étudiée l’encyclique de Paul VI Humanae Vitae (1968) qui montre que la fécondité est au cœur de la vie conjugale et que la limitation des naissances est tout à fait légitime, mais pas n’importe comment. Il en va du respect de la dignité de notre humanité et encore davantage quand on crée des exceptions. Dans le temps, elles deviennent force de loi et entrainent une escalade : nous sommes passés de la négation de la conception des enfants à la négation de leur existence avec l’avortement. Il serait même un droit, un droit à nier le sens de l’autre que représente, entre autres, le petit d’homme. C’est pourquoi, les couples ne peuvent pas être simplement renvoyés à leur conscience personnelle indépendamment d’une norme objective en faisant confiance à leur propre discernement. Ce n’est pas parce qu’un écart existe parfois entre l’enseignement du Magistère et les fidèles que l’enseignement est caduque. L’apparition, comme on dit, de nouveaux modes de vie ne justifie en rien de les reconnaître et de leur conférer une valeur morale. Ce n’est pas en disant : « vous pouvez utiliser toutes les méthodes selon votre choix à condition de redoubler d’amour entre vous » que le problème est résolu ; il est plutôt escamoté.
Dans bien des cas, la sur-présence des sciences humaines dans la théologie morale, ne sert ni la psychologie, ni le discernement moral. Le seul critère à retenir serait l’intention du sujet désirant. S’il est pertinent en matière d’investigation psychologique tel que le praticien l’exerce dans la psychothérapie et dans la cure psychanalytique alors qu’il n’a pas à formuler une expertise morale, ni à être normatif, il est insuffisant en matière de théologie morale même s’il représente l’un des paramètres du discernement moral. L’usage de la technologie contraceptive pose objectivement un problème moral et, en plus, elle n’est pas sans conséquence sur le sens de la sexualité et de la génération, et sur la multiplication de certaines pathologies comme on s’obstine à ne pas envisager le rapport de cause à effet dans les cas, entre autres, d’infertilité masculine ou féminine.
Qu’est-ce que le synode peut faire ou dire pour les catholiques mariés à l’église puis divorcés et remariés ?
Monseigneur Tony Anatrella - De nombreuses réflexions ont été faites à ce sujet en sachant que ce n’est pas un Synode sur les divorcés-remariés mais sur la famille. De plus le Synode est purement consultatif, il ne décide de rien. Donc tous les énervements médiatiques et les interprétations des journalistes laissent espérer des décisions impossibles. J’ai entendu sur une radio en France un personnage qui se présente comme historien des religieux qui faute de savoir, invente ou crée de faux événements. Il a laissé entendre que sans doute une frange du Synode proposerait une bénédiction pour des « mariages » entre personnes de même sexe, ce qui est impensable. Et qu’une proportion importante de Pères facilitera la communion des divorcés-remariés, ce qui est inconcevable en ces termes. Le Pape l’a dit et répété, nous avons tort de nous focaliser sur ce point, certes préoccupant, mais on ne peut pas réduire la pastorale familiale à ce seul aspect. Pourquoi ? D’abord parce que la plupart des personnes qui sont dans ce cas et qui sont enracinées dans la foi au Christ au sein de son Église, ne demandent rien et vivent humblement. Ce ne sont pas les plus revendicatifs. Ils reconnaissent la situation dans laquelle ils sont et l’assument chrétiennement en donnant un témoignage remarquable à leur entourage et à leurs enfants. De nombreux prêtres soulignent qu’ils sont rarement confrontés à ce type de demande.
D’autre part, il y a des discours très généreux au sujet des divorcés-remariés qui les déshonorent. Certains le disent à l’occasion de ce Synode. Ils font remarquer que ce n’est pas la discipline de l’Église à leur égard qui les blesse, mais les propos mettant en doute leur capacité et leur volonté à suivre l’enseignement de l’Église qu’ils comprennent et veulent fidèlement vivre. Ils ont toujours voulu enseigner à leurs enfants l’indissolubilité du mariage comme un repère structurant pour leur montrer la beauté et la force de cet engagement. Certains mêmes n’ont pas voulu se « remarier » pour rester dans cette cohérence. En sachant que le grand public oublie que les divorcés remariés ne sont pas exclus de l’Église et ce n’est pas le divorce qui éloigne des sacrements mais le remariage puisque, Dieu étant lui-même engagé, le sacrement est unique et indissoluble. Sauf à démontrer la nullité du mariage.
C’est le sens du dernier Motu Proprio du Pape François (8 septembre 2015) ?
Monseigneur Tony Anatrella - Oui, en effet. Le Pape François a ouvert une voie possible de solution à travers le Motu Proprio Mitis et misericors Iesus, concernant la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage. Dans ce document, il instaure une simplification des procédures canoniques.
Le Pape laisse ainsi entendre qu’il faut trouver des mesures pastorales en cohérence avec la doctrine du mariage. La question des divorcés-remariés peut-être traitée avec les moyens de l’Église sans chercher à copier des pratiques qui sont liées à des conditions historiques et contestées en leur temps. Notamment certains imaginent des parcours pénitentiels pour que soient réintroduits dans l’Église des couples infidèles ou irréguliers ; voire même un ordre des pénitents. Le problème me semble ici mal posé car tous ne sont pas infidèles et ne sont pas nécessairement en faute quand, par exemple, pour des raisons psychologiques la relation conjugale a eu du mal à se constituer. Nous sommes ici devant un effet de structure et non pas dans le domaine de la transgression. D’autre part, des femmes abandonnées par leur époux adultère ne veulent pas entendre parler de parcours pénitentiel et encore moins de reconnaissance de nullité, donnant ainsi un blanc-seing à celui qui les a trompées. Tout n’est pas aussi simple ! C’est pourquoi le Pape François, à la demande des Pères du Synode de 2014, a voulu des démarches simplifiées pour rendre justice au cas par cas de situations délicates en évitant de prendre des décisions générales et universelles, au risque de créer encore davantage de confusions.
Les catholiques qui sont dans cette situation peuvent toujours se rapprocher de l’Officialité de leur diocèse pour entamer des démarches. Il faut avoir bien présent à l’esprit que l’éventuelle décision du tribunal ecclésiastique pouvant déclarer la nullité d’un mariage porte essentiellement sur la valeur juridique de l’engagement et non pas sur tous les actes de la vie conjugale, comme ceux qui ont donné naissance aux enfants. La filiation n’est pas déclarée nulle comme le redoutent certains. D’autre part, il faut aussi comprendre que l’échec matrimonial n’est pas davantage un signe de nullité de mariage. Les situations doivent être examinées en toute vérité, justice et charité. Un travail qui demande du temps pour faire « la vérité ». D’où l’importance, comme le prévoyait jusqu’à présent le Code de droit canonique d’une procédure en 1ère et en 2ème instance et d’une réflexion collégiale qui impliquent des juges, des procureurs, des avocats et des experts. Procédure qui est réduite dans le Motu Proprio mais dont le recours en appel reste possible dans certains cas afin de faire la vérité pour rendre la justice.
Ce document pontifical doit être manié avec beaucoup de prudence et de discernement. Sinon, avec le temps la jurisprudence risque de créer un « divorce catholique ». Ou encore se banaliser comme c’est parfois le cas avec les demandes de disparité de culte où le cachet « bon pour accord » est plus ou moins systématiquement apposé sans autre forme de réflexion et de discernement. Une attitude d’autant plus regrettable quand on constate que les engagements pris ne sont pas toujours tenus. Bien entendu, il convient de nuancer ce point par le fait que dans certains cas qui restent néanmoins limités, la « nullité » semble évidente et peut se régler rapidement. Reste à évaluer un mariage religieux contracté alors que l’un et l’autre des fiancés ou un seul, ne se sont pas engagés au titre de la foi. Comment l’évaluer ? Autant de questions bien délicates … qui exigent une approche fine. Enfin, la question est de savoir s’il faut réduire les procédures (dans certains cas, pourquoi pas ?) ou/et avoir davantage de personnel formé dans les sciences canoniques … alors que celui-ci fait défaut ?
Comment le Synode peut-il n’être que pastoral sans toucher à la doctrine en matière matrimoniale ?
Monseigneur Tony Anatrella - Il n’est pas possible de séparer la doctrine de la pastorale. Si on les dissociait, la pastorale ne serait qu’une tentative plus ou moins bancale de s’adapter aux personnes ou de rendre le discours acceptable. Je l’ai souvent évoqué depuis trois ans à l’occasion de la préparation et de la réalisation du Synode sur la famille, l’un implique l’autre. Toutes décisions et toutes pratiques pastorales résultent de ce que nous dit la doctrine enrichie par l’expérience pastorale qui permet de mieux comprendre et de vivre l’enseignement de l’Église. Le Pape François l’a rappelé le mardi 6 octobre : la doctrine de l’indissolubilité du mariage ne sera pas remise en question. Ce qui veut dire que les attitudes pastorales seront adoptées dans la logique de l’indissolubilité. Sinon, il y aurait le risque de la miner de l’intérieur. Ce fut le cas lorsque les sociétés civiles décidèrent d’introduire le « divorce par consentement mutuel » en affirmant que cela ne remettait pas en question le mariage. Le temps a montré l’inauthenticité de cet adage qui fut répété également avec l’instauration du « Pacs » en disant que l’on ne touchait pas au mariage. Dix ans après le « mariage » entre personnes de même sexe a été imposé de façon violente et transgressive aux sociétés. En conséquence de quoi, le mariage est socialement dévalorisé et fait peur à des jeunes. C’est pourquoi sans doute, pour certains qui se marient, il leur faut organiser une fête grandiose – à l’image du mariage du siècle – pour conjurer le peu de soutien dans la loi de l’état matrimonial réduit à un contrat transitoire. Quand on modifie le droit pour faire des exceptions, le risque encouru est de déstabiliser l’ensemble de l’édifice à long terme. C’est pourquoi, il est important de considérer que toute décision de justice de la part de l’Église reste toujours dans la cohérence de l’indissolubilité.
Autrement dit, tout changement dans la pratique pastorale peut atteindre et changer la doctrine. N’importe quoi, par exemple, ne peut se décider sous le couvert de la « tolérance » du moindre mal, de « l’accueil » pour en rester au « récit de vie » de chacun, où encore de la « compassion » pour éviter « d’exclure » et de confronter à des interrogations majeures. Nous avons eu ces dernières années trop tendance à laisser couler les choses pastoralement pour éviter de faire des vagues. De ce fait, d’année en année les choses deviennent difficiles parce qu’elles n’ont pas été traitées en leur temps et que certains en restent aux représentations des années 1970 pour privilégier une sorte de tolérance face à ces situations de fait et comme si le péché n’existait plus. Un des Pères du Synode en la personne du Cardinal Rylko a dit : « L’Église devrait être comme un hôpital de campagne, mais il n’y en a pas beaucoup dans cette situation qui veulent être obligés d’aller à l’hôpital. S. Augustin demande à ceux qui veulent de l’aide mais ne veulent pas se convertir : « Pourquoi nous cherchez-vous ? » C’est ainsi que se comportent certains baptisés qui sont en situation irrégulière, mais ne veulent pas recevoir le sacrement de la pénitence. Ainsi, nous avons non seulement une crise du mariage et de la famille, mais aussi une crise de la foi. » Certains évêques allemands, autrichiens et suisses devraient davantage s’interroger sur leur volonté de libéraliser les sacrements à l’égard des divorcés-remariés se basant sur des arguments mondains qui font fi de la structure du sacrement de mariage. Les chrétiens divorcés-remariés méritent sans doute mieux pour être accompagnés dans la vérité et la charité
La crise actuelle du mariage et de la famille est en rapport avec un manque de foi ?
Monseigneur Tony Anatrella - C’est le constat récurent, parmi d’autres, que l’on peut faire. Nous avons noté les maux divers qui touchent la famille. Le rôle de l’Église est d’accompagner les personnes en difficultés et en attente de perspectives sur le sens du mariage … du moins si elles le veulent. Mais le rôle de l’Église est aussi de promouvoir pastoralement et politiquement la famille constituée par un homme et une femme engagés dans le mariage. Ils témoignent ainsi de leur espérance et de leur volonté d’inscrire leurs enfants dans une histoire et dans la succession des générations. Si la famille ainsi fondée n’est pas toujours un long fleuve tranquille, elle reste néanmoins le cadre dans lequel les adultes et les enfants peuvent se réaliser. Les aînés donnent ainsi le témoignage que malgré toutes les épreuves de l’existence, les conflits relationnels et les incompréhensions, l’engagement matrimonial demeure la référence à partir duquel toutes les difficultés se pensent et toutes les aspirations se traitent. Elle est le lieu par excellence où se vit et se transmet la foi chrétienne. Dans le meilleur des cas, elle est un espace ouvert qui accueille et reçoit les gens les plus divers et aux options parfois les plus contrastées.
L’Église a donc à encourager tous ceux qui ne s’arrêtent pas aux problèmes mais les dépassent afin de correspondre à la beauté que représente la famille. Dans une perspective chrétienne, la famille est une création de Dieu lorsqu’Il créa l’homme et la femme. Elle appartient comme un bien propre à l’humanité non-négociable en prenant des formes culturelles différentes mais toujours autour de l’homme et de la femme. Le mariage en est le fondement. Celui-ci et la famille ne sont pas à la libre disposition du pouvoir politique : ils le précédent. Dans la Bible, les relations qui veulent s’approcher de la famille sont souvent voisines de certaines situations que nous connaissons encore aujourd’hui. Rien de nouveau sous le soleil ! Mais nous assistons tout au long de cette histoire biblique qui culmine dans l’alliance nouvelle avec le Christ, à un affinage progressif de l’image de la famille. Et en ce sens, il est injuste, voire démagogique, de dire qu’il n’y a pas un modèle de la famille pour l’Église, même si elle s’adresse à toutes les formes de cellules affectives qui existent. C’est toujours dans l’intention de montrer les ressources et les richesses qui font exister une famille. C’est sur cette espérance que le Synode travaille en ayant pour modèle le Christ miséricordieux à travers la parabole du fils « prodigue » (Luc 15, 1-32).
* Monseigneur Tony Anatrella, est psychanalyste et spécialiste en psychiatrie sociale, Consulteur du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil Pontifical pour la Santé. Il est enseignant à Paris et expert auprès des Officialités en France. Il est l’auteur, pour le thème de cette interview, des livres : Le règne de Narcisse – le déni de la différence sexuelle – Éditions Presses de la Renaissance et Mariage en tous genres, Éditions l’Échelle de Jacob. Il vient de publier : Développer la vie communautaire dans l’Église, l’exemple des Communautés nouvelles, Éditions l’Échelle de Jacob. Et a participé à l’ouvrage collectif : La famille : enjeux pour l’Église, aux Éditions Lethielleux.

 18h00
18h00 



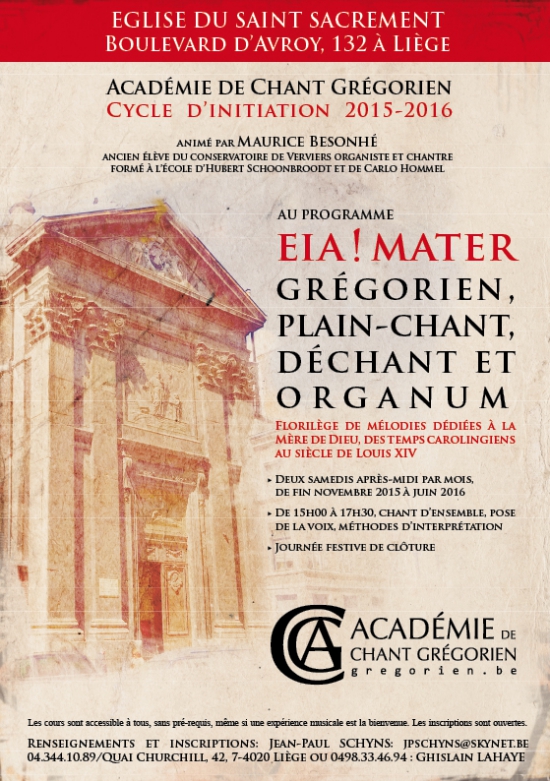
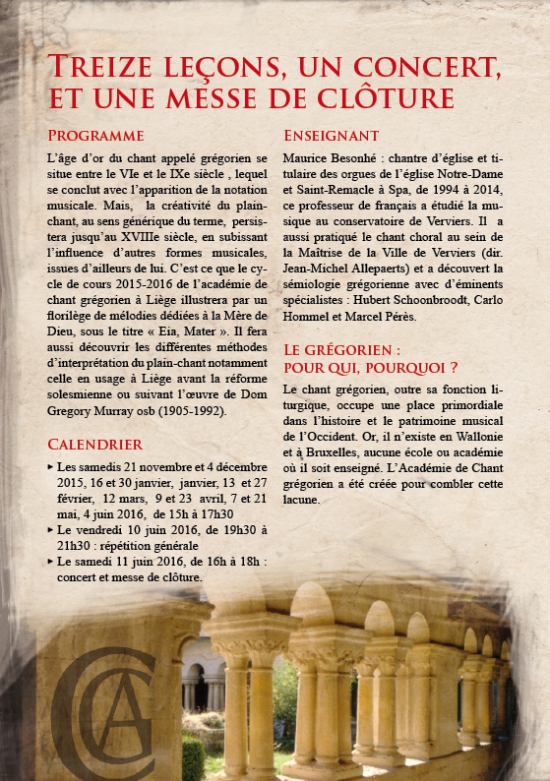
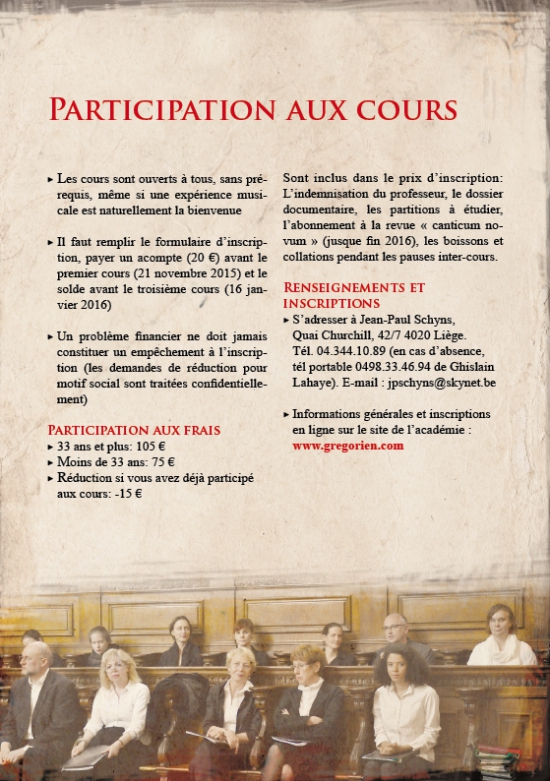

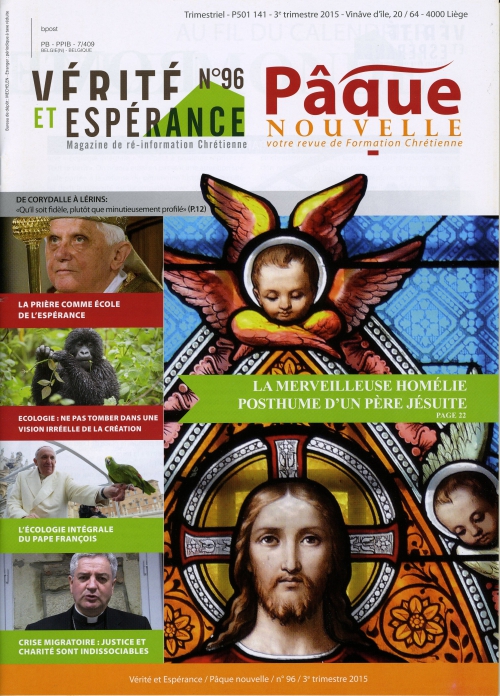
 En vue du Synode sur la famille d’octobre prochain, l’Université Pontificale de la Sainte Croix à Rome a organisé un symposium sur « Mariage et famille. La question anthropologique et l’évangélisation de la famille ». La leçon inaugurale était confiée au cardinal-archevêque de Bologne Carlo Caffarra qui a parlé de la manière de proposer une vision chrétienne du mariage dans une culture occidentale qui a démoli le mariage naturel. Présentation sur le site web « didoc.be » :
En vue du Synode sur la famille d’octobre prochain, l’Université Pontificale de la Sainte Croix à Rome a organisé un symposium sur « Mariage et famille. La question anthropologique et l’évangélisation de la famille ». La leçon inaugurale était confiée au cardinal-archevêque de Bologne Carlo Caffarra qui a parlé de la manière de proposer une vision chrétienne du mariage dans une culture occidentale qui a démoli le mariage naturel. Présentation sur le site web « didoc.be » :