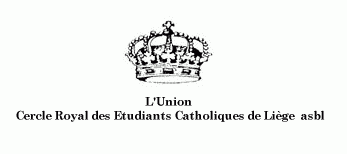

 Le nouvel évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, a inauguré un nouveau cycle de lunchs débats à l’Université de Liège. Le cycle est organisé par le groupe « éthique sociale » de l’Union des étudiants catholiques, sur le thème « Humanisme chrétien, Travail et Société ».
Le nouvel évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, a inauguré un nouveau cycle de lunchs débats à l’Université de Liège. Le cycle est organisé par le groupe « éthique sociale » de l’Union des étudiants catholiques, sur le thème « Humanisme chrétien, Travail et Société ».
La conférence de Mgr Delville était intitulée « l’humanisme dans l’engagement social de l’Eglise, hier et aujourd’hui ». Docteur en Philosophe (UCL), théologien (Université grégorienne à Rome) et musicien (prix d’orgue du Conservatoire royal de Liège), Mgr Delville est aussi licencié en histoire de l’Université de Liège. Au moment de sa nomination épiscopale (31 mai 2013), il était professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain, où il enseigna l’histoire du christianisme.
|
« Deus caritas est » : C’est le lien de l’amour qui constitue l’unicité de Dieu dans l’altérité des personnes trinitaires. À la suite de saint Jean, Benoît XVI, dans sa première encyclique, a développé les conséquences cette affirmation, avec beaucoup d’intelligence et de fraîcheur d’âme.
De là résulte que l’autre, dans la foi, est toujours pour nous le visage de Dieu, même s’il est parfois bien défiguré.
Jésus est formel. Au jour du jugement, lorsque toutes les nations seront rassemblées devant lui, il dira à ceux qui sont à sa droite : « j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Et aux autres : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges » (cfr Matthieu, 25, 31-46)
De cette Parole, qui émaille aussi sous d’autres formes tous les textes évangéliques, procède une double démarche : l’amour inconditionnel des pauvres, quels qu’ils soient, et la recherche de la pauvreté spirituelle qui purifie l’âme. Au fil de son histoire, même peuplée par tous les vices des cercles de l’enfer de Dante, la chrétienté l’a toujours su et exalté cet idéal. C’est ce que nous rappelle d’abord l’orateur.
Mais, au XVIIIe siècle, dans la société occidentale a pris naissance un profond bouleversement de la condition humaine issu de ce que Paul Hazard a appelé « la crise de la conscience européenne » : la révolution des lumières philosophiques et celle de l’industrialisation qui s’en suivirent ont introduit dans la vie sociale une rupture inédite, exaltant la liberté de l’homme pour mieux l’asservir. Aux idéologies contradictoires qui l’expriment et ambitionnent de tenir lieu de religion à l’ère du progrès industriel et technique, l’Eglise a opposé une doctrine sociale tirée de l’Evangile. Monseigneur Delville nous montre en quoi il ne s’agit pas d’une idéologie de plus. On lira ci-dessous la transcription in extenso de l’enregistrement de sa conférence (les intertitres sont de notre fait) :
JPSC
|




1. Introduction
Cette journée est en quelque sorte historique pour traiter de l’engagement social de l’Eglise dans son cadre humaniste, puisque le pape vient de publier aujourd’hui une Exhortation apostolique Evangelii Gaudium , la Joie de l’Evangile, consacrée à l’évangélisation dans la société actuelle. Cette Exhortation fait suite au synode des évêques d’il y a deux ans consacré à ce sujet et le pape a repris pas mal de conclusions présentées par les évêques mais il y a manifestement ajouté son grain de sel, et plus qu’un grain. Vous en aurez quelques éléments en primeur à la fin de cette conférence. Voilà pour le grand angle, mais si je prends la loupe je dois dire que j’ai vécu personnellement aujourd’hui une rencontre importante et intéressante avec la concertation des Eglises chrétiennes du diocèse de Liège, catholique orthodoxe, syriaque, anglicane et protestante ; nous avions programmé de rencontrer les syndicats FGTB et CSC sur le grand drame social qui pouvait éclater d’ici la fin de l’année à Liège : plus de 1000 personnes menacées de licenciement chez Arcelor Mittal. On ne sait pas dans quelles conditions cela se fera, on espère qu’il y aura une capacité de procurer des prépensions mais ce n’est pas évident a priori. C’est pourquoi, comme Eglises, nous avons voulu en quelque sorte nous documenter, être au courant de la situation pour être prêts à réagir. Et donc cette rencontre a été très instructive pour moi. Il y en a eu un petit écho dans le journal.
Tout ceci est pour dire que nous sommes en train de traiter ce soir d’une question d’actualité : le pape en parle, à Liège, on en parle. Je parle donc de cette justice sociale promue par le christianisme dans le cadre de sa sensibilité humaniste dès la racine, dès les débuts, par Jésus Lui-même, mais aussi dans l’histoire jusqu’à aujourd’hui. Et donc je vais structurer ma présentation en trois étapes ; ma première étape sera plutôt biblique et je me référerai à des textes fondamentaux du Nouveau Testament ; la seconde étape sera historique et j’évoquerai quelques éléments de l’histoire de l’Eglise sans cependant m’y attarder trop ; la troisième étape sera davantage locale, consacrée au rôle de Liège dans le développement de la doctrine sociale de l’Eglise pour aboutir alors à l’actualité et aux lignes qui s’imposent aux chrétiens aujourd’hui.
2. L’engagement social vis-à-vis des pauvres, selon l’évangile
« Heureux, vous les pauvres » (Lc 6,20) et Mt 5,3 « Heureux les pauvres en esprit » (Mt 5,3) : dans les béatitudes, Jésus a eu cette parole de défi, puisqu’il s’agit d’une contradiction apparente : un pauvre est malheureux mais Jésus lance, au contraire, « heureux, les pauvres » ! En disant cela, forcément, Jésus laisse entrevoir la nouveauté de sa manière à lui de rencontrer les pauvres qui est la manière personnelle, la rencontre personnelle : Jésus touche les personnes malades et procure la guérison. Souvent, les évangiles racontent un dialogue entre Jésus et une personne malade ou une personne souffrante. Parfois ce dialogue se conclut par cette phrase : « ta foi t’a sauvé ». Donc, Jésus procure une rencontre « humaniste », interpersonnelle et, par cette rencontre, il guérit et c’est par le constat de cette guérison, de cette prise en compte d’une situation personnelle que Jésus peut déjà dire d’une manière visible : « heureux les pauvres », voyez ce qui se passe. Cette pauvreté, Jésus la voit aussi d’un point de vue spirituel. Si l’on prend l’évangile de Matthieu : « Heureux les pauvres en esprit », là il s’agit d’un autre paradoxe : il s’agit de la pauvreté au sens de l’humilité de celui qui ne se prend pas pour un grand, celui qui accepte sa pauvreté personnelle et donc son besoin de l’autre. Ici encore apparaît une dimension humaniste : la qualité de l’être humain n’est pas dans sa perfection mais dans sa pauvreté, c’est-à-dire dans son besoin des autres, dans la solidarité que la pauvreté implique.
Voilà donc un premier motif d'engagement social: cette dimension de bonheur pour les pauvres, et on va le constater d'emblée dans le message qu'il va diffuser. Par exemple dans la synagogue de Nazareth, lorsqu'il entre dans sa vie publique, reprenant une phrase du prophète Isaïe, Jésus proclame devant l'assemblée réunie: je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres (Luc, 4, 18) et, en réponse aux disciples de Jean-Baptiste: " la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres" (Mt. 11, 5).
Bonne nouvelle aux pauvres : tel est le ministère que Jésus s’assigne. Voici quelques exemples concrets : lorsqu’ il rencontre un jeune homme riche qui lui demande : « Que dois-je faire pour entrer dans le Royaume de Dieu ? » Jésus lui répond : « Observe les commandements. » Mais, comme le jeune homme lui répond : « cela, je l’ai fait toute ma vie. », Jésus lui réplique (Mt 19,21) : « Alors, ton argent, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. » On sait que ce jeune homme s’en alla triste parce qu’il n’osait pas entendre cette parole. C’était pourtant la pointe du message de Jésus : la capacité de partager.
Ce message, un autre l’a entendu, c’est le fameux Zachée, un « richard », un collecteur d’impôt public qui met dans sa poche beaucoup d’argent qu’il récolte pour l’Etat romain et dont il garde une partie pour lui. Zachée veut malgré tout voir Jésus. Il y a au cœur de cet homme qui était possédé par un esprit d’avarice, un attachement à l’argent, un autre désir : voir Jésus. Il monte sur un sycomore pour le voir Jésus, ce qui n’est pas banal (imaginons aujourd’hui un banquier escaladant un platane dans des circonstances analogues !) ; il ose aller jusqu’au bout de ce désir. Les Pères de l’Eglise donnent un beau commentaire dans lequel ils affirment que ce sycomore, c’est en fait les chrétiens qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés dans la foi, et nous montons sur leurs épaules pour voir Jésus. Grâce à la Tradition qui nous est transmise, nous pouvons voir Jésus. Zachée monte donc sur ce sycomore, voit Jésus, mais surtout Jésus le voit, c’est le croisement des regards. Jésus vit Zachée ; ceci est très important. Vous remarquez cela souvent dans l’évangile : Jésus, au lieu de passer tout droit et de ne pas regarder ni à gauche ni à droite comme nous le ferions pour ne pas être harcelés, distraits, etc., lui, Jésus regarde et s’arrête ; il voit Zachée et lui dit : « Zachée, descends de cet arbre, aujourd’hui, je dois aller loger chez toi. » Jésus a ce raccourci : comprenant que Zachée est devenu un homme disponible puisqu’il cherche Jésus du regard, Jésus anticipe et dit carrément : « je vais chez toi ! ». Jésus ne lui demande rien mais spontanément Zachée déclare : (Lc 19,8) « Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Jésus ne lui a rien demandé mais Zachée a décidé lui-même et il a mis un taux : 50% ! Voilà, c’est important : tout chrétien, tout homme est invité à faire un choix dans ses partages. Le christianisme ne dit pas autant ; chacun fait sa propre sélection, choisit ce qu’il veut donner, ce qu’il veut partager. Zachée est mis en valeur par l’évangéliste saint Luc qui est le seul à raconter cet épisode. Et donc Zachée manifeste cette dimension du chrétien, du disciple du Christ qui, par voie de conséquence, commence à partager. Donc, on voit comment l’approche humaniste, ce regard de Jésus sur Zachée , débouche sur un engagement social.
Autre exemple, lors de l’onction à Béthanie, avec cette femme qui vient oindre les pieds de Jésus. L’hôte de Jésus qui était un pharisien murmure : « cela, ce parfum pourrait être vendu bien cher et être donné aux pauvres » (Mt 26,9). Jésus rétorque : « les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » (Mt 26,11) Donc Jésus fait de cette réflexion, un peu ironique, quelque chose à prendre au sérieux : « vous en aurez toujours avec vous ». Sous-entendu : le chrétien est toujours confronté à la question de la justice sociale.
Dans saint Luc, il y a cette parabole des invités au festin (Lc 14,13). Les invités sont nombreux à être conviés mais personne ne vient. Alors le maître dit à ses serviteurs : « invitez des pauvres, des estropiés, des boiteux ». Ce geste du serviteur, c’est un peu l’idée de Jésus : le royaume de Dieu est en quelque sorte destiné à ces pauvres qui en ont le plus besoin et ceux qui, étant invités, prenaient cette invitation de haut ne profitent pas de la situation.
Dans l’évangile de Luc encore, la parabole du pauvre nommé Lazare (Lc 16,20) qui se trouvait aux pieds de ce riche qui dépensait sans compter. Voilà une parabole, c’est sans doute la seule de l’évangile, où le héros a un nom : Lazare (qui signifie « Dieu aide »). Cette parabole de Lazare face au riche est, pour saint Luc, un grand message, un message sur la valeur de la dignité de cette personne pauvre qui apparaissait rejetée, méprisée et puis qui, dans la vie éternelle, est dans le sein d’Abraham, dans le paradis.
Voilà donc quelques échos de l’évangile où l’on se rend compte de l’orientation importante du rôle du pauvre dans l’ouverture du Royaume de Dieu, l’ouverture au salut.
On peut aussi citer trois passages des lettres apostoliques :
Dans la Lettre de saint Jacques, 2, 2-6, il y a cette comparaison, cette évocation imagée, en somme, que fait l’apôtre. « S’il entre dans vos assemblées un riche aux bagues d’or et qu’il entre un pauvre en habits malpropres, si au riche vous dites : assieds-toi à cette bonne place, et au pauvre vous dites : tiens-toi debout, n’avez-vous pas fait en vous-même une discrimination ? N’est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvre aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume ? Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité ! » Par cette évocation, saint Jacques montre des situations concrètes. On a tendance à mettre le pauvre sur le côté, à valoriser le riche. Mais saint Jacques reprend la thèse de Jésus : celui qui est pauvre aux yeux du monde est riche en foi, riche dans la place qu’il occupe dans le Royaume de Dieu. Et il ajoute en plus cette notion de dignité du pauvre.
Saint Paul dans la seconde lettre aux Corinthiens, 8,9, reprend cette comparaison du Christ avec le pauvre : « Le Christ, pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté ». Cela devient de la dialectique : le Christ qui était riche en gloire, riche par sa divinité, s’est fait pauvre, il s’est dépouillé de son prestige, il s’est fait petit enfant, il s’est fait personne souffrante. Mais, grâce à cela, il nous rend riches par sa pauvreté, riches spirituellement, humainement, par notre solidarité, par cette pauvreté, par le salut qu’il nous accorde à travers le don de soi qui est une pauvreté. Donc, ici, saint Paul montre bien cette importance de la pauvreté spirituelle, de l’humilité, comme base d’une richesse d’amour.
Troisième passage : la Lettre de saint Paul à son ami Philémon (15, 16) qui avait un esclave, Onésime, qui s’était enfui. Onésime était devenu chrétien et avait trouvé refuge chez saint Paul. Alors, Paul est embêté ; qu’est-ce que je vais faire avec cet esclave fugitif devenu chrétien ? Est-ce que je vais respecter la loi et renvoyer l’esclave chez son patron qui, de toute façon, est aussi un ami ou est-ce que je vais demander la libération de l’esclave au nom de la dignité chrétienne ? Face à cette question, Paul a une réponse extraordinaire qui est un appel à la conscience de Philémon ; il ne lui dit pas ce qu’il doit faire mais il le fait raisonner à partir de la notion de dignité humaine et de fraternité. La phrase clef est aux versets 15 et 16 : « Cher Philémon, peut-être Onésime, ton esclave, n’a-t-il été séparé de toi pour un temps qu’afin de t’être rendu pour l’éternité, non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu’un esclave : un frère bien-aimé. » Peut-être que… réfléchis ! Paul ne donne pas une loi nouvelle à suivre, il fait appel à la réflexion de Philémon : réfléchis ! Ton esclave est devenu un frère, il s’est converti au christianisme, ça fait apparaître sa dignité. Maintenant décide ce que tu veux. On ne sait jamais. La réponse de Philémon, on ne la connaît pas mais on peut la deviner. De ces éléments, je tire également une conclusion très importante : la doctrine chrétienne au niveau de l’engagement social, n’est pas une doctrine toute faite avec des injonctions incontournables dans le sens de pratiques obligatoires ; elle est le résultat d’une élaboration, d’un travail de la conscience qui doit s’appliquer sur le terrain, progressivement. Si saint Paul avait dit, dans cette lettre à Philémon : « cher ami, tu es devenu chrétien, or un chrétien croit dans la dignité de l’homme ; un esclave est un homme rendu indigne, donc tu dois libérer ton esclave », Paul aurait parlé contre l’esclavage d’une manière absolue. Dans la société romaine où plus de la moitié des gens étaient esclaves, cette injonction aurait été complètement inapplicable, absolument inapplicable, complètement impensable pour le fonctionnement de la société. Si Paul avait dit les choses aussi platement, il aurait lancé une suggestion complètement inapplicable et dès lors il aurait discrédité tout le reste de son message. Mais il a été plus malin, il a invité à réfléchir en commençant par un cas précis, celui d’Onésime, et remarquons-le, il faudra 1900 ans pour que la suggestion de saint Paul devienne une loi dans le monde et pour que l’on supprime, du moins en théorie, l’esclavage, mais on y est arrivé et il aura fallu pratiquement 1900 ans.
Voilà donc mon premier chapitre, cette évocation de la position chrétienne sur l’engagement social, le souci du pauvre, le souci de l’esclave, comme conséquence de la foi ou plutôt comme partie prenante de la foi mais aussi comme résultat non pas d’une théorie toute faite mais d’une relation personnelle.
3. Histoire de l’Eglise
Quelques « flashes » sur l’histoire de l’Eglise.
Saint Martin (†397) et le partage du manteau
Quand j’étais vicaire à Saint-Martin ici à Liège, j’ai eu l’occasion de me pencher sur la vie de saint Martin et cela m’a beaucoup frappé, parce que Martin qui apparaît dans les images comme un chevalier médiéval est en fait un père de l’Eglise du IVe siècle, plus ancien même que saint Augustin. C’est donc un vénérable père de l’Eglise mais qui n’est pas connu pour ses écrits comme les autres pères de l’Eglise parce qu’il n’a rien écrit. Par contre, il a agi et cela a frappé énormément les chrétiens de nos régions et même les gens, les habitants. C’était son type d’action.
L’épisode le plus célèbre, vous le connaissez : Martin était caserné à Amiens en France, soldat romain, à l’âge de dix-huit ans, jeune homme en somme. Il avait des sympathies pour le christianisme mais n’était pas baptisé. Voilà que, à la porte de la ville où il était en stationnement, passe un pauvre qui lui demande l’aumône et Martin est embêté parce qu’il n’a pas d’argent à donner mais il a ce coup de génie : il prend son manteau, il prend son épée, il coupe son manteau en deux et donne la moitié au pauvre. C’est le premier épisode, c’est le plus connu. Quand on s’arrête là, les chrétiens hyper bien-pensants objectent : s’il avait été un si grand saint, il aurait donné tout son manteau, pas seulement la moitié.
Certains répondent à cette objection que la loi romaine interdisait aux soldats de donner plus de la moitié de leur attirail. Mais, il y a une raison plus profonde, car l’épisode ne s’arrête pas là. La nuit suivante, Martin dort dans sa tente et a un rêve. Dans ce rêve apparaît devant lui la cour céleste avec le Christ entouré de tous les saints et de tous les anges. Et le Christ, à un moment donné, fait signe à quelqu’un qui se trouve au fond : « venez un petit peu là, vous » et Martin se sent interpellé, car il était au fond de la salle. « Avancez ». Martin s’avance, et le Christ dit devant toute l’assemblée : « Regardez, ce jeune homme, Martin, m’a donné ce matin la moitié de son manteau. » Et au moment où le Christ dit ça, Martin voit sur les épaules du Christ le demi manteau qu’il avait donné le matin. Et il se réveille. Par ce rêve, Martin comprend qu’en donnant la moitié de son manteau au pauvre, il a fait non seulement un geste d’amour, mais il a fait un geste d’alliance avec le Christ. Le Christ porte son manteau. Les deux parties du manteau sont sur les épaules du Christ et sur celles de Martin, et donc, cela fait partie désormais de sa foi : son geste de charité est devenu la base de sa relation au Christ qui s’identifie au pauvre, qui fait alliance avec celui qui a donné au pauvre. Donc, Martin, par ce geste devient en quelque sorte le symbole d’un christianisme au cœur duquel se trouve le partage.
D’autres épisodes dans sa vie attestent de cette dimension. Martin, devenu évêque, donne aussi une partie de son manteau, de son aube pour être plus précis, dans la sacristie de la cathédrale où il célèbre parce qu’un pauvre était entré par la porte de derrière et au moment où il célèbre la messe et qu’il élève les mains pour la consécration, la chasuble tombe de ses bras, les montrant nus parce qu’il avait donné son aube au pauvre. Alors, il paraît qu’un ange intervint aussitôt pour relever la chasuble et cacher les bras nus aux yeux des fidèles car ce n’est pas décent pour un prêtre d’avoir les bras nus pendant la messe. A Tours, où se trouve le tombeau de saint Martin, on montrait les manchons de saint Martin qui sont ces espèces de manchons que l’ange lui avait mis sur les bras pour cacher sa nudité. C’est la petite histoire mais cela montre cette continuité.
Martin est devenu le symbole du chrétien qui partage et cela va être connu à l’époque et davantage encore au Moyen Age, cinq cents ans plus tard, où Martin est le symbole du chrétien et même, dans nos régions, du laïc chrétien, du seigneur chrétien, parce que c’est un soldat et donc cette qualité de soldat va le hisser au sommet du symbolisme. C’est pourquoi, dans toutes les villes du monde, il y a une église Saint-Martin, en tout cas, en Europe occidentale.
Saint Basile († 379) et l’invention de l’hôpital
A la même époque que saint Martin mais en Orient, saint Basile, évêque de Césarée fonde une institution que nous connaissons tous et qui s’appelle l’hôpital. Nous sommes au IVe siècle. Jusque là, dans les villes, il n’existe pas d’hôpital. Il peut y avoir d’immenses villes comme Rome, comme Antioche, comme Alexandrie, comme Athènes, mais il n’y a pas d’hôpital. C’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’endroit pour soigner les gens autre qu’à la maison. L’hôpital, c’est une invention chrétienne. C’est l’idée de réunir les malades, de les accueillir dans une hospitalité, un accueil, de soigner ces malades et d’avoir des gens qui s’en occupent. A Césarée, saint Basile invente donc l’hôpital et cela va devenir une institution qui ne fera que grandir et s’étendre dans les siècles suivants, bien sûr progressivement mais tout de même avec une ampleur aujourd’hui énorme.
Saint Benoît († 547) et le monachisme
Autre exemple : les moines, fondés par S. Benoit (†547), les Bénédictins, vont recevoir comme mot d’ordre dans leur Règle l’accueil du pauvre dans leurs monastères. Dans chaque monastère de l’ordre de saint Benoît, il y a une pièce pour l’accueil du pauvre.
Saint François d’Assise († 1226) : le choix de la pauvreté
Autre exemple encore , saint François d’Assise (†1226). Nous sommes alors à un tournant : la société se constitue en villes alors que, jusque-là , l’Europe était surtout constituée de petits villages. Les villes s’enrichissent grâce au commerce et par conséquent elles produisent aussi de grandes disparités sociales. François d’Assise va manifester au cœur de la ville riche le choix de la pauvreté. Il décide clairement de renoncer à tous ses biens et il se dédie à Dame Pauvreté. Le choix de la pauvreté est aussi, pour saint François, le choix de la solidarité. Sa vocation va être confirmée par sa rencontre avec le lépreux sur le chemin. Il embrasse le lépreux, et à partir de ce jour-là, il a compris que lui et ses frères, les frères mineurs, sont appelés à l’amour des pauvres.
Sainte Julienne de Cornillon († 1258), maîtresse de l’hôpital de Cornillon, promeut la fête du Corps du Christ
A la même époque que saint François d’Assise, nous avons sainte Julienne de Cornillon. Sainte Julienne était directrice d’hôpital, l’hôpital de Cornillon à Liège, sur la route de Fléron, en direction d’Aix la Chapelle. Là, Julienne s’ingénie à accueillir les lépreux et autres malades dans une double communauté : une communauté d’hommes et une communauté de femmes malades, une communauté d’hommes et une communauté de femmes soignantes. En fait, quatre communautés : c’est la structuration d’un hôpital médiéval. Julienne va en tirer une mystique, la mystique du Corps du Christ et va en tirer l’idée qu’il faut une fête pour le Corps du Christ, la fête du Corps et du Sang du Christ. N’oublions pas que Julienne a d’abord soigné les corps des malades et, petit à petit, elle a découvert l’importance du Corps du Christ que nous recevons en communion. C’est ainsi qu’elle va réussir à convaincre l’évêque et plus tard même le pape d’instaurer une fête pour le Corps du Christ.
Ombres et lumières
Ce sont de grands noms, ce sont de grandes étapes, mais, bien sûr, il y a des ombres au tableau.
Les grands monastères du Moyen Age ont des esclaves, en tout cas des serfs, des paysans qui ne pouvaient pas quitter les terres de leurs seigneurs et tous les seigneurs en avaient. Nous sommes dans une société inégalitaire, dans une société de privilèges où il y a trois ordres : le clergé, la noblesse et les corporations, le reste constituant le tiers état. Il y a donc une société inégale qui en partie certainement est victime d’injustices même si, ne l’oublions pas, chaque église paroissiale doit avoir une table des pauvres. A côté de la table de l’Eucharistie, chaque paroisse doit avoir une table des pauvres. C’est l’ancêtre du Centre Public d’Aide Sociale (CPAS) et, d’ailleurs, tout le patrimoine des tables des pauvres a été transféré aux CPAS. A Liège, le musée du CPAS nous montre encore des héritages remontant au XVe siècle.
Pire encore, les Portugais et les Espagnols en faisant la navigation sur les côtes de l’Afrique d’abord, en direction de l’Amérique ensuite, vont organiser le commerce des esclaves africains. Les Portugais vont faire des razzias en Guinée et importent des esclaves au Portugal ; plus tard, on va les conduire en Amérique. Donc les chrétiens ont pratiqué l’esclavage, qui est totalement injuste.
Mais, il y a eu des réactions, notamment au XVIe siècle, au siècle de l’humanisme. L’humanisme du 16e s. a contribué à promouvoir la justice sociale.
Erasme, par exemple, (1469-1536) mettait en valeur l’être humain, la valeur de l’être humain. Erasme le montre bien dans ses commentaires de l’évangile, les paraphrases. Chaque fois qu’il le peut, il fait apparaître la valeur humaine des attitudes de Jésus et des interlocuteurs de Jésus. Il va faire un célèbre poème intitulé Le silène. Le silène, d’après la mythologie grecque, c’est le plus affreux des êtres mais, en fait, ce plus affreux des êtres est celui qui a un cœur d’or, qui est en même temps le plus généreux. Alors, Erasme décrit le silène et à la fin dit : le vrai silène, c’est le Christ. Le Christ est affreux sur la croix et pourtant c’est lui le plus grand cœur d’or de l’humanité. Donc, il y a cette mise en valeur de l’humanité dans l’évangile par Erasme.A la même époque, Jean-Louis Vivès (1492-1540) fait un plan de lutte contre la pauvreté pour la ville de Bruges. La ville de Bruges était une des plus grandes villes de l’Occident et comptait un grand nombre de pauvres et Vivès procure à l’administration de la ville de Bruges un plan de lutte contre la pauvreté, un des premiers plans sociaux qui existe.
On peut encore citer Thomas More (1478-1535), chancelier d’Angleterre, premier ministre, qui dans son livre célèbre, l’Utopie, imagine une ville parfaite, et dans cette ville parfaite, il n’y a pas de pauvreté, il y a le respect mutuel. Donc, au XVIe siècle, éclot cette promotion de l’humanisme vu non seulement sous l’angle religieux, à partir de l’interprétation évangélique, mais carrément étendu d’une manière philosophique à toute pensée humaine.
4. Christianisme social et démocratie chrétienne, à Liège en particulier
Le XIXe siècle se lance dans la fameuse « révolution industrielle ». Nous l’illustrerons en évoquant cette époque dans l’histoire liégeoise
Liberté d’entreprendre et révolution économique
Après la révolution française qui évacue la société inégalitaire de l’ancien régime, nous avons une deuxième révolution, une révolution économique qui découle de la première parce que, grâce à la liberté du commerce et de l’entreprise, on peut désormais lancer de grandes entreprises sans être freiné, comme autrefois, par le contrôle des corporations qui règlementaient l’activité économique. La suppression des corporations et des règlementations va donner libre cours à l’activité économique.
Les inventions technologiques se succèdent, en particulier des procédés de fabrication de l’acier, une merveille incroyable puisqu’il s’agit d’un métal qui ne rouille pas et qui ne casse pas. Grâce à l’acier, on va pouvoir produire des pièces métalliques de grandes dimensions tels que les rails. L’acier est à la base d’une nouvelle société qui va de pair avec la découverte de la machine à vapeur. La machine à vapeur produit l’énergie, l’acier procure le « contenant », par exemple le chemin de fer. Ainsi pourra-t-on obtenir des constructions immenses telles que la Tour Eiffel, mais aussi les pianos dont les cordes sont en acier, et des milliers d’autres choses. Donc l’acier devient un véritable moteur de la société. Or l’acier est précisément fabriqué ici à Liège où John Cockerill s’installe avec le feu vert du roi des Pays-Bas et lance son entreprise sidérurgique. C’est très important. La sidérurgie constitue un véritable pilier de civilisation. Cela nécessite également une main d’œuvre importante.
De toutes les campagnes environnantes, on vient travailler dans les mines qui produisent le charbon lequel alimente les hauts-fourneaux qui produisent l’acier et c’est alors qu’on met à l’ouvrage les enfants de quel qu’âge qu’ils soient, les femmes avec de petits salaires, les hommes avec des heures de travail immenses. On fabrique également du cristal au Val Saint-Lambert en alliant du verre avec du plomb. En 1843, les verreries du Val-S.-Lambert écrivent à ce sujet : « Le travail des enfants étant nécessaire et ayant lieu simultanément avec celui des ouvriers adultes, il est tout-à-fait impossible d’apporter des changements au mode actuel. » Et la Chambre du commerce de Liège d’ajouter : « Nous avons remarqué bien des fois que l’enfant qui était entré dans un atelier, blême, languissant et déformé, y reprenait bientôt de la vie, de la gaîté et s’y redressait. »
Il semblait donc qu’à l’époque on ne pouvait pas supprimer le travail des enfants. Et pourtant, cinquante ans plus tard, on va l’interdire. Pourquoi ? Parce que ce qui peut paraître comme une impossibilité sociale à un moment donné pourra devenir possible plus tard, grâce à la pensée de précurseurs, ceux qui ont pensé à l’avance.
Dans notre région, beaucoup d’initiatives sociales furent prises dans ces années de 1830 à 1850. Il faut savoir que la révolution belge de 1830 a permis, elle aussi, une grande nouveauté : c’est la liberté d’association. Jusque-là, le régime hollandais mettait des freins à l’association et c’est ainsi que des communautés de religieux ou de religieuses ne pouvaient tout simplement pas exister. Interdiction des couvents jusqu’en 1830 ! Au contraire, la révolution belge va jusqu’au bout de ses principes libéraux et autoriser l’association. C’est ainsi que les communautés religieuses vont pouvoir exister. D’un seul coup on assiste à l’éclosion d’innombrables communautés religieuses qui vont se mettre au service des plus pauvres dans la société, qui vont se lancer dans l’enseignement des enfants sans argent et aussi celui des filles - ce qui était révolutionnaire, car jamais les filles n’avaient été envoyées à l’école. Mais voilà que les Filles de la Croix « inventent » (en forçant un peu la note) l’école pour filles. C’est en tout cas le premier grand moment de développement de l’école pour filles. Beaucoup d’initiatives se prennent alors sur le terrain, à partir de ce sentiment humaniste, et en particulier des « patronages » où les patrons vont patroner les apprentis, les guider.
L’émergence de la pensée marxiste
Mais, à un moment donné, ce mode d’approche sociale plutôt interpersonnelle va être critiqué par le monde socialiste et par l’émergence de la pensée marxiste (1848 : Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx).
Dans les années 1880, le Parti Ouvrier Belge (fondé en 1883) se développe ; à ce moment-là surgit donc un tout autre mode de pensée, une pensée qui, pour venir à bout des injustices sociales et de la pauvreté du prolétariat, prône la lutte des classes, la lutte des prolétaires contre les possédants, les capitalistes. Elle justifie cette lutte des classes par le matérialisme historique, c’est-à-dire la théorie selon laquelle l’histoire n’a jamais avancé que par la lutte des pauvres et des exploités, contre les puissants. Cela s’accompagne d’un athéisme convaincu, d’une condamnation du droit de propriété privée, en faveur d’une propriété collective. Avec cette vision des choses, on peut révolutionner la société, car on a des moyens à sa disposition : l’association ouvrière, c’est-à-dire le syndicat enfin permis grâce au droit d’association ; la coopérative de travail ou de consommation qui réunit des ouvriers devenant leurs propres patrons ; l’engagement politique, l’idée que tout devrait être contrôlé par des lois grâce au pouvoir politique.
Ces trois outils (l’association ouvrière, la coopérative, l’action politique) vont être reconnus comme valables par les milieux chrétiens ; par contre la théorie (lutte des classes, matérialisme historique, propriété collective) est « imbuvable » d’un point de vue chrétien. On ne peut baser la vie en société sur la lutte des classes, c’est contraire à l’amour du prochain ; on ne peut pas refuser le droit à la propriété, c’est un droit naturel ; enfin on ne peut pas théoriser l’histoire comme un pur matérialisme puisque l’on croit à la dimension spirituelle. Donc, le marxisme socialiste a trois aspects complètement impossibles à digérer pour un chrétien mais trois outils assimilables pour des chrétiens.
Une réponse chrétienne : l’école liégeoise de sociologie
Qui va faire ce « tri » ? C’est « l’école liégeoise », aussi appelée « école liégeoise de sociologie » ou « de sciences sociales », dirigée par l’abbé Antoine Pottier, professeur au séminaire de Liège, avec l’appui actif de l’évêque, Mgr Doutreloux. Antoine Pottier réfléchit à partir de la pensée de saint Thomas d’Aquin. Dans saint Thomas, il lit notamment ceci : « il y a deux sortes de justice : la justice contractuelle et la justice générale. » La justice contractuelle est basée sur un contrat qui est juste, c’est-à-dire : un patron vient trouver un ouvrier et lui dit : « je t’engage et je te paie un franc, es-tu d’accord ? » L’ouvrier lui répond : « ce n’est pas beaucoup », mais le patron lui rétorque : « c’est à prendre ou à laisser, c’est un contrat ; si tu es d’accord, on tope là et je m’engage à respecter ce contrat. » C’est ce qu’on appelle la « justice contractuelle ». Le contrat est « juste » ; il est clair et les deux parties se sont mises d’accord. Mais il y a aussi la justice générale ; d’après saint Thomas, le raisonnement est le suivant : « l’être humain est né parce que Dieu a voulu qu’il naisse et nous sommes là, tous les êtres humains ; Dieu a voulu que nous naissions. Si un être humain est né, il a donc le droit de vivre. Sinon Dieu ne l’aurait pas fait naître. S’il a le droit de vivre, il a le droit de vivre décemment, sinon il ne peut pas vivre réellement. » Et s’il a le droit de vivre décemment, ajoute Antoine Pottier, il a le droit d’avoir un salaire juste. Cette étape supplémentaire ajoutée par l’abbé Pottier est justifiée de la manière suivante : à l’époque de l’agriculture, il n’y avait pas besoin de salaire ; chacun avait son jardin pour cultiver ce dont il avait besoin et vivre dignement, mais, quand on est dans une grande ville, il n’y a plus de jardin et il faut vivre de son salaire. Le salaire fait partie de la justice générale, fait partie du droit de vivre. Si le salaire juste fait partie du droit à la vie, qui va déterminer le salaire juste ? L’Etat.
Donc, l’Etat doit légiférer sur un salaire juste. Ce raisonnement va s’appeler la « justice sociale ». C’est donc l’invention du concept de « justice sociale », dans les années 1880, à Liège et à Lille, contrées industrielles. Ce concept est fondamental parce que, grâce à ce raisonnement, Pottier rejoint un des « outils » des socialistes : l’action à travers l’Etat, chose qui jusque-là était impensable dans les milieux chrétiens, l’Etat n’étant pas censé s’occuper des affaires sociales : il n’y a pas de ministre du travail !
À travers ce raisonnement de Pottier, on en conclut donc que les chrétiens ne doivent plus se contenter d’avoir des actions de charité dans leurs œuvres mais doivent, comme les socialistes, exiger de l’Etat la définition d’un salaire juste, des conditions de travail correctes, et éviter les abus, tel par exemple le travail des enfants. Bref, la législation sociale, pour Pottier, fait partie pratiquement de la loi naturelle, c’est une conséquence obligatoire de la loi naturelle qui est le droit de vivre.
Naissance de la démocratie chrétienne
Evidemment, ces idées vont heurter et on dira que l’abbé Pottier qui veut que l’Etat légifère en matière sociale est socialiste ; ne veut-il pas promouvoir cette idée non seulement par des tracts mais par des syndicats qui vont pousser à ce que l’Etat décide ? Et il faudra que ces syndicats soient poussés par des hommes politiques de leur bord. Donc, il faut que, dans le Parti Catholique, il y ait des personnes émanant des syndicats et qui puissent promouvoir une législation sociale. Ce mouvement syndicaliste va progressivement s’appeler « les syndicats chrétiens » et le mouvement politique « la démocratie chrétienne ».
Grâce à cette fondation qui se fait progressivement aux alentours des années 1890, la Belgique va promouvoir une législation sociale à l’aide de la pression des syndicats et d’un personnel politique et ceux qui vont réaliser cela c’est exclusivement le Parti Catholique qui est au pouvoir de façon ininterrompue de 1884 à 1914, et non les socialistes qui n’arriveront au pouvoir qu’après la première guerre mondiale.
Toute la législation sociale belge de base est due aux catholiques. Mais les catholiques se sont inspirés des socialistes. Ils ont pris aux socialistes leurs idées de syndicat, d’investissement politique, de bien commun, ou plutôt ils ont transformé l’idée de propriété collective en idée du bien commun. Il y a donc eu une influence mais en même temps un tri et à partir de là on comprend pourquoi il y a des syndicats chrétiens, parce que être syndicaliste en 1890, si c’était du côté socialiste, c’était complètement impossible et contradictoire du côté du christianisme : vous deviez être pour la lutte des classes, pour l’abolition de la propriété privée, etc. Mais par contre, le syndicat chrétien voit les choses autrement et donc, par le fait du syndicat chrétien, la justice sociale devient une ligne de faîte.
Développement de la doctrine sociale de l’Eglise
Cette idée va alors être généralisée par le pape Léon XIII dans l’encyclique Rerum Novarumen 1891, Léon XIII qui connaissait très bien l’expérience liégeoise car il avait été nonce à Bruxelles. Il prône donc la fondation d’associations professionnelles, entre autres de syndicats, afin de défendre les ouvriers. Il prône le bien commun, et pas seulement la richesse individuelle. On admet la propriété privée, mais elle doit être équilibrée par la recherche du bien commun et par l’usage social de la propriété. L’Etat doit promouvoir la prospérité pour tous. Cela semble banal mais cela ne l’est pas ; c’est la première fois que l’on affirme que l’Etat est en charge de la justice sociale. Donc, cette idée que l’Etat devait tout contrôler, elle venait des socialistes ; le pape la reprend mais en la compensant par le droit de propriété. Donc, grâce à l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, cette grande évolution de l’engagement social des chrétiens, de la doctrine sociale des chrétiens est devenue universelle. Evidemment, le pape ajoute que l’Etat doit promouvoir un salaire juste et travail humain. Il s’inscrit en faux contre la lutte des classes mais favorise le droit d’association.
Par cette encyclique, par le travail de Pottier et d’autres démocrates chrétiens, certaines intuitions socialistes sont passées dans le monde chrétien et grâce à cela sont devenues des réalités légales en Belgique et il faut savoir que les socialistes ont mis un bémol à leurs revendications de base, à savoir le « pas de propriété privée » qui est mis au frigo, le contrôle de l’Etat est également mis au frigo et la lutte des classes ne sera plus affirmée qu’avec beaucoup de précautions. Il y a influence réciproque et c’est cela qui va permettre à nos sociétés d’avoir un grand engagement social à partir du XXe siècle.
Sans s’attarder sur le développement ultérieur de la démocratie chrétienne, on peut insister sur l’éclosion des mouvements d’action catholique, en particulier la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, fondée par Joseph Cardijn, prêtre de Bruxelles. Là, c’est l’idée qu’il ne suffit pas d’avoir des superstructures, syndicats, relais politiques, mais qu’il faut qu’à la base l’être humain soit éduqué et donc l’ouvrier doit être accompagné : jeunesse ouvrière chrétienne. Elle donnera un lieu de formation permanente à des jeunes du monde ouvrier et les préparera à leur action sociale future. Non seulement c’est nouveau au niveau du concept car on réunit des gens sur la base de leur classe sociale, ouvrière, et non sur la base de leurs paroisses. Donc, c’est nouveau d’un point de vue interne à l’Eglise, mais c’est nouveau aussi en tant qu’association non territoriale, n’étant plus basée sur la paroisse mais sur un objectif social.
C’est ainsi que, plus tard, les papes vont préciser la doctrine sociale de l’Eglise : pour le quarantième anniversaire de Rerum Novarum, Pie XI publie Quadragesimo anno, en 1931, au moment le plus grave de la grande crise initiée par le crash de Wall Street en 1929. Jean XXIII écrira Mater et magistra en 1961. Le Concile Vatican II, dans la constitution Gaudium et spes, va reprendre les différents éléments dont il fait un peu la théorie, la théologie complète, avec la notion de dignité de la personne humaine, le sens de la justice sociale et il y ajoutera la question du développement des peuples, en particulier des nations pauvres. Paul VI reprend ce sujet dans Populorum progressio(1967). Jean-Paul II rédige trois encycliques sociales : Laborem exercens (pour les 90 ans de Rerum Novarum, en 1981) où il insiste sur la valeur et le sens du travail, lui qui avait été travailleur, Sollicitudo rei socialis (1988), Centesimus annus(pour les 100 ans de Rerum Novarum, en 1991) dans laquelle, pour la première fois, un pape se prononce en faveur de la licéité du système capitaliste, car jusque-là la notion de libéralisme sous-jacente au système capitaliste était condamnée par l’Eglise, parce que le libéralisme suppose la liberté absolue et que, pour l’Eglise, la liberté absolue implique de méconnaître le mal, c’est la liberté de faire le mal et ce n’est pas possible. Donc l’Eglise a toujours été méfiante à l’égard du libéralisme et en particulier quand elle a vu les méfaits du libéralisme économique. Elle pensait aussi au libéralisme idéologique. Mais Jean-Paul II, ayant vécu dans un contexte communiste et ayant vu les catastrophes sociales du communisme, dit : « on ne peut pas chercher une troisième voie ; l’économie fonctionne avec le profit, c’est normal ; il faut donc reconnaître la licéité du système capitaliste libéral tout en le corrigeant par les notions de bien commun, du contrôle légal, de la justice sociale, etc. ». Benoit XVI a écrit Caritas in veritatedans laquelle il met l’accent sur l’engagement personnel des croyants, du chrétien de sensibilité sociale, c’est-à-dire que Benoît XVI insiste sur le fait qu’il ne suffit pas de donner une contribution à une collecte mais il faut avoir aussi un engagement personnalisé.
Et voilà que notre nouveau pape, François, nous adresse aujourd’hui cette exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Voici quelques titres de certains paragraphes : « non à une économie de l’exclusion », donc une économie qui exclut les pauvres, c’est un grand thème cher au pape, ce qu’il appelle avec un terme inhabituel chez nous « l’idéologie du déchet », c’est-à-dire de l’être humain qui est jeté, celui dont on a utilisé le travail à moment donné et que l’on met au chômage ensuite : il est jeté. Le pape critique donc cette culture du déchet qui résulte d’une recherche de la rentabilité. Autre paragraphe : « Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent » ; François y est très sensible, il parle même de « crise anthropologique profonde ». A cause de la prédominance du souci de l’argent, nous avons renié le primat de l’être humain, nous avons créé de nouvelles idoles. Cette orientation anthropologique réduit l’être humain à un seul de ses besoins : la consommation. Autre paragraphe : « Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir » ; en ce sens, dit-il « j’exhorte les experts financiers et les gouvernements des différents pays à considérer sérieusement les paroles d’un sage de l’Antiquité : ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c’est les voler et leur enlever la vie. (Jean Chrysostome) ». Faire « une réforme financière qui n’ignore pas l’éthique demanderait un changement vigoureux d’attitude de la part des dirigeants politiques. Je les exhorte à affronter ce défi avec détermination et clairvoyance. L’argent doit servir et non pas gouverner ». Autre titre : « Non à la disparité sociale qui engendre la violence ». Là nous sentons l’homme qui a été dans les grandes banlieues des métropoles latino-américaines où sévissent les fameuses bandes de jeunes qui assaillent les gens. C’est donc l’insécurité totale à cause de ces bandes de jeunes vivant souvent de la drogue et qui assassinent à tort et à travers, mais le pape dénonce la disparité sociale qui est à la base de cette violence. Et enfin : « la place privilégiée des pauvres dans le peuple de Dieu ». Il reprend là des thèmes développés dans la première partie de cet exposé. Il propose une économie avec une redistribution des revenus. Voilà : on retrouvera dans cette Exhortation apostolique des pages consacrées à cette dimension sociale très précise qui tient tout particulièrement chère au cœur de notre nouveau pape, avec beaucoup de précision sur certains concepts, notamment le concept d’être humain « jeté », de l’argent qui domine tout…
Avec cela, je crois que je dispose d’une conclusion toute préparée, je n’aurais pu rêver mieux en préparant cette conférence. Le texte n’est arrivé qu’aujourd’hui à midi et je suis heureux de pouvoir vous le proposer. Merci de votre attention.
______________
Quelques références bibliographiques sur le sujet :
•Jean-Pierre Delville, Martin de Tours. Du légionnaire au saint Évêque, Edition Basilique Saint-Martin et MARAM, 184 p., Liège, 1994 (direction scientifique).
•Jean-Pierre Delville, Fête-Dieu (1246-1996). 2. Vie de sainte Julienne de Cornillon. Édition critique par •Jean-Pierre DELVILLE, Publications de l'Institut d'Études Médiévales, 282 p., Louvain-la Neuve, 1999.
•Jean-Pierre Delville,Réseaux démocrates chrétiens et appuis pontificaux. L’action de Mgr Antoine Pottier (1849-1923) à Rome, sous Léon XIII et Pie X, dans La papauté contemporaine (19e-20e s.) – Il papato contemporaneo (Secoli XIX-XX), Jean-Pierre Delville et Marko Jacov (éd.), avec la collaboration de L. Courtois, Françoise Rosart et Guy Zélis (Collectanea Archivi Vaticani, 68 – Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique, 90), Rome - Louvain-la-Neuve, juin 2009, p. 195-228. — Jean-Pierre Delville, Un intellectuel au cœur de la question sociale : Mgr Antoine Pottier à Rome de 1905 à 1908, dans Dries Vanysacker, Pierre Delsaerdt, Hedwig Schwall et Jean-Pierre Delville (éd.), The quintessence of lives. Intellectual Biographies in the Low Countries presented to Jan Roegiers, (Bibliothèque de la RHE, 91), Leuven-Turnhout-LLN, 2010, p. 445-468. — Jean-Pierre Delville, Antoine Pottier (1849-1923), le « docteur de la démocratie chrétienne » : ses relations internationales jusqu’à son exil à Rome (1902), dans G. Zélis, (éd.), Les intellectuels catholiques en Belgique francophone aux 19e-20e siècles, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2010, p. 209-260.
•Paul Gerin, Les origines de la Démocratie chrétienne à Liège (Études sociales 14 à 17), Liège-Paris, 1958, p. 6 •Paul Gerin, Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914) (Cahiers des Études sociales), Bruxelles, 1959.
•Paul Gerin, L’abbé Antoine Pottier, un maître à penser et à suivre, dans Grand Séminaire de Liège. 1592-1992, éd. par J.-P. Delville, Liège, 1992, p. 149-168.
•Paul Gerin, Les prêtres ouvriers, dans Liège, Histoire d’une Église, 4, éd. par J.-P. Delville, Strasbourg, 1995, p. 35-36.
•Paul Gerin, Banneux Notre-Dame, dans Liège, Histoire d’une Église, 4, éd. par J.-P. Delville, Strasbourg, 1995,
•Jean-Louis Jadoulle, La pensée de l’abbé Pottier (1849-1923). Contribution à l’histoire de la Démocratie chrétienne en Belgique, Louvain-la-Neuve, 1991. –
•René Rutten, Histoire critique des apparitions de Banneux, Namur, 1985.
•Een kantelend tijdperk. Une époque en mutation (1890-1910), éd. par Emiel Lamberts, Kadoc, Leuven, 1992.
•La jeunesse ouvrière chrétienne : Wallonie-Bruxelles 1912-1957,Bruxelles, Vie ouvrière, 1990.
|
Prochain lunch débat:

Le 12 mars 2014 à 18h00, Université de Liège, bâtiment du Rectorat, salle des professeurs, Place du XX août, 7, 1et étage :
Ecologie de la nature et écologie de l’homme
Une réflexion à la lecture du discours du pape Benoît XVI au Bundestag (Berlin, septembre 2011)

avec Jean-Michel Javaux, ancien co-président du parti Ecolo
Le débat sera modéré par Paul Vaute, chef d’édition de "La Libre Belgique-Gazette de Liège"
Renseignements et inscriptions (réservations obligatoires avant le 7 mars) :
par email adressé à info@ethiquesociale.org ou par téléphone. 04.344.10 .89
|
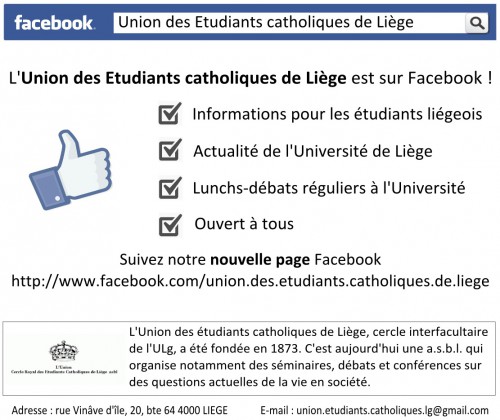
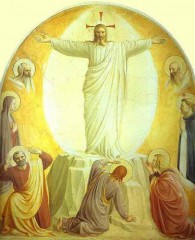 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène, à l’écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu’une voix disait de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s’approchant, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n’ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de l’homme ne ressuscite d’entre les morts. » (Mt 17, 1-8)
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène, à l’écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu’une voix disait de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s’approchant, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n’ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de l’homme ne ressuscite d’entre les morts. » (Mt 17, 1-8)

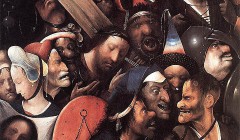 Rien ne fâche plus la société d’aujourd’hui que la conception chrétienne de la souffrance. Compatir et soulager la peine font, certes, partie du message de l’Evangile mais, comme le dit si bien l’ « Imitation de Jésus-Christ» (XVe s.) : « disposez de tout selon vos vues, réglez tout selon vos désirs, et toujours vous trouverez qu'il vous faut souffrir quelque chose, que vous le vouliez ou non ; et ainsi vous trouverez toujours la Croix. ».
Rien ne fâche plus la société d’aujourd’hui que la conception chrétienne de la souffrance. Compatir et soulager la peine font, certes, partie du message de l’Evangile mais, comme le dit si bien l’ « Imitation de Jésus-Christ» (XVe s.) : « disposez de tout selon vos vues, réglez tout selon vos désirs, et toujours vous trouverez qu'il vous faut souffrir quelque chose, que vous le vouliez ou non ; et ainsi vous trouverez toujours la Croix. ».

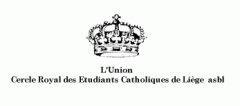




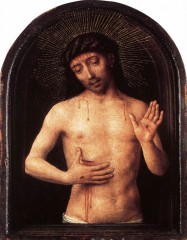


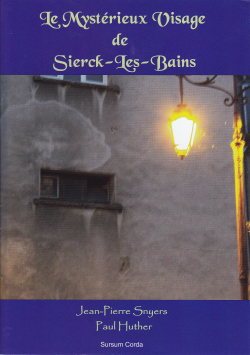 On y découvre, là où il n’y avait qu’une tache d’humidité, l’apparition d’un visage sur le pignon d’une maison, visage dont les traits évoquent très précisément celui du Christ tel que nous le connaissons à travers l’iconographie chrétienne.
On y découvre, là où il n’y avait qu’une tache d’humidité, l’apparition d’un visage sur le pignon d’une maison, visage dont les traits évoquent très précisément celui du Christ tel que nous le connaissons à travers l’iconographie chrétienne.

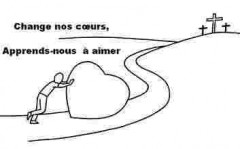
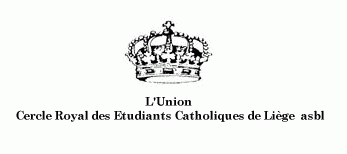






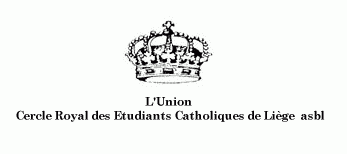

 Le nouvel évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, a inauguré un nouveau cycle de lunchs débats à l’Université de Liège. Le cycle est organisé par le groupe « éthique sociale » de l’Union des étudiants catholiques, sur le thème « Humanisme chrétien, Travail et Société ».
Le nouvel évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, a inauguré un nouveau cycle de lunchs débats à l’Université de Liège. Le cycle est organisé par le groupe « éthique sociale » de l’Union des étudiants catholiques, sur le thème « Humanisme chrétien, Travail et Société ».





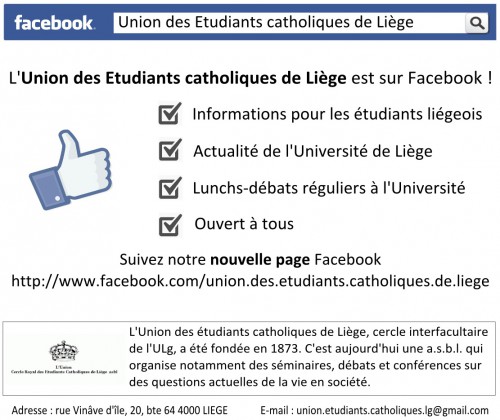


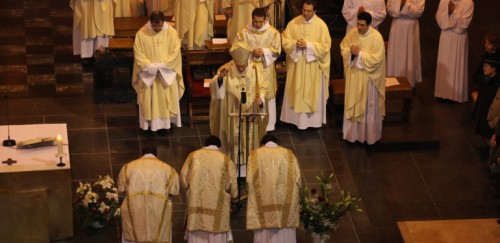

 Le texte reproduit ci-dessous était destiné à « La Libre Belgique » qui, à ce jour, n’a pas donné signe de vie. Son auteur, Louis-Léon Christians, est docteur en droit et docteur en droit canonique. Professeur à la faculté de théologie de l’université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), il dirige la chaire de droit des religions. L’auteur s’exprime ici à titre personnel :
Le texte reproduit ci-dessous était destiné à « La Libre Belgique » qui, à ce jour, n’a pas donné signe de vie. Son auteur, Louis-Léon Christians, est docteur en droit et docteur en droit canonique. Professeur à la faculté de théologie de l’université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), il dirige la chaire de droit des religions. L’auteur s’exprime ici à titre personnel :