
BREVE HISTOIRE DU SACREMENT DE PENITENCE (II)

Pour construire l’étude qu’il consacre à cette « Une brève histoire du sacrement de pénitence », Pierre-René Mélon a choisi, comme guide privilégié de son voyage dans le temps, la monumentale « Histoire des sacrements/ De sacramentis in genere », de Dom Charles-Mathias Chardon, osb, parue à Paris en 1745 et rééditée en 1841 chez Drouin (dernière édition connue) : elle est accessible sur le site de la Bibliothèque nationale de France http://gallica.bnf.fr
Pour une approche plus théologique, notre collaborateur se réfère aussi à Henri Rondet, s.j. « Esquisse d’une histoire du sacrement de la pénitence », in « Nouvelle revue théologique », Bruxelles, 1958, tome 80/6, pp.562-584, également disponible à l’adresse http://www.nrt.be ainsi qu’à Paul Galtier,s.j. : « Aux origines du sacrement de pénitence », Rome, Université grégorienne, 1951.
Dans une première partie de son exposé, publiée dans le n° précédent de « Vérité et Espérance –Pâque Nouvelle (n° 99, 2e trim. 2016, pp. 8 à 12), Pierre-René Mélon s’est attaché aux sources scripturaires du sacrement, à ses fondements théologiques et à leurs premières contestations (hérésies et déviances). Puis il aborde l’histoire du premier élément qui le constitue : l’aveu de la faute, sa « confession », dont il poursuit l’analyse dans le présent numéro. Viendront ensuite la démarche de repentir et de pénitence, l’absolution sacramentelle qui accorde le pardon au pécheur et l’amour de Dieu qui réconcilie.
Jean-Paul Schyns
Où et comment se confessait-on ?
Aux premiers temps de l’Eglise, la confession publique se fait dans l’église, la chapelle ou l’oratoire, à genoux ou prosterné par terre, couvert de sac et de cendre, face à l’autel, en présence de l’évêque et des prêtres, et quelquefois même du clergé et du peuple aux prières duquel le pénitent se recommandait. L’aspect extérieur de cette pratique manifeste bien que la pénitence est considérée comme une espèce de tribunal. Avant d’absoudre les pécheurs, l’évêque commence par les ranger au nombre des accusés ; avant de les délier, il commence par les lier (comme on l’a vu faire par S. Paul). Cette procédure pourrait nous déconcerter si un Augustin ne nous expliquait que les médecins aussi font des ligatures, lorsqu’ils veulent guérir un membre malade.[1]
La confession auriculaire se faisait assis, de préférence dans l’église ou dans un lieu consacré ; elle était suivie et précédée de génuflexions et de prostrations tant du pénitent que du confesseur. La position assise était nécessaire en ce temps où les confessions duraient longtemps (n’étant pas aussi fréquentes qu’aujourd'hui), tant à cause du détail des mauvaises actions qui était très précis, qu’à cause des peines que l’on imposait suivant les canons à chaque espèce de péché, comme nous le verrons par la suite. Ceux qui avaient été une fois soumis à la pénitence publique pour des crimes soit notoires, soit cachés, ce qui était ordinaire avant le septième siècle, n’y étaient plus reçus ; ce qui rendait la confession assez rare, les chrétiens étant sur leur garde pour ne pas tomber dans ce malheur.

Précisons que les confessionnaux ne sont apparus dans les églises qu’à partir du XVIe siècle, suite au concile de Trente (1545-1563) et au grand mouvement de fond de la Contre-réforme catholique ; il s’agissait de revaloriser le sacrement de pénitence contesté par le protestantisme. Le confessional est ainsi devenu le lieu privilégié (mais pas unique) du sacrement de pénitence ; en fonction des circonstances (campagne militaire, navigation, pèlerinage, etc.) les confessions pouvaient être aussi entendues en plein air.
Alcuin, précepteur de Charlemagne, a inséré dans son Livre des divins offices un long chapitre qui peut tenir lieu de pénitentiel abrégé. Dans ce précieux document, on trouve plusieurs particularités remarquables sur la manière dont le sacrement de pénitence était vécu au VIIIe siècle. Le pénitent doit approcher du prêtre à qui il veut se confesser « avec un air modeste, faisant paraître l’humilité et la componction dans tout son extérieur ; il doit mettre bas le bâton qu’il tient à la main (cela doit s'entendre aussi d’une épée et de toute autre chose qui donne du relief) ». [On n’est jamais assez prudent.] Arrivé à portée du prêtre, le pénitent s’inclinait profondément devant lui, celui-ci disait sur lui des prières ; après quoi il le faisait asseoir près de lui et entendait sa confession. La confession étant achevée, le prêtre donnait au pénitent les avis dont il avait besoin, et l’interrogeait ensuite sur sa foi et sa connaissance du catéchisme. Ensuite, poursuit Alcuin, « le pénitent mettant les genoux en terre, étendant les mains, et regardant le prêtre avec un visage qui marquait la douleur de ses fautes, il le conjurait, comme ministre de la réconciliation des hommes avec Dieu, d’intercéder pour lui. Puis il se prosternait entièrement en terre, pleurait et gémissait autant que Dieu lui en faisait la grâce : le prêtre le laissait quelque temps en cet état le voyant touché de l’esprit de componction ; après quoi il lui ordonnait de se lever et de se tenir debout et lui prescrivait les jeûnes et les abstinences par lesquelles il devait expier ses péchés » ; cela fait, le pénitent se prosternait de nouveau aux pieds du confesseur, le priant de demander à Dieu pour lui la force et le courage nécessaires pour accomplir la pénitence qui lui était imposée. Le prêtre aussitôt récitait plusieurs prières, au nombre de sept, dont Alcuin ne rapporte que le commencement parce qu’elles étaient alors connues et d’un usage ordinaire, étant à peu près les mêmes dans tous les livres pénitentiaux reçus en Occident. Ces prières achevées, il faisait lever le pénitent, se levait lui-même de son siège et si le temps et le lieu étaient convenables, l’un et l’autre fléchissant les genoux, ou appuyés sur les coudes, récitaient plusieurs psaumes et prières.
La coutume de se confesser à genoux fut introduite vers le XIIe siècle, à l’exemple principalement des Chartreux. On pourrait y ajouter celui des moines de Cîteaux qui ne se confessaient qu’avec les épaules nues, et des verges à la main, dont le confesseur frappait parfois le pénitent – souvent à sa demande – avant de l’absoudre.
Confessions écrites
En cas de nécessité, il n’était pas rare qu’un pénitent rédige une confession écrite de ses fautes et l’adresse au confesseur.
Robert, évêque du Mans au IXe siècle, mortellement malade, confesse par écrit ses péchés aux Pères du concile de Douzi, qui était assemblé sous le pape Jean VIII et leur demande l’absolution, étant éloigné d’eux de vingt milles (environ cent km). Voici les dernières paroles de l’écrit qu’il leur envoie : J'implore avec des sanglots votre miséricorde, afin que vous me délivriez des liens de mes péchés, par le pouvoir qui vous a été donné du ciel, et que par vos prières vous m'obteniez l'expiation de mes fautes, et que je ne sois pas conduit avec les réprouvés aux enfers, mais que j'entre dans la joie céleste avec les bienheureux. Les Pères du concile lui accordèrent ce qu’il demandait, et lui envoyèrent une lettre d’absolution, epistola absolutionis, dans laquelle, après avoir parlé de la vertu et de l’efficacité de la confession des péchés, ils lui donnèrent l’absolution.
Le pape Grégoire VII (1073-1085), écrivant à l’évêque de Liège suite à quelques plaintes sur des pratiques de simonie, après l’avoir exhorté à extirper la fornication de son clergé, conclut sa lettre en ces termes : « Et parce que vous êtes à l’extrémité, touchés de la compassion paternelle, nous vous donnons l’absolution par l’autorité des apôtres S. Pierre et S. Paul, et prions le Seigneur que par leur intercession vous soyez digne d’entrer dans la compagnie des élus ».
Saint Thomas Becket en 1164, en pleine querelle avec le roi Henri II d’Angleterre, reçoit par lettre l’absolution du pape Alexandre III alors à Sens.
C’est le pape Clément VIII (1592-1605) qui mettra un terme définif aux confessions par écrit, car il craignait avec raison qu’on fasse insensiblement passer en coutume ce qui ne s’était fait que rarement autrefois, et que par là on affaiblisse le sacrement de la pénitence.
Quand devait-on se confesser ?
La période privilégiée pour se confesser était évidemment le début du carême, de préférence le dimanche et à l’église. Certains évêques ont obligé leur ouailles à se confesser trois fois pendant l'année. Ainsi Crodegrand, évêque de Metz au huitième siècle, ordonne au peuple de faire sa confession aux prêtres trois fois par an, au moins.
On se confessait aussi chaque fois que la vie était en danger : avant d’entreprendre de longs voyages ou pèlerinages ou, pour les soldats, avant les batailles, voire avant de s’engager dans l’état militaire. Ingulphe, abbé de Crowland (+1109), nous en assure en ces termes : C’était l’usage en Angleterre que celui qui devait se consacrer à une milice légitime, vint trouver la veille sur le soir, l’évêque, un abbé, un moine ou quelque prêtre ; qu’il lui fît une confession de tous ses péchés avec des sentiments de componction, et qu’ayant été absous, il passât la nuit dans l’église à prier et à s’affliger dévotement devant Dieu. Le lendemain avant d’entendre la messe, il posait son épée sur l’autel, et le prêtre après l’évangile, la lui mettait au col en le bénissant. Il communiait ensuite à la messe, et il devenait ainsi soldat MILES LEGITIMUS MANERET. Ingulphe remarque que cet usage déplaisait aux Normands qui conquirent l’Angleterre...
Autres exemples : Saint-Omer étant assiégée par les Normands (en 861), les habitants pour obtenir le secours de Dieu se purifièrent par la confession et la communion.
Guillaume de Malmesbury, moine bénédictin (+1143), loue la piété des soldats Normands, qui avant de combattre les Anglais, passèrent toute la nuit à confesser leurs péchés.
Le duc Conrad, étant sur le point de livrer bataille aux Hongrois en l’an 955, entendit la messe et reçut la communion de la main d’Odelric son confesseur, après quoi il marcha contre l’ennemi, comme le témoigne la chronique de Magdebourg. On pense aussi bien sûr à Sainte Jeanne d’Arc (+1431) qui, en campagne militaire, ne manquait jamais de se confesser et d’assister à la messe dès qu’elle le pouvait.
La confession des femmes

A propos de la confession des femmes, il est bon de préciser qu’elle devait se tenir dans un lieu à portée de vue de tout le monde, afin d’éloigner tout soupçon. S. Edmond de Cantorbéry (+ 1242), dans ses constitutions, ordonne qu’on entende les confessions des femmes dans un endroit public, à portée de la vue et non de l’ouïe. Le concile de Béziers (can. 46) en 1246 défend d’entendre les confessions dans un lieu caché ou hors de portée de la vue.
Guigue le Chartreux (+1136) remarque dans la vie de S. Hugues, évêque de Grenoble (1132), qu’il recevait les confessions des femmes avec autant de précaution que de bonté, non dans des coins ou dans des endroits secrets et obscurs, mais dans ceux où il pouvait être vu de tout le monde. « Il leur prêtait familièrement l’oreille, mais il détournait sa vue d’elles et la portait au côté opposé, disant qu’il ne fallait se servir que de l’ouïe en ces occasions, pour éviter les pièges du diable. »
Un concile à Cologne en 1280 va plus loin. Il défend, sous peine d’excommunication, d’entendre les confessions d’une femme qui serait seule dans l’église, ou dans un endroit obscur et ténébreux ; il exige que les prêtres, quand ils confessent, soient assis, revêtus de leur surpli ou de leur chape, ayant l’étole par-dessus ; de plus, il leur interdit de confesser avant le lever du soleil et après son coucher, sinon en cas d’urgence, mais dans un lieu éclairé et en présence de témoins.
Nécessité faisant loi, un concile de Paris, en 829, permet, en cas d’infirmité qui empêche de se déplacer jusqu’à l’église, qu’on puisse se confesser dans les maisons particulières, mais toujours en présence de témoins qui ne soient pas éloignés.
À qui se confessait-on?
Il semble évident aujourd’hui qui faille se confesser à un prêtre (qu’il soit évêque, moine ou séculier) et à personne d’autre. Il n’en fut pas toujours ainsi. Jacques de Baradée[2] et ses disciples pensaient qu’il n’est pas nécessaire de se confesser à un prêtre, il suffit de se confier à Dieu. Cette hérésie née au VIe siècle sera reprise à la fin du VIIIe siècle et réfutée par Alcuin. Sous le pontificat de Zacharie (de 741 à 752), un certain Adalbert disait à ceux qui venaient se prosterner à ses pieds pour confesser leurs péchés : « Je sais vos péchés, parce que le fond de vos coeurs m’est connu ; c'est pourquoi il n’est pas besoin que vous les confessiez : retournez donc dans vos maisons avec assurance et avec l’absolution de vos fautes passées ».
Plus tard, cette opinion fut partagée par les Albigeois, les Vaudois et les protestants. Certains prêtres anglais, au début du XIVe siècle, prétendaient que la confession générale du début de la messe suffisait pour effacer les péchés mortels.
Quoique la puissance de lier et de délier soit inséparable du sacerdoce, tous les prêtres ne sont pas en droit de l’exercer, car si c’est de Jésus-Christ que les prêtres tiennent cette puissance, c’est à l’Église qu’il revient d’en régler l’usage. Ainsi le code de droit canonique en vigueur depuis 1983 précise que la faculté d’entendre les confessions ne sera concédée qu’à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen (can. 970). Par ailleurs, la faculté d’entendre les confessions est concédée par écrit (can. 973) ; elle peut être aussi retirée par l’évêque pour une juste cause (ou supposée telle)[3].
Origène, quant à lui, liait expressément le pouvoir de donner l’absolution à la sainteté personnelle du prêtre ; si le prêtre est indigne, le sacrement n’est pas valide. Voici son argument : Ceux qui revendiquent la dignité de l’épiscopat enseignent que ce qu’ils lient est lié dans les cieux, et ce qu’ils remettent est remis dans les cieux. Mais nous disons qu’ils parlent saintement à condition qu’ils fassent l’œuvre pour laquelle il a été dit à Pierre : Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les portes de l’Enfer ne prévaudront pas sur celui qui veut lier et délier. Mais s’il est lui-même lié des liens du péché, c’est en vain qu’il lie et délie.[4]
Dans la primitive Église, c’était devant l’évêque, comme nous l’avons vu, et quelquefois devant lui et toute la communauté des prêtres (qu’on appelait le sénat ou le presbytérium) que se faisait la confession. Cet usage de se confesser à plusieurs prêtres ensemble a été progressivement abandonné, car l’évêque et le sénat des prêtres étant trop accaparés par d’autres occupations, on établit un prêtre, le pénitencier, dont l’emploi spécifique était d’entendre les confessions.
C’est à Constantinople au IVe siècle que l’institution du prêtre pénitencier est attestée ; il était chargé de recevoir les aveux des pénitents et de diriger leurs exercices de pénitence pour la « satisfaction » des péchés. Pour la confession secrète, les pénitents devaient donc s’adresser obligatoirement au pénitencier local, et à nul autre prêtre. En occident, le recours à l’évêque seul pour recevoir l’aveu des péché et donner la réconciliation a persisté jusqu’au Ve siècle.
Ahyton, évêque de Bâle au temps de Charlemagne, était si pointilleux sur ce point qu’il voulait que ceux qui vont en pèlerinage à Rome, confessent leurs péchés avant leur départ : parce que, ajoute-t-il, ils doivent être liés ou déliés par leur propre évêque ou par leur propre pasteur, et non par un étranger ; mettant ainsi le pape lui-même au nombre des étrangers.
C’est des moines bénédictins que viendra le changement. En effet, en Irlande, les abbés des monastères, qui étaient de simples prêtres, avaient le pouvoir de confesser leurs moines ; saint Colomban (+615), évangélisateur des Gaules, qui confessa beaucoup, n’était pas évêque, mais prêtre, comme le rappelle Bède le Vénérable.[5] A l’époque carolingienne, sous l’influence de ces moines irlandais le prêtre est devenu le ministre ordinaire de la pénitence, et c’est lui qui absout les pécheurs, mais l’évêque reste le ministre ordinaire de la pénitence publique, qui se fait toutefois de plus en plus rare
Querelles avec les confesseurs itinérants

Mais les croisades (accompagnées par des prêtres) et surtout la naissance au XIIIe siècle des ordres mendiants (donc itinérants) ont introduit des changements notables dans cette pratique. Le zèle apostolique des franciscains et surtout des dominicains les poussait à vouloir entendre les confessions des fidèles sans avoir besoin pour cela de l’agrément des pénitenciers, dont la formation théologique, pastorale (et psychologique, comme nous dirions aujourd’hui) laissait souvent fortement à désirer... Les frères Prêcheurs (dominicains) sollicitèrent pour cela une bulle du pape Grégoire IX. Elle leur fut accordée en 1227. Cette bulle est adressée à tous les évêques et aux clercs supérieurs ecclésiastiques : Nous vous prions et vous enjoignons de recevoir favorablement les frères de cet ordre pour la prédication à laquelle ils sont destinés ; et d'exhorter les peuples, dont vous avez la conduite, à les écouler, puisque par notre autorité il leur est permis d'entendre les confessions et d'imposer des pénitences.
Cet empressement des frères Prêcheurs pour la prédication et les confessions, aussi bien que la bulle du Pape qu’ils venaient d'obtenir, déplurent à beaucoup d’hommes d’Eglise importants ; il leur semblait que par ces nouveaux privilèges on troublait l’ordre établi dans l’Eglise par les saints apôtres et les docteurs des siècles passés, et que l’on détruisait l’autorité des pasteurs en donnant d’eux l’image d’hommes incapables ou incompétents. De plus, les décisions du 4e concile du Latran (1215) semblaient leur donner raison en confirmant les droits des prêtres locaux dans leurs prérogatives[6]. Les frictions n’étaient donc pas rares entre les autorités locales et les frères prêcheurs qui se prévalaient fièrement de leurs droits et privilèges accordés par le Saint-Siège.
L’historien Matthieu Paris[7] rapporte que « les frères Prêcheurs, se sentant ainsi appuyés par la cour de Rome, montraient avec ostentation ces privilèges, et demandaient qu’on en fît la lecture dans les églises ». Il raconte aussi qu’ils « demandaient avec impudence à ceux qu’ils rencontraient : Avez-vous été à confesse ? Et si on leur répondait qu’oui, ils reprenaient : A qui ? Que si on leur disait, à mon pasteur, ils traitaient le curé d’idiot, qui n’avait jamais étudié dans les écoles de théologie, ni dans celles de droit, qui n’était pas capable de résoudre une seule question, et disaient : « Venez à nous qui avons appris à distinguer la lèpre de la lèpre, à qui les choses les plus difficiles et les secrets de Dieu ont été découverts. Confessez-vous sans crainte à nous, à qui on a accordé, comme vous voyez, une si grande puissance. Il arrivait donc, poursuit l’historien Anglais, que plusieurs, surtout des nobles et des dames, se confessaient aux frères Prêcheurs, méprisant leurs propres pasteurs, et même les prélats ».
L’historien relate aussi un vif incident survenu dans une église en Angleterre.
« Il arriva que quelques-uns des frères Prêcheurs entrèrent dans l’église de S. Alban, pendant que l’archidiacre tenait un synode à l’ordinaire. Ils avaient entre les mains des copies de leurs privilèges, et l’un d’entre eux, qui paraissait quelque chose de plus que les autres, fit signe d’un air impérieux qu’on eût à écouter sa prédication. L’archidiacre lui répondit : Agissez, mon frère, avec plus de modération, attendez un peu que je vous fasse connaître ce que je pense. Nous qui sommes simples et accoutumés aux mœurs antiques, nous ne pouvons qu’être surpris de cette nouveauté ; et il n’est pas surprenant que de telles nouveautés nous étonnent. Pourquoi dites-vous sans pudeur que nous sommes indignes des emplois qui nous ont été confiés ? Vous vous imaginez être les seuls du nombre des élus, cependant personne ne sait s’il est digne d’amour ou de haine. Vous vous ingérez non seulement dans la prédication, mais encore dans les confessions que vous extorquez des fidèles, en sorte qu’il semble qu’il faudra vous appeler dans la suite non seulement Frères Prêcheur, mais encore Frères Confesseurs. Mes frères, je ne crois pas qu’il soit à propos de quitter le certain pour l’incertain, et que vous deviez, sans une mûre délibération et sans le conseil de votre prieur, prêcher et entendre les confessions de ceux sur lesquels l’abbé de ce monastère m’a préposé. Cela est constant par les décrets qui ont été publiés dans le concile général célébré sous Innocent III, lesquels doivent être inviolablement observés dans tous les temps. L’archidiacre ayant ainsi parlé ouvrit le Livre, et lit la Décrétale qui contient le règlement du concile de Latran, avec ces paroles qui suivent immédiatement : C'est pourquoi nous voulons que ce décret salutaire soit souvent publié dans l’église, afin que personne ne puisse s’en excuser sous prétexte d'ignorance. Que si quelqu’un pour de justes raisons veut se confesser à un prêtre étranger, alieno sacerdoti, qu’il demande auparavant la permission, et qu’il l’obtienne de son propre prêtre, a proprio sacerdote, puisqu’autrement il ne peut l’absoudre ni le lier. »
Ces incessantes querelles de pouvoir – hélas fréquentes dans l’Eglise – ne s’apaiseront que peu à peu au fil des siècles : les « prêtres étrangers » ne seront admis à confesser qu’en accord (implicite ou explicite) avec le curé ou l’évêque local. Que de troubles inutiles pour en arriver à des dispositions de simple bon sens et de charité !
Diacres, baptisé(e)s, reliques...
Pour terminer ce long chapitre sur les ministres de la pénitence, précisons qu’en cas de nécessité, avec l’accord de l’évêque, un diacre pouvait entendre la confession et donner l’absolution. « Il faut aller au-devant des besoins de nos frères, dit S. Cyprien (épître 13); nous permettons donc que ceux qui ont reçu des libelles de recommandation des martyrs, et qui peuvent être aidés par là auprès de Dieu, s’ils viennent à être attaqués de quelques maladies ou infirmités dangereuses, puissent, sans attendre notre arrivée, confesser leurs fautes auprès de quelque prêtre que ce puisse être, et même d’un diacre, si le danger est pressant, afin que leur ayant imposé la main pour la pénitence, ils aillent ainsi en paix au Seigneur ».
Il résulte de plusieurs témoignages semblables que les diacres ont pu entendre les confessions dans l’église d’Occident jusqu’à la fin du treizième siècle en cas de nécessité. Suite à des abus, des évêques et des synodes ont pris des mesures pour interdire cette pratique.
Plus étonnant, il était permis, en cas d’urgence ou de nécessité, de se confesser à un simple baptisé.
Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, écrit que « s’il ne se trouve point d’ecclésiastique à qui l’on puisse se confesser, on doit s’adresser à un homme de bien dans quelque endroit qu’il soit ».
Ainsi un soldat, blessé à la guerre, peut se confesser à ses compagnons ; des voyageurs en péril sur la mer, se confessent les uns aux autres.
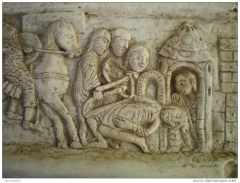
Le sire de Joinville[8] raconte, au chapitre 45 de la vie de saint Louis, que l’armée chrétienne ayant été mise en fuite par les Sarrasins, et l’ennemi s’approchant, chacun se confessa au prêtre qu’il put trouver, et, qu’en cette occasion, Gui d’Ébelin, connétable de Chypre, s’étant confessé à lui, il lui avait donné l'absolution.
Dans la même logique théologique, il ne faut pas s’étonner qu’un chevalier en danger de mort pût se confesser à son épée si celle-ci contenait la relique d’un saint.
On rapporte aussi d’étranges coutumes pratiquées en Afrique. Les Coptes et les Ethiopiens, sous l’influence de l’hérésie jacobite[9], ne confessaient pas leurs péchés aux prêtres, mais à Dieu seul et en secret ; pour ce faire, ils déposaient de l’encens sur une braise, et s’imaginant que leurs péchés montaient devant le Seigneur avec le parfum de l’encens brûlé, ils se confessaient sur la fumée qui montait vers le ciel...
Pierre René Mélon
(à suivre...)
[1] H. Rouget, op. cit. p. 569.
[2] Evêque d’Edesse au VIe siècle (aujourd’hui Urfa, en Turquie orientale).
[3] On ne peut s’empêcher d’évoquer le cas de S. Pio, à qui il fut interdit de confesser pendant trois ans...
[4] Commentaires sur Matthieu, XII, 14, cité par J. Daniélou, op. cit., p. 83.
[5] Bède, dans son Histoire ecclésiastique du peuple anglais, III, 4.
[6] En voici le texte principal : Que tous les fidèles de l’un et de l’autre sexe, sitôt qu'ils auront atteint l'âge de discrétion, confessent fidèlement tous leurs péchés à leur propre pasteur, en particulier, au moins une fois chaque année, s’appliquant à accomplir, autant que leur force leur permet, la pénitence qui leur est jointe, et recevant avec respect, au moins à Pâques, le sacrement d’Eucharistie, s’ils ne s’en abstiennent pour quelque cause raisonnable par l’avis de leur pasteur, autrement que l’entrée de l’Église leur soit défendue pendant leur vie, et qu’ils soient privés de la sépulture des chrétiens après leur mort (can. 21).
[7] Historia Angliæ, ad ann. 1246.
[8] Joinville : 1224-1317.
[9] Issue de Jacques Baradée, évêque d’Edesse au VIe siècle.
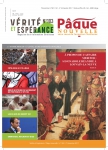

 C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher
C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher



 « Le 7 juillet 2007, Benoît XVI signait Summorum Pontificum, « lettre apostolique en forme de Motu proprio sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 ». Texte historique dont l’importance n’a sans doute pas été encore appréciée à sa juste valeur, tant il dénoue une situation inextricable qui va au-delà de la seule question des traditionalistes attachés à l’ancienne forme liturgique. Même si contribuer à régler cette question épineuse a bien été aussi l’une de ses fins.
« Le 7 juillet 2007, Benoît XVI signait Summorum Pontificum, « lettre apostolique en forme de Motu proprio sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 ». Texte historique dont l’importance n’a sans doute pas été encore appréciée à sa juste valeur, tant il dénoue une situation inextricable qui va au-delà de la seule question des traditionalistes attachés à l’ancienne forme liturgique. Même si contribuer à régler cette question épineuse a bien été aussi l’une de ses fins.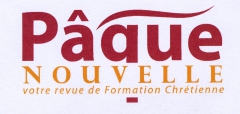
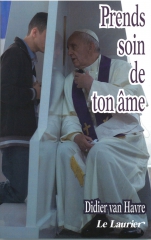 S
S










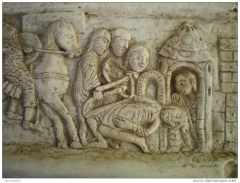
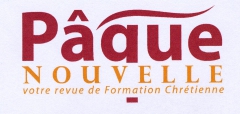
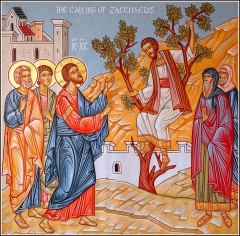
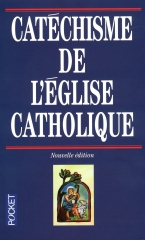
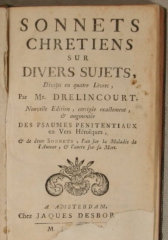
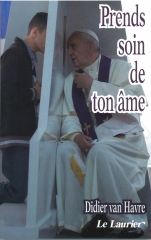
 Dans le numéro précédent de Pâque nouvelle (n° 101), nous avons décrit la sévérité des pénitences infligées aux pécheurs durant les premiers siècles ; celles-ci ne vont pas s’adoucir avec le temps… Nous avions découpé ces vingt siècles de pénitence en cinq parties. Voici les trois dernières.
Dans le numéro précédent de Pâque nouvelle (n° 101), nous avons décrit la sévérité des pénitences infligées aux pécheurs durant les premiers siècles ; celles-ci ne vont pas s’adoucir avec le temps… Nous avions découpé ces vingt siècles de pénitence en cinq parties. Voici les trois dernières. Ces connivences contre-nature entre le trône et l’autel ne vont pas manquer de susciter des tensions, des luttes de pouvoirs. La puissance temporelle de la papauté culminera en 1077 lors du célèbre épisode de Canossa. Excommunié, l’empereur Henri IV
Ces connivences contre-nature entre le trône et l’autel ne vont pas manquer de susciter des tensions, des luttes de pouvoirs. La puissance temporelle de la papauté culminera en 1077 lors du célèbre épisode de Canossa. Excommunié, l’empereur Henri IV L’un des prélats les plus impitoyables en matière de pénitence fut sans doute S. Pierre Damien (+1072). On reste abasourdi par la dureté des sanctions qu’il impose aux pécheurs. Il s’en prend particulièrement à l’homosexualité ; selon lui, le vice de sodomie «surpasse l’énormité de tous les autres». Il lui consacre même tout un ouvrage, Le Livre de Gomorrhe, où l’on peut lire ceci :
L’un des prélats les plus impitoyables en matière de pénitence fut sans doute S. Pierre Damien (+1072). On reste abasourdi par la dureté des sanctions qu’il impose aux pécheurs. Il s’en prend particulièrement à l’homosexualité ; selon lui, le vice de sodomie «surpasse l’énormité de tous les autres». Il lui consacre même tout un ouvrage, Le Livre de Gomorrhe, où l’on peut lire ceci : Ce sont les indulgences liées aux croisades qui vont insensiblement faire péricliter les anciennes pénitences canoniques. Cela n’entrait évidemment pas dans les intentions du pape Urbain II ni du concile de Clermont, car ils croyaient faire deux biens à la fois : délivrer les lieux saints et faciliter la pénitence à une infinité de pécheurs qui ne l’auraient jamais faite autrement.
Ce sont les indulgences liées aux croisades qui vont insensiblement faire péricliter les anciennes pénitences canoniques. Cela n’entrait évidemment pas dans les intentions du pape Urbain II ni du concile de Clermont, car ils croyaient faire deux biens à la fois : délivrer les lieux saints et faciliter la pénitence à une infinité de pécheurs qui ne l’auraient jamais faite autrement. Au XVIe siècle, la révolte de Luther et de ses disciples va conduire l’Église à une reprise en main doctrinale et disciplinaire. «Seule la foi sauve», prétendait Luther, dispensant ainsi les pécheurs de confession et de réparation. Le concile de Trente répond ceci en janvier 1547 (décret sur la justification) :
Au XVIe siècle, la révolte de Luther et de ses disciples va conduire l’Église à une reprise en main doctrinale et disciplinaire. «Seule la foi sauve», prétendait Luther, dispensant ainsi les pécheurs de confession et de réparation. Le concile de Trente répond ceci en janvier 1547 (décret sur la justification) : 
 L’étymologie de ce mot exprime parfaitement sa signification spirituelle
L’étymologie de ce mot exprime parfaitement sa signification spirituelle S’il y eut jamais un acte juridique dans l’Église, qui aurait requis que l’énoncé en fût indicatif, c’est bien l’absolution de l’excommunication par laquelle le baptisé est rétabli dans tous les droits attachés à la communion des fidèles. Cependant, assez étonnamment, l’absolution ou la révocation de la sentence d’excommunication se faisait autrefois par des prières en forme déprécatoire, quoique de tout temps la sentence de l’excommunication eût été énoncée en termes indicatifs ou imprécatifs… En d’autres mots : «Nous t’excommunions…», mais «Dieu veuille te réintroduire…»
S’il y eut jamais un acte juridique dans l’Église, qui aurait requis que l’énoncé en fût indicatif, c’est bien l’absolution de l’excommunication par laquelle le baptisé est rétabli dans tous les droits attachés à la communion des fidèles. Cependant, assez étonnamment, l’absolution ou la révocation de la sentence d’excommunication se faisait autrefois par des prières en forme déprécatoire, quoique de tout temps la sentence de l’excommunication eût été énoncée en termes indicatifs ou imprécatifs… En d’autres mots : «Nous t’excommunions…», mais «Dieu veuille te réintroduire…» Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Certains grands esprits introduisirent une distinction à l’intérieur même de la démarche personnelle de pénitence ; la question cruciale était celle-ci : le pénitent revient-il à Dieu par crainte des peines liées au péché ou par amour pour Dieu ? C’est ainsi que fut introduite la différence entre l’attrition (regret par crainte des peines) et la contrition (regret par amour pour Dieu); la première n’étant accompagnée que d’un faible amour de Dieu, tandis que la seconde manifestait un très grand amour pour Dieu, ou, pour parler comme ces théologiens, un amour très intense, intensissimum. Cependant les scolastiques convenaient unanimement entre eux que la contrition et l’attrition étaient de même espèce (notion héritée de la philosophie grecque), et qu’elles ne différaient que «du plus au moins». De là naquit parmi eux l’axiome selon lequel les pénitents confessant leurs péchés, d’attrits devenaient contrits avant ou après l’absolution, ou même pendant qu’ils la recevaient…
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Certains grands esprits introduisirent une distinction à l’intérieur même de la démarche personnelle de pénitence ; la question cruciale était celle-ci : le pénitent revient-il à Dieu par crainte des peines liées au péché ou par amour pour Dieu ? C’est ainsi que fut introduite la différence entre l’attrition (regret par crainte des peines) et la contrition (regret par amour pour Dieu); la première n’étant accompagnée que d’un faible amour de Dieu, tandis que la seconde manifestait un très grand amour pour Dieu, ou, pour parler comme ces théologiens, un amour très intense, intensissimum. Cependant les scolastiques convenaient unanimement entre eux que la contrition et l’attrition étaient de même espèce (notion héritée de la philosophie grecque), et qu’elles ne différaient que «du plus au moins». De là naquit parmi eux l’axiome selon lequel les pénitents confessant leurs péchés, d’attrits devenaient contrits avant ou après l’absolution, ou même pendant qu’ils la recevaient… Cependant, dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs théologiens, appuyés sur des raisonnements plus subtils que solides, ont enseigné le contraire en raison de deux motifs :
Cependant, dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs théologiens, appuyés sur des raisonnements plus subtils que solides, ont enseigné le contraire en raison de deux motifs :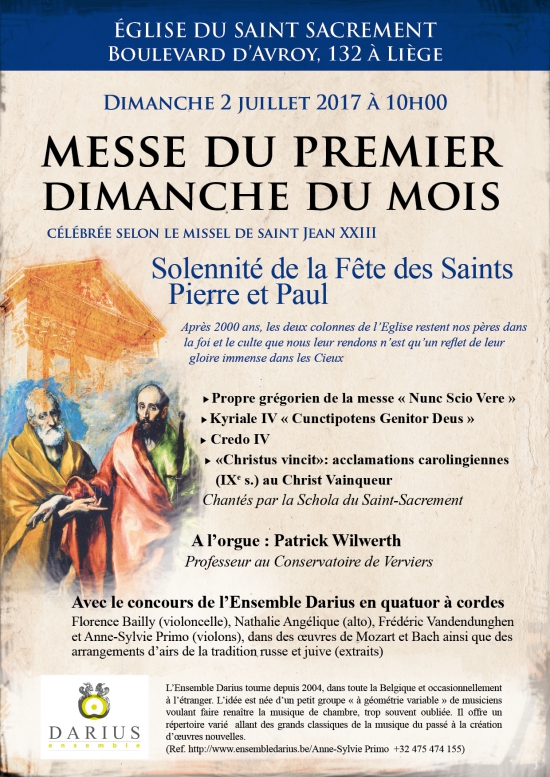





 Ce mystère de vie est aussi un mystère d’amour, l’amour de Dieu pour nous, qui se manifeste dans le don que Jésus nous fait de son corps et de son sang, c’est-à-dire le don de toute sa vie. Nous découvrons que nous sommes des gens qui sont aimés, et non pas des gens lancés dans la vie par le hasard des choses. Chacun de nous est aimé par le Christ et nous sommes invités à répondre à cet amour en communiant avec lui et en recevant son corps. Jésus nous a aimés le premier. Il est mort pour nous, c’est-à-dire qu’il est allé jusqu’au bout de sa vie d’amour, il n’a pas reculé au dernier moment. Mais il a voulu donner un signe du fait qu’il offrait sa vie pour nous.
Ce mystère de vie est aussi un mystère d’amour, l’amour de Dieu pour nous, qui se manifeste dans le don que Jésus nous fait de son corps et de son sang, c’est-à-dire le don de toute sa vie. Nous découvrons que nous sommes des gens qui sont aimés, et non pas des gens lancés dans la vie par le hasard des choses. Chacun de nous est aimé par le Christ et nous sommes invités à répondre à cet amour en communiant avec lui et en recevant son corps. Jésus nous a aimés le premier. Il est mort pour nous, c’est-à-dire qu’il est allé jusqu’au bout de sa vie d’amour, il n’a pas reculé au dernier moment. Mais il a voulu donner un signe du fait qu’il offrait sa vie pour nous. 
