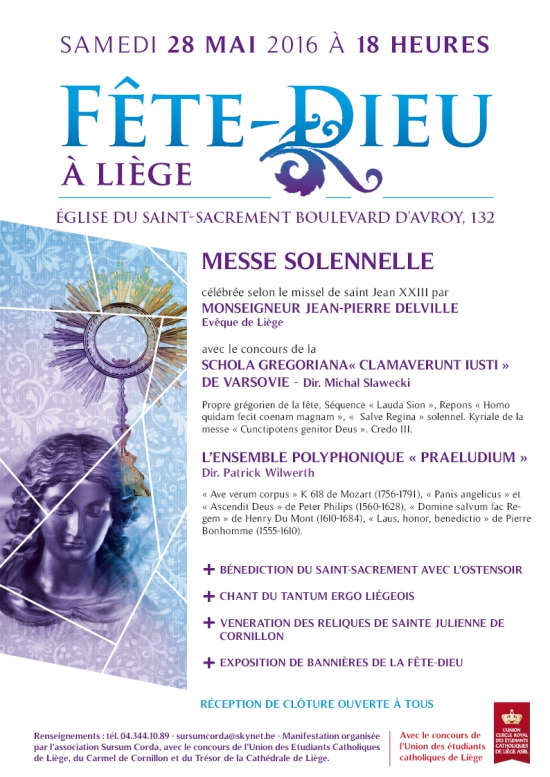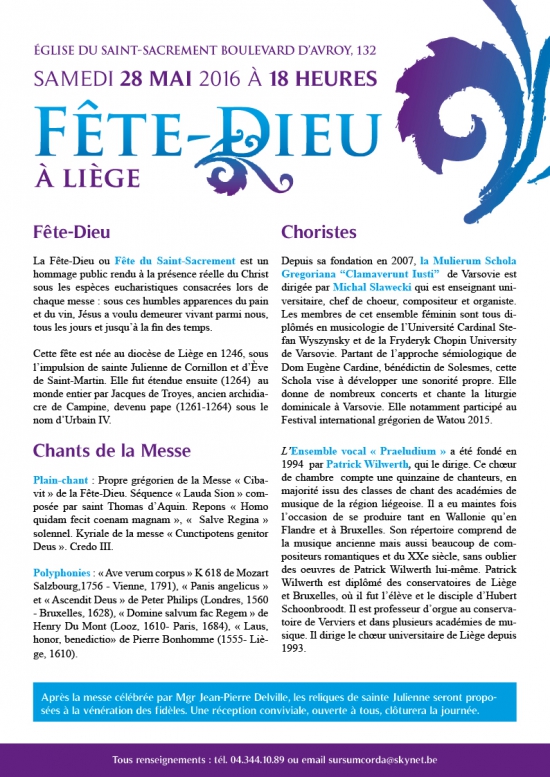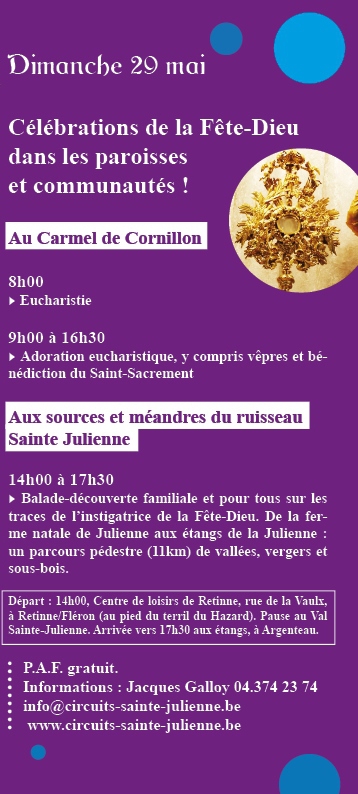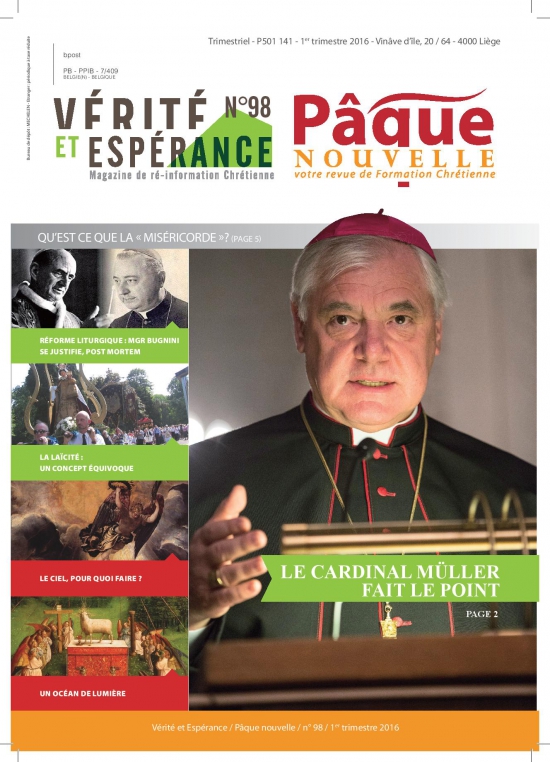UN PASSANT, SIMON DE CYRENE

(Mc 15, 21 ; cf. Mt 27, 32 et Lc 23, 26)
« Et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs » (Mc 15, 21).
Heureux passant que celui-là ! A-t-il pris conscience du bonheur qu’il recevait en partage ? Peut-être pas sur le moment.
Car il « revenait des champs », et le paysan ne revient pas des champs, qu’il n’ait d’abord épuisé toute la force qu’il sait devoir à sa dure journée de labeur. Il était encore tôt ; ne se sentait-il donc pas bien ce jour-là ? allez savoir...
On le réquisitionne manu militari : sans doute aura-t-il pesté d’être passé par là.
◊
A moins qu’il fût justement revenu plus tôt des champs pour être là et voir passer Jésus, comme autrefois Zachée ? Là non plus, nous ne savons pas.
Qu’il ait au moins entendu parler, comme tout le monde, de cet homme à l’étonnante audience, et de tant de miracles accomplis, c’est probable ; qu’il ait déjà pour lors été de ses disciples l’est beaucoup moins : les évangélistes n’en auraient pas fait mystère, et le ton même du verset ne laisse rien entendre de tel. Il revenait des champs, c’est tout.
◊
Il passe, regarde curieux ou avec compassion, il ne nous appartient pas d’en connaître, et le voilà réquisitionné. Réquisitionné par qui ? Par l’officier de la troupe, qui voyait bien que l’homme dont il avait la garde, épuisé par la flagellation subie, allait mourir avant même d’arriver au lieu du Calvaire.
Par l’officier, vraiment ? Il n’est rien dans la Passion du Fils qui n’ait accompli le dessein du Père (cf. Jn 19, 28-30), et si chaque acteur y participe avec ses choix, sa volonté et sa responsabilité, la vraie signification de sa contribution au Sacrifice du Christ le dépasse entièrement, comme l’évangéliste le souligne explicitement, par exemple, dans le cas de la prophétie énoncée en aveugle par Caïphe : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. » (Jn 11, 50 ; cf. 49-52).
C’était pur hasard pour l’officier de choisir ce Simon : tout au plus aura-t-il jaugé d’un coup d’œil à sa carrure que le bonhomme ferait l’affaire. S’il avait pu savoir, il se serait réservé à lui-même cette grâce. Seulement voilà, on ne décide pas de sa grâce. Il assurait son service, mais il ne savait pas lequel.
Simon n’avait aucune idée, non plus, qu’il était né, lui, pour cette heure : il serait le premier après le Christ, et à sa suite, à embrasser la Croix, en notre nom à tous. Mais de cela, il n’avait nulle conscience : il n’était alors qu’un pauvre homme, obéissant, et l’on ne sait dans quelles dispositions, à l’ordre qu’on lui intimait.
◊
Nous nous imaginons volontiers qu’il est plus méritoire d’offrir de notre propre mouvement à Dieu un sacrifice librement choisi, que d’accepter simplement, mais de bon cœur, une épreuve qui s’impose à nous, sans qu’il nous soit possible d’y échapper. C’est bien à tort : les saints enseignent en effet tout le contraire. L’amour que nous portons à Dieu se traduit avant tout dans l’obéissance, qui suppose l’amoureuse acceptation de tout ce qu’il permet qu’il nous arrive ; les initiatives personnelles, fussent-elles héroïques, sont quant à elles souvent entachées d’amour-propre.
Saint Jérôme à ce propos n’omet pas de rattacher le nom de Simon à la racine hébraïque qui signifie « obéir ». Nous ne savons qu’une chose de sa conduite : c’est qu’il a obéi. Il n’avait pas le choix ? ... Et alors ? Là n’est pas la question, mais qu’il l’ait fait, et s’il l’a fait amoureusement.
◊
Au-delà de l’officier en service commandé, c’est donc le Père qui réquisitionna Simon pour nous représenter en devenant un autre Christ à la suite du Christ. « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Mt 16, 24).
« Sa » croix. Car, ainsi que le remarque justement saint Ambroise, la croix sur laquelle le Christ est monté n’est pas sienne, mais bien nôtre (cf. Exp. év. selon s. Luc, 10, 107). Isaïe l’avait prophétisé : « En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé » (Is 53, 4).
Le Christ nous sauve, mais vient toujours pour cela le moment où il nous invite à nous conformer à lui, car c’est ainsi que nous deviendrons agréables au Père. Pour la dernière portion du chemin vers le Calvaire, la croix, qui avait été assumée par Jésus, est remise sur les épaules de Simon. L’homme ne peut être sauvé s’il n’est incorporé à la Personne du Christ.
Les Pères (s. Hilaire, s. Ambroise, s. Jérôme, s. Augustin, s. Léon...) confirment en effet ce qui ressort du sens obvie des Synoptiques : ils s’accordent à considérer que Simon était seul à porter alors la croix, derrière le Christ, qui en fut à ce moment entièrement déchargé. « O admirable échange ! » Non pas, comme on le voit représenté sur la plupart de nos chemins de croix, un Simon portant l’extrémité de la poutre, mais un Simon fait Christ, totalement, à la suite du Christ.
◊
Il est dit de Simon, qu’il était père d’Alexandre et de Rufus. Comme dans l’écriteau placé par Pilate sur la croix, « rédigé en hébreu, en grec et en latin » (Jn 19, 20), on peut y voir un signe de l’universalité du Salut qui, des Juifs, s’étend au monde entier, alors gréco-romain. La coïncidence est à tout le moins frappante, que ce Juif au nom juif ait donné à l’un de ses fils un nom grec, à l’autre, un nom latin.
Nous avons reconnu ne rien savoir des dispositions intérieures de Simon au moment où il fut chargé de la croix du Sauveur. Mais, que l’évangéliste Marc le désigne à ses lecteurs par ces simples mots « le père d'Alexandre et de Rufus » donne à penser que ses deux fils étaient bien connus de la communauté chrétienne, et, qui plus est, probablement à Rome (on admet généralement, avec la tradition, que le deuxième évangile y aurait été écrit.)
Sans permettre bien sûr de les identifier aux deux personnages cités respectivement dans les Actes (19, 33-34) et dans l’Epître aux Romains (16, 13), cela semble tout au moins indiquer qu’ils ont pu être de ceux qui portèrent la Bonne Nouvelle au loin. Et par où leur serait venue cette grâce, sinon par leur bienheureux père, qui n’était pas homme à philosopher à la manière des gens de l’Aréopage (cf. Ac 17, 16-32), lui qui a tout simplement « pris ‘sa’ croix » et suivi Jésus. Le Sauveur aura fait le reste. C’est là tout le secret du Salut et de la transmission de l’Evangile.
◊
Le Seigneur est le premier à porter la croix. Il nous montre l’exemple, puis il nous la remet, comme il fit à Simon.
On en trouve l’explication chez saint Paul : « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Eglise » (Col 1, 24).
La Traduction officielle liturgique de la Bible rend là avec finesse et justesse ce que la plupart des traductions françaises antérieures proposent, il faut bien le dire, d’assez maladroit : « Ce qui manque aux épreuves du Christ... »
Elles s’empressent heureusement de rectifier en note l’expression défectueuse. Ainsi la Bible de Jérusalem : « ... Paul ne prétend certes pas ajouter quoi que ce soit à la valeur proprement rédemptrice de la Croix, à laquelle rien ne saurait manquer [ah !] ; mais il s’associe aux ‘épreuves’ de Jésus, c’est-à-dire à ses tribulations apostoliques. » Cette note de l’édition de 1961 est remaniée (diluée ?) dans l’édition de 2000, qui remplace aussi dans le texte le mot « épreuves » par « tribulations » : « Col ne dit pas que [le] Christ n’a pas accompli tout ce qu’il avait à accomplir (1 19-20, 22 ; 2 9-10, 13-14 ; 3 1) ni qu’il n’a pas assez souffert, pour que l’Apôtre doive porter à leur achèvement les souffrances rédemptrices pour l’Eglise : car alors la médiation du Christ ne serait pas parfaite, et l’épître ne cesse de dire le contraire. Ce que Paul doit mener à terme, c’est son propre itinéraire apostolique, qu’il nomme « tribulations du Christ en ma chair » et qui reproduit celui du Christ, dans sa manière de vivre et de souffrir par et pour l’annonce de l’Evangile et pour l’Eglise. »
Les traducteurs-annotateurs font bien de rappeler que la rédemption est parfaite dans le Christ ; la suite de la justification sent plutôt son casuiste, et ne rend pas compte, à notre avis, de ce que dit clairement saint Paul : combien plus limpide et préférable comme explication nous semble la note que voici, commentant Ph 1, 20 (éd. 1961) : « Le chrétien, uni physiquement au Christ par le baptême et l’eucharistie, lui appartient par son corps même, cf. 1 Co 6 15 ; 10 17, 12 12s, 27 ; Ga 2 20 ; Ep 5 30. C’est pourquoi la vie de ce corps, ses souffrances, et jusqu’à sa mort, deviennent mystiquement celles du Christ habitant en lui. » Plus aucune trace hélas de cette note, pourtant si éclairante, dans l’édition du millénaire !
◊
Voilà ce dont Simon de Cyrène était la préfiguration, voilà ce dont il a pu recueillir la grâce, non point encore « par le baptême et l’eucharistie », mais par la désignation voulue du Père, qui fit de lui l’homme qu’était physiquement l’instant d’avant le Sauveur, ployant sous le poids de la croix.
Non certes, il ne manque rien à la Passion du Christ. Mais c’est bien réellement, et pas par métaphore, que le Christ a fait de l’Eglise, et de chacun de ses membres, son véritable corps mystique. Si la Passion du Christ est parfaite, elle l’est, inséparablement, à la fois dans le chef et dans les membres : lui et eux ne font qu’un, dès lors que ceux-ci agissent bien « par lui, avec lui et en lui » (Canon de la Messe).
« Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair », ce ne sont pas « mes » épreuves que je viendrais ajouter à celles du Christ ; l’Apôtre le dit expressément : ce sont « les épreuves du Christ » « dans ma propre chair ».
◊
Nous ne sommes chrétiens, nous ne sommes sauvés que pour autant que nous ne formions qu’un avec le Christ, Jésus crucifié : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20) ; « A vos yeux, Jésus-Christ a été présenté crucifié » (Ga 3, 1) ; « Je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus-Christ, et celui-ci crucifié » (1 Co 2, 2).
Alors, même s’il nous en coûte (et c’est bien naturel ― « que ce calice passe loin de moi ! » ―), ne voyons pas d’un œil chagrin (« ... cependant, non pas comme moi je veux... ») d’être crucifiés par les malveillances, les épreuves, la maladie, la sénescence, la mort. Nous le savons et nous le croyons : c’est « par sa Passion et par la Croix que nous serons conduits jusqu’à la gloire de la Résurrection » (oraison de l’Angélus). Sa Passion et la nôtre n’en sont qu’une, sa Croix est la nôtre : et l’aboutissement de ce chemin, c’est la Résurrection.
« Si nous sommes morts avec lui,
avec lui nous vivrons.
Si nous supportons l’épreuve,
avec lui nous régnerons. »
(2 Tm 2, 11-12)
◊
Prions toutefois que la motivation profonde de notre cœur soit l’amour de Jésus, plus encore que cette promesse d’accéder à sa Résurrection ; le désir d’être avec lui, là où il est, dans l’état où il est, pour répondre à l’appel de son Cœur : « Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi » (Jn 17, 24). Car le désir même de ressusciter ne consiste-t-il pas justement à vouloir demeurer avec lui à jamais, auprès du Père, dans leur Esprit commun ? D’où la fin du verset : « ...que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde » (Ibid.)
L’Apôtre le chante admirablement :
« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ?
la faim ? le dénuement ?
le danger ? le glaive ?
...
En effet, il est écrit :
C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt,
qu’on nous traite en brebis d’abattoir.
Mais, en tout cela
nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés.
J’en ai la certitude :
ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés,
ni le présent ni l’avenir,
ni les Puissances,
ni les hauteurs, ni les abîmes,
ni aucune autre créature,
rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu
qui est
dans le Christ Jésus notre Seigneur. »
(Rm 8, 35-39)
◊
Etre avec lui, là où il est, dans l’état où il est, tel est aussi le désir de la bien-aimée du Cantique des Cantiques :
« Raconte-moi, bien-aimé de mon âme,
où tu mènes paître tes brebis,
où tu reposes aux heures de midi,
que je n’aille plus m’égarer
vers les troupeaux de tes compagnons. »
(Ct 1, 6 [Vulgate])
Aux heures de midi, le Bien-aimé de mon âme « reposait » sur la Croix. De midi à trois heures. C’est là qu’il me mène paître, sa brebis, sur le midi, lui que je contemple, mon Sauveur sur la Croix (cf. s. Bernard, Serm. sur le Cant., 43, 4) ; là où il repose du vrai repos, puisque ses souffrances engloutissent souverainement le péché qui est la seule inquiétude décisive.
C’est là qu’il me prend sur son cœur.
(Cf. Is 40, 11).
Il y a donc tout lieu de porter une sainte envie à ce Simon, quelles que soient pourtant les répugnances de notre nature à partager son sort. Si nous avons à souffrir, demandons la grâce de nous réjouir de recevoir, en cela même, ce privilège d’être, comme lui, désignés volontaires pour porter la Croix. Car nous sommes bien sûrs à ce moment, si nous l’acceptons de tout cœur, d’agir in persona Christi, et de voir se réaliser ainsi en nous le plein et fructueux achèvement des prémices notre baptême.
Jean-Baptiste Thibaux
augversfr@yahoo.fr
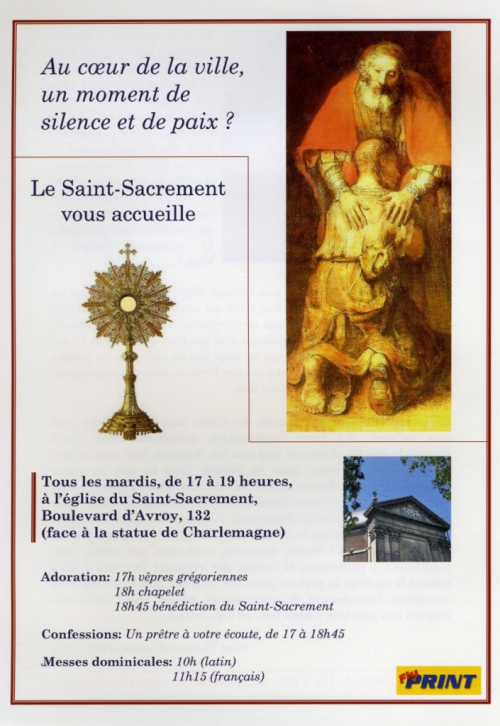
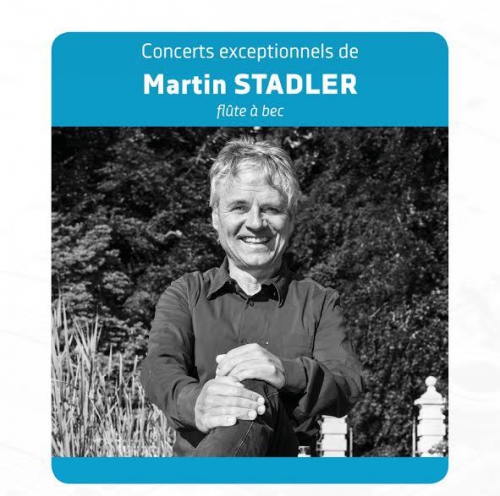



 A l’occasion de la Fête-Dieu 2016 à Liège, l’évêque du diocèse, Mgr Jean-Pierre Delville, s’est rendu le samedi 28 mai à l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, où il a célébré la Solennité de la Fête selon la forme extraordinaire du rite romain. Plus de trois cents fidèles ont pris part à cette messe festive que rehaussaient les chants grégoriens de la Schola « Clamaverunt iusti » de Varsovie, dirigée par Michal Slawecki, chef du chœur de l’université polonaise Cardinal Stefan Wyszyński . Son homologue du chœur universitaire de Liège, Patrick Wilwerth, lui fit écho à la tête de l’Ensemble vocal liégeois« Praeludium » qui interpréta des motets polyphoniques anciens dédiés à l’Eucharistie. La célébration s’est terminée par la bénédiction du Saint-Sacrement et la vénération des reliques de sainte Julienne de Cornillon, suivies d’un vin d’honneur auquel Mgr Delville a pris part en parcourant la foule des participants. Au cours de l’homélie de la messe, axée sur le thème de l’eucharistie miséricordieuse, l’évêque de Liège a bien voulu souligner en ces termes la pertinence de l’action entreprise par la communauté de l’église du Saint-Sacrement : « L’évangile de la multiplication des pains se termine par : « on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers ». Douze: le chiffre des tribus d’Israël, le chiffre des disciples, le symbole de l’Église. C’est dans la communion ecclésiale que la communion au Christ donne ses fruits. Nous avons célébré ici dans cette église du Saint-Sacrement, où la communauté a voulu garder la richesse de la liturgie ancienne et la beauté des chants latins. Ainsi cette église est comme l’un des douze paniers qui composent l’Église et qui alimentent l’humanité ! »
A l’occasion de la Fête-Dieu 2016 à Liège, l’évêque du diocèse, Mgr Jean-Pierre Delville, s’est rendu le samedi 28 mai à l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, où il a célébré la Solennité de la Fête selon la forme extraordinaire du rite romain. Plus de trois cents fidèles ont pris part à cette messe festive que rehaussaient les chants grégoriens de la Schola « Clamaverunt iusti » de Varsovie, dirigée par Michal Slawecki, chef du chœur de l’université polonaise Cardinal Stefan Wyszyński . Son homologue du chœur universitaire de Liège, Patrick Wilwerth, lui fit écho à la tête de l’Ensemble vocal liégeois« Praeludium » qui interpréta des motets polyphoniques anciens dédiés à l’Eucharistie. La célébration s’est terminée par la bénédiction du Saint-Sacrement et la vénération des reliques de sainte Julienne de Cornillon, suivies d’un vin d’honneur auquel Mgr Delville a pris part en parcourant la foule des participants. Au cours de l’homélie de la messe, axée sur le thème de l’eucharistie miséricordieuse, l’évêque de Liège a bien voulu souligner en ces termes la pertinence de l’action entreprise par la communauté de l’église du Saint-Sacrement : « L’évangile de la multiplication des pains se termine par : « on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers ». Douze: le chiffre des tribus d’Israël, le chiffre des disciples, le symbole de l’Église. C’est dans la communion ecclésiale que la communion au Christ donne ses fruits. Nous avons célébré ici dans cette église du Saint-Sacrement, où la communauté a voulu garder la richesse de la liturgie ancienne et la beauté des chants latins. Ainsi cette église est comme l’un des douze paniers qui composent l’Église et qui alimentent l’humanité ! » Samedi prochain 28 mai à 18 heures, Michal Slawecki et l’Ensemble vocal « Clamaverunt Iusti » de Varsovie apporteront leur concours à la messe traditionnelle de la Fête-Dieu célébrée par Mgr Jean-Pierre Delville en l’église du Saint-Sacrement, au Boulevard d’Avroy à Liège.
Samedi prochain 28 mai à 18 heures, Michal Slawecki et l’Ensemble vocal « Clamaverunt Iusti » de Varsovie apporteront leur concours à la messe traditionnelle de la Fête-Dieu célébrée par Mgr Jean-Pierre Delville en l’église du Saint-Sacrement, au Boulevard d’Avroy à Liège.