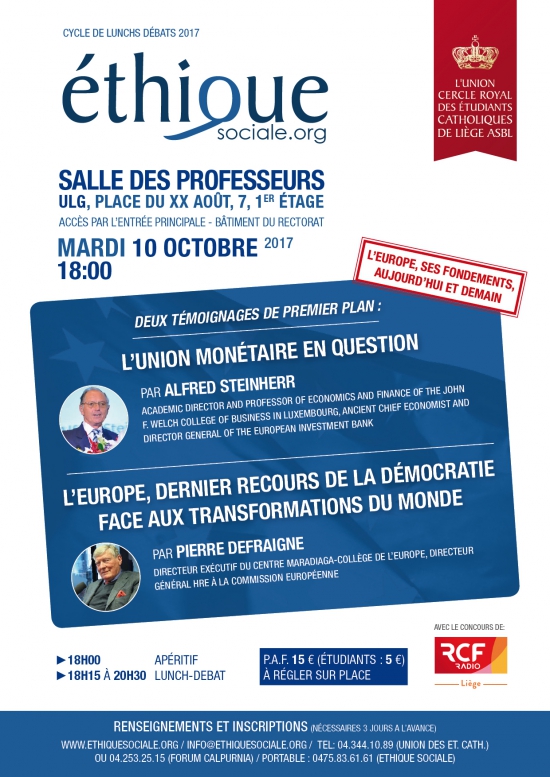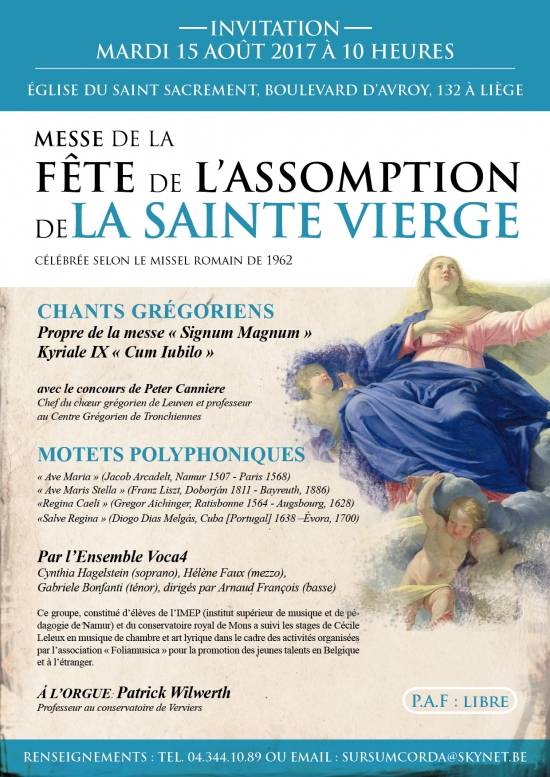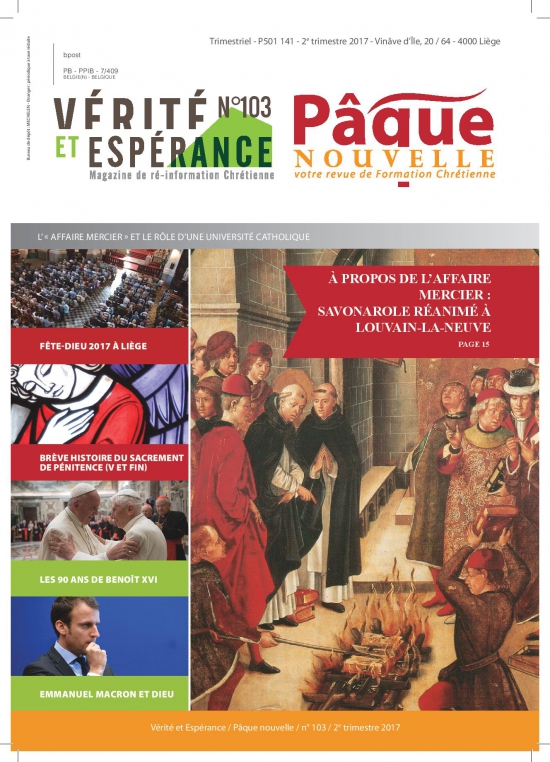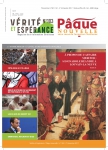Dans le n° 105 du magazine trimestriel « Vérité et Espérance. Pâque Nouvelle » qui vient de paraître, on peut lire en prolongement de Deux, trois petits pas au Livre de Job cette méditation sur la justice et la miséricorde divines, signée Jean-Baptiste Thibaux :
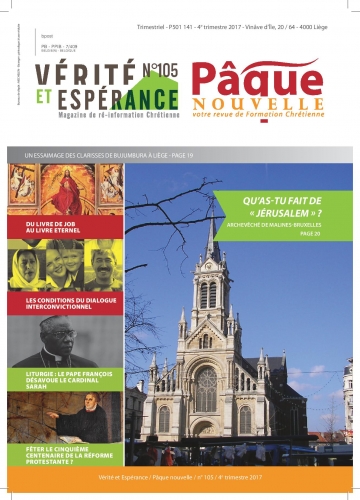
DU LIVRE DE JOB
AU LIVRE ÉTERNEL
« Dieu fait lever son soleil
sur les bons, et sur les méchants ;
et sa pluie, il la prodigue
aux justes et aux injustes. »
(Mt 5, 45)
Est-ce donc à dire que l’homme ne serait pas rétribué selon ses actes ? Voilà une question que nous pouvons aborder avec l’ampleur de regard requise, espérons-le, à présent que nous avons appris de Job la souveraine indépendance de Dieu, laquelle exclut définitivement toute idée de bas marchandage.
◊
Rappelons pour commencer que l’Ecriture sainte est comme un corps vivant : si l’on en prélève un élément en le dissociant du tout, il perdra l’influx vital. La Parole de Dieu devient parole d’homme ; l’infini – car elle procède de l’Infini – est tout à coup propos borné.
Telle est précisément l’hérésie : son nom, du grec, signifie « choix », « prise pour soi ». Autant dire : piratage.
Il n’est point d’hérésie qui ne se réclame de l’Ecriture. De l’Ecriture disséquée. Il importe de recevoir l’Ecriture sainte à l’image de Jérusalem « qui est édifiée comme une cité où tout ensemble ne fait qu’un » (Ps 121/h.122, 3).
Et pour la recevoir à l’image de Jérusalem, il faut la lire avec les yeux de Jérusalem, en Jérusalem ; cette Jérusalem céleste, la « Jérusalem nouvelle », que l’Apôtre saint Jean a vue « qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, comme une jeune mariée parée pour son époux » (Ap 21, 2). Cette heureuse Jérusalem, la sainte Eglise, dont la voix qui venait du Trône a dit : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes » (Ibid. 3).
Saint Pierre donne aussi cet avertissement tout à fait clair : « Vous savez cette chose primordiale : pour aucune prophétie de l’Ecriture il ne peut y avoir d’interprétation individuelle, puisque ce n’est jamais par la volonté d’un homme qu’un message prophétique a été porté : c’est portés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 P 1, 20-21).
◊
Il n’est qu’à replacer dans son contexte le verset de saint Matthieu cité en tête de cet article pour constater une première évidence : son propos n’est aucunement d’envisager les choses en termes de mérite ou de démérite dans le chef des hommes qui bénéficient des prévenances indéfectibles de la bienveillante providence de Dieu.
L’évangéliste entend seulement donner pour modèle, en elle-même, la bonté divine : le chrétien, pour être vrai fils du Père, rayonnera de la bonté qui est essentielle à son adoption. Une bonté qui ne tire pas sa source de son objet, mais qui jaillit toute pure de l’amour, en lui, du Père.
« Aimez vos ennemis,
et priez pour ceux qui vous persécutent,
afin d’être vraiment les fils de votre Père
qui est aux cieux... »
(Mt 5, 44-45)
« ... En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment,
[ ] que faites-vous d’extraordinaire ?
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?
Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. »
(Mt 5, 46-48)
◊
La divine bonté du Père est parfaite. Souveraine. Indépendante du comportement des hommes.
Et l’homme alors murmure, dans sa malice, à la manière des ouvriers de la première heure (cf. Mt 20, 12).
« Servir Dieu n’a pas de sens.
A quoi bon garder ses observances,
mener une vie sans joie
en présence du Seigneur de l’univers ?
Nous en venons à dire
bienheureux les arrogants ;
même ceux qui font le mal sont prospères,
même s’ils mettent Dieu à l’épreuve,
ils en réchappent ! »
(Ml 3, 14-15)
◊
Voilà. Dieu est bon. Souverainement. Et l’homme en tire prétexte à malice.
« Je veux donner au dernier venu
autant qu’à toi :
n’ai-je pas le droit
de faire ce que je veux de mes biens ?
Ou alors ton œil est-il mauvais
parce que moi, je suis bon ?
(Mt 20, 14-15)
Dieu revendique nettement en ces termes son indépendance souveraine proclamée dans le livre de Job. « N’ai-je pas le droit de faire ce que je veux ? ». Puis, le caractère ‘essentiel’ de sa bonté : « parce que moi, JE SUIS bon. » Non pas : parce que moi j’agis bien, comme qui dirait en réponse à quelque convenance, voire à quelque équité. Non, mais « parce que JE SUIS bon. »
Rappel capital que celui de l’identité entre l’Etre de Dieu et sa Bonté. Car il nous faudra entendre bientôt dans l’Ecriture sainte que Dieu, à la fois, EST juste. Dans l’un et l’autre Testament, nous devrons apprendre de l’Ecriture sainte « où tout ensemble ne fait qu’un » l’identité entre l’Etre de Dieu et sa Justice.
Et par conséquent, l’identité indiscutable entre sa Bonté et sa Justice.
◊
Mais laissons de côté pour l’instant cette brève anticipation, et poursuivons la lecture de Malachie :
« ... Un livre fut écrit devant le Seigneur
pour en garder mémoire,
en faveur de ceux qui le craignent
et qui ont souci de son nom.
Le Seigneur de l’univers déclara :
Ils seront mon domaine particulier
pour le jour que je prépare.
Je serai indulgent envers eux,
comme un homme est indulgent
envers le fils qui le sert.
Vous verrez de nouveau qu’il y a une différence
entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu
et celui qui refuse de le servir. »
(Ml 3, 16-18)
Il y a toujours eu, dès l’Antiquité, et maintenant encore, des esprits « de géométrie » (comme dirait Pascal), pour souligner ce qu’ils veulent qualifier de ‘contradictions’ dans les Ecritures. Un Dieu qui traite avec égale bienveillance justes et méchants ― et qui rappelle ensuite qu’il fait entre eux la différence ; un Dieu bon qui toujours pardonne ― et qui déclare ensuite aux réprouvés : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges » (Mt 25, 41).
C’est oublier le mystère inhérent à l’infini de Dieu. Dieu ne peut être cadré dans nos catégories. Elles nous permettent d’avoir de lui une certaine connaissance, par analogie, non pas de le définir, lui, l’Infini. Elles nous permettent de saisir qu’il est bon au delà de toute bonté, qu’il est juste au-delà de toute justice ; non pas de voir comment il s’agit là d’une unique et simple réalité.
La ‘simplicité’ de Dieu nous échappe totalement, mais la perception multiple que nous en avons, tantôt par révélation, tantôt par raison, suffit à régler notre conduite selon son Etre qui, en lui-même, nous reste nécessairement mystérieux.
Amour et crainte donc, car :
« Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent. »
(Ps 83/h.84, 11)
Il nous faut recueillir avec grande application, pour éclairer notre agir, tout élément de l’Ecriture sainte, comme on ferait d’autant de touches sur un tableau impressionniste ; et notre toile deviendra ainsi peu à peu un reflet de la perfection divine.
◊
Que dit le texte de Malachie ? « Vous verrez de nouveau qu’il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. » L’homme est donc rétribué selon ses actes, on ne peut en douter. Or il ne le voit pas ; il le verra : « vous verrez », le verbe est au futur.
La rétribution est promise à l’homme, mais le plus souvent il ne lui est pas donné de la palper déjà, de peur qu’un bas calcul d’intérêt ne remplace en son cœur le motif d’amour qui toujours doit primer.
L’assurance de la rétribution différenciée entre le juste et le méchant est proclamée sans réserve, en mots clairs. Mais seul un cœur confiant, donc aimant, la reçoit sans hésiter. Ce cœur-là est fermement résolu, et « d’abord », à servir Dieu, à chercher « le Royaume de Dieu et sa Justice », et c’est « par surcroît » (cf. Mt 6, 33) que vient naître en lui l’assurance de la rétribution. Pour qui ne vit pas d’amour de Dieu, le Ciel et l’Enfer ne sont que concepts, qui peuvent certes et doivent servir d’amorce à sa conversion, mais dont il aura tôt fait de douter, s’il ne se convertit pas à l’« unique nécessaire » (Lc 10, 42). L’intelligence discerne ce qui est vrai ; encore faut-il y donner suite...
◊
« Vous verrez ». Le verbe est au futur : ce ne sera pas avant de passer du Livre de Job au Livre éternel.
Pour le moment, il vous est demandé de croire ; alors, vous verrez « ... de nouveau ».
Les modernes traduisent ainsi (« de nouveau » ou « alors ») l’hébreu, qui dit littéralement : « et vous recommencerez et vous verrez. » Le tour est un hébraïsme, qui équivaut en effet pour le sens à la traduction proposée, dont la formulation se règle à juste titre sur les façons de dire qui nous sont, à nous, familières. Non sans égratignure, pourtant, à la fidélité : « Traduttore, traditore ! »
« Et vous recommencerez et vous verrez », dans la vigueur de l’idiome, évoque en effet un quelque chose de tangible que l’abstrait « de nouveau » peine à rendre. Le grec des Septante et le latin de la Vulgate, s’efforcent de garder les deux verbes en s’avançant un peu dans la paraphrase : « Vous vous convertirez et vous verrez. »
Il n’importe pas tant ici de rechercher l’idéal de la traduction, probablement inaccessible, que de saisir ce ‘tangible’ du texte.
Job, le juste, est frappé, et Malachie d’autre part ajoute à cela que « même ceux qui font le mal sont prospères ». Celui-là traçait son livre en traits de justice, et ceux-ci le leur, d’iniquité en iniquité. Sans « voir », ni eux, ni lui. Mais, parallèlement, « devant le Seigneur » « un livre fut écrit pour en garder mémoire. » Oui, devant le Seigneur, et le Seigneur précise : « pour le jour que je prépare. »
Il y a deux livres : le livre de Job, et le livre éternel. Le livre écrit par l’homme, sans y voir, dans la confiance ou le mépris de la Parole de Dieu, au temps de la Foi ; et, en reflet, le livre qu’écrit ce « bout de main » dont parle le livre de Daniel (Dn 5, 5), pour le jour que Dieu prépare.
« Et vous recommencerez et vous verrez », car ce ne sera plus, ce jour-là, le temps de la Foi, mais le temps de la Vision. Ce ne sera plus un jour du temps, mais le Jour éternel. Vous y serez introduits, « et vous recommencerez », vous reprendrez le livre de toute votre vie depuis son début, mais cette fois dans sa projection d’éternité. « Et vous verrez. »
◊
Que verrons-nous donc ?
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les Anges avec lui,
alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui :
il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs :
il placera les brebis à sa droite,
et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
‘‘Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim,
et vous m’avez donné à manger...’’
[ ]
Alors les justes lui répondront :
‘‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu ?
Tu avais donc faim,
et nous t’avons nourri ?...’’
[ ]
Et le Roi leur répondra :
‘‘Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.’’ »
(Mt 25, 31-40)
« ... et vous verrez. »
(Ml 3, 18)
« Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :
‘‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel
préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim,
et vous ne m’avez pas donné à manger...’’
[ ]
Alors ils répondront, eux aussi :
‘‘Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, avoir soif,
être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service ?’’
Il leur répondra :
‘‘Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous ne l’avez pas fait
à l’un de ces plus petits,
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’’
Et ils s’en iront,
ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes, à la vie éternelle. »
(Mt 25, 41-46)
« ...et vous verrez qu’il y a une différence
entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu
et celui qui refuse de le servir. »
(Ml 3, 18)
Il y a deux Testaments, mais une seule Ecriture ; il y a les Job, les Malachie, les Matthieu, mais un seul Esprit.
◊
« En faveur de ceux qui le craignent et qui ont souci de son nom », poursuit le livre de Malachie,
« le Seigneur de l’univers déclara :
Ils seront mon domaine particulier
pour le jour que je prépare.
Je serai indulgent envers eux,
comme un homme est indulgent
envers le fils qui le sert. »
C’est bien en faveur de ceux « qui ont souci de son nom » que le Seigneur de l’univers déclare qu’il sera « indulgent envers eux ».
Le Livre éternel s’inscrit exactement dans la ligne du Livre de Job. Il souligne comme lui que, pour juste qu’il soit, l’homme n’a rien à réclamer du Seigneur de l’univers. Pour juste que soit l’homme, il ne peut rien revendiquer au nom de sa propre justice : tout ce qu’il peut attendre, il le tient de l’indulgence de Dieu, qui sera pour lui « comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert. »
Or l’indulgence consiste à excuser, à pardonner. Que dire alors du mérite du fils qui sert le Père ? Car mérite il y a, puisque « vous verrez qu’il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. »
Que dire de ce mérite, sinon que c’est un mérite de simple convenance, et non de droit strict ?
◊
Le bonheur éternel est une grâce surnaturelle en ce que nos mérites reposent entièrement sur la grâce, qui, comme son nom le dit – grâce signifie ‘don gratuit’ ! – ne saurait être méritée. Le ‘nous’ qui sert Dieu, par Dieu nous est donné. L’inspiration de le servir, par lui nous est donnée. Et la volonté, et la force, et tout le reste.
Qu’avons-nous que nous n’ayons reçu (cf. 1 Co 4, 7) ? En couronnant nos mérites, Dieu couronne ses propres dons (cf. Missel Romain).
Nous ne saurions rien mériter de droit strict auprès de Dieu, parce que l’on ne mérite pas une récompense à donner ce que l’on doit. Or à Dieu, on doit tout.
« Quand vous aurez exécuté
tout ce qui vous a été ordonné,
dites :
"Nous sommes des serviteurs inutiles :
nous n’avons fait que notre devoir. »
(Lc 17, 10)
Une fois encore, on est dans la droite ligne du Livre de Job :
« Si tu es juste, que lui donnes-tu,
ou que reçoit-il de ta main ? »
(Jb 35, 7)
A Dieu, on ne donne jamais qu’en deçà de ce qu’on lui doit. Eclairé seulement par la philosophie, Aristote le remarquait déjà : « Nos bonnes actions toutes ensemble ne nous permettent pas de nous acquitter d’une manière suffisante, envers Dieu, de notre dette ; toujours, nous lui devons davantage. (8 Ethique, 14). » S’il y a récompense pour le bon serviteur, elle n’intervient que par indulgence de Dieu à son égard. « Je serai indulgent envers eux comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert. »
◊
Cela n’empêche pas Jérémie de proclamer :
Retiens le cri de tes pleurs
et les larmes de tes yeux.
Car il y a un salaire pour ta peine,
— oracle du Seigneur. »
(Jr 31, 16)
Et saint Matthieu de le confirmer :
« Et ils s’en iront,
ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes, à la vie éternelle. »
(Mt 25, 41-46)
Il y a deux Testaments, d’une seule Ecriture. L’un et l’autre affirme que l’homme est rétribué par Dieu.
Cette affirmation ne contredit pas la précédente, selon laquelle Dieu ne doit rien à l’homme ; ni le fait que Dieu est libre de faire de ses biens ce qu’il veut.
Saint Thomas d’Aquin en développe l’explication concluante :
« On appelle rétribution ce qu’on donne à quelqu’un en compensation pour son travail ou sa peine ; c’en est en quelque sorte le prix. [ ]
» Donner la rétribution qui convient pour une œuvre ou un labeur est un acte de justice. Or la justice consiste en une sorte d’égalité. [ ] Dès lors, la justice absolue n’existe qu’entre ceux qui sont parfaitement égaux.
» Là où l’égalité parfaite ne se rencontre pas, il ne saurait y avoir de justice au sens plein du mot ; mais on peut cependant y reconnaître encore une certaine sorte de justice. [ ]
» Par suite, lorsqu’il y a des rapports de justice absolue, on peut parler de mérite ou de rétribution au sens strict. Lorsque, au contraire, ne peut exister qu’une justice relative et non absolue, il ne peut être question de mérite au sens strict, mais de mérite relatif, pour autant que la notion de justice s’y retrouve encore. [ ]
» Or il est manifeste qu’entre Dieu et l’homme règne la plus grande inégalité : l’infini les sépare ; de plus, dans sa totalité, le bien de l’homme vient de Dieu.
» Par conséquent, de l’homme à Dieu il ne saurait être question de rapports de justice comportant une égalité absolue ; il y a seulement une justice proportionnelle, l’un et l’autre opérant selon son mode propre.
» Mais le mode et la mesure des capacités de l’homme lui viennent de Dieu. C’est pourquoi il ne peut y avoir de mérite pour l’homme auprès de Dieu que parce qu’il y a, à la base, un ordre préalablement établi par Dieu, de telle sorte que l’homme par son action obtienne de Dieu, à titre de rétribution, les biens en vue desquels Dieu lui a accordé ce pouvoir d’agir. C’est ainsi que les êtres de la nature parviennent par leurs mouvements et leurs opérations propres au but auquel Dieu les a ordonnés.
» Il y a cependant cette différence, que la créature raisonnable se porte d’elle-même à l’action par son libre arbitre, ce qui confère à son action le caractère méritoire, qui n’appartient pas aux mouvements des autres créatures. [ ]
»S’il est vrai que nos actions n’ont leur caractère méritoire qu’en vertu de l’ordre préalablement établi par Dieu, il ne s’ensuit pas que Dieu contracte rigoureusement par là une obligation à notre égard. S’il y a obligation c’est à l’égard de lui même, en ce sens qu’il se doit de faire que ce qu’il a réglé s’accomplisse. »
(S. Th., Ia, IIæ, qu. 114, 1,
trad. R. Mulard)
Ainsi passerons-nous du jour de Job, où bien souvent nous peinons, au Jour éternel, celui que Dieu a appelé :
« le jour que je prépare. »
Alors nous serons rétribués en raison de la grâce qui aura rendu nos actions méritoires par l’infusion en nous de la charité, c’est-à-dire de cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit (cf. Rm 5, 5).
Jean-Baptiste Thibaux.
JPSC
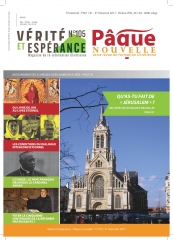 Stéphane Seminckx est prêtre, docteur en médecine et en théologie. Il est aussi membre de la Prélature de l’Opus Dei en Belgique. En mai dernier, il a pris part à un colloque sur le dialogue interconvictionnel organisé à l’Université libre de Bruxelles par « La Pensée et les Hommes ». Ce symposium réunissait des représentants des grandes religions et de la laïcité. Dans son intervention, l’abbé Seminckx a voulu présenter trois brèves réflexions sur les conditions d’un tel dialogue. Il nous a aimablement autorisé à reproduire ici le texte de sa communication :
Stéphane Seminckx est prêtre, docteur en médecine et en théologie. Il est aussi membre de la Prélature de l’Opus Dei en Belgique. En mai dernier, il a pris part à un colloque sur le dialogue interconvictionnel organisé à l’Université libre de Bruxelles par « La Pensée et les Hommes ». Ce symposium réunissait des représentants des grandes religions et de la laïcité. Dans son intervention, l’abbé Seminckx a voulu présenter trois brèves réflexions sur les conditions d’un tel dialogue. Il nous a aimablement autorisé à reproduire ici le texte de sa communication :