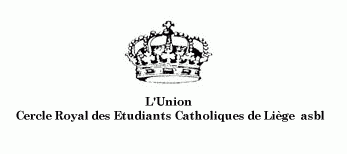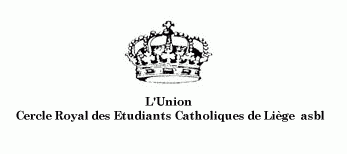
Neutralité "et" pluralisme: est-ce la solution la moins mauvaise, lorsque la réalisation de l’idéal de chrétienté est manifestement hors de portée ? « Cela se discute » comme dirait Jean-Luc Delarue. À condition de ne pas brader son idéal, ni son héritage, car c’est le christianisme qui est l'humanisme intégral.
Préambule
Dans le cadre de son cycle de rencontres 2011-2012, le Groupe éthique sociale et l’Union des Etudiants catholiques de Liège (1), associés au Forum Calpurnia, ont organisé le 25 avril 2012 à l’Université de Liège un lunch-débat sur le thème « Neutralité ou Pluralisme dans l’Espace public »
Face à la diversité idéologique, philosophique, religieuse et culturelle, à quels principes obéissent les institutions de l’Etat et de ses démembrements ? L’espace public n’est-il pas aussi plus que l’addition des collectivités publiques, celui d’une société civile exprimant la pluralité des opinions, cultes, associations ou partis ? L’Eglise et les communautés religieuses ou philosophiques n’ont-elles pas un rôle à jouer pour construire cet espace public et les collectivités auxquelles celui-ci donne naissance ? Enfin, la neutralité et le pluralisme n’ont-ils pas aussi leurs propres limites (2) (3) ?
aussi plus que l’addition des collectivités publiques, celui d’une société civile exprimant la pluralité des opinions, cultes, associations ou partis ? L’Eglise et les communautés religieuses ou philosophiques n’ont-elles pas un rôle à jouer pour construire cet espace public et les collectivités auxquelles celui-ci donne naissance ? Enfin, la neutralité et le pluralisme n’ont-ils pas aussi leurs propres limites (2) (3) ?
La parole a été donnée sur ce point à un éminent spécialiste du droit public belge: Francis DELPÉRÉE (photo) (3), sénateur et professeur ém. de droit constitutionnel à l’Université Catholique de Louvain (U.C.L.)
___________
(1) L'Union des Etudiants Catholiques de Liège est membre de l'asbl "Sursum Corda", association de fidèles responsable de l'église du Saint-Sacrement au Boulevard d'Avroy, aux activités de laquelle elle est intimement associée.
(2) Les pays ont aussi une mémoire, une histoire, des traditions, bref une culture. Sous prétexte de neutralité, les pouvoirs publics ne peuvent l’ignorer.
En Belgique, les sénateurs Philippe Mahoux, Christine Defraigne, Josy Dubié, Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille et Olga Zirhen avaient déposé le 06.11.2007 une proposition de loi « visant à appliquer la séparation de l'État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles ». Sous prétexte de neutralité, cette proposition prévoyait, entre autres, la suppression du « Te Deum » officiel organisé lors de la fête nationale et celle de tous les signes religieux des lieux publics comme les maisons communales ou les tribunaux, voire les cimetières. Ses auteurs n’ont pas trouvé de majorité parlementaire pour soutenir la proposition, qui a été retirée.
Dans son arrêt Lautsi du 18.03.2011, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la présence d’un crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes ne violait pas le droit à l’éducation tel qu’il doit être dispensé dans ce type d’écoles. Un arrêt sans doute appelé à faire jurisprudence.
(3) Le pluralisme, qui est la marque de la liberté d’expression dans la sphère publique a, lui aussi, ses limites, en dehors même de toute atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Ainsi en Belgique, une loi du 23 mars 1995 réprime pénalement un délit d’opinion spécifique qu’on appelle le « négationnisme », à savoir : tout écrit ou discours publics tendant à minimiser, justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Dans le même ordre d’idées, une loi du 23 juillet 2011 interdit le port, dans l’espace public, de tout vêtement cachant la totalité ou une bonne partie du visage. Ceci vise, essentiellement, la burqa ou le niqab porté par des femmes musulmanes.
(4) Francis Delpérée est né à Liège le 14 janvier 1942.
Après des études de droit à l’Université catholique de Louvain (1964), il est reçu docteur en droit de l’Université de Paris (1968) et commence à enseigner à Louvain et à Bruxelles (Saint-Louis). Au cours des dix années suivantes, il gravit tous les échelons du cursus honorum académique et est nommé professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain en 1979.
Jusqu’en 2007, année de son accession à l’éméritat, il enseigne dans cette université le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit public comparé.
Directeur de la Revue belge de droit constitutionnel, il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles touchant au droit constitutionnel, au droit européen, au fédéralisme et à la citoyenneté, dont Le droit constitutionnel de la Belgique (2000), Le fédéralisme en Europe (2000) et La Constitution : de 1830 à nos jours, et même au-delà (2006).
Parallèlement à sa carrière académique, il est également assesseur à la section de législation du Conseil d'État entre 1985 et 2004.
Il entre au Sénat en 2004 et préside le groupe CDH depuis 2007.
Il est premier vice-président de la Commission des Affaires institutionnelles et membre dela Commissiondela Justice. Ilprésidela Commissionmixte du suivi des missions militaires belges à l'étranger.
Membre de l’Institut de France et de l’Académie Royale de Belgique, il a été promu docteur honoris causa des universités d'Aix-Marseille III (1987), Genève (1993), Ottawa (1993), Szeged (2002), Athènes (2003) et Sud Toulon-Var (2008).
Il a également reçu de nombreuses distinctions honorifiques et s’est vu octroyer le titre personnel de baron par le Roi Baudouin en 1993.
|
Résumé
Le propos de l’orateur se limite à l’espace public belge. Quel est, dans ce contexte, la portée des concepts de neutralité et de pluralisme : grammaticale, puis juridique, dans les textes normatifs d’abord, dans la jurisprudence et la doctrine ensuite ?
les mots
Les mots ne sont pas toujours univoques : il suffit d’ouvrir un dictionnaire pour le vérifier. Au sens premier, être neutre signifie s’abstenir, ne pas prendre parti. Cela peut valoir pour un individu ou une collectivité. Le pluralisme au contraire est un principe actif, valorisant la diversité : la société civile peut-elle, en effet, s’accommoder d’un espace public circonscrit par la seule expression d’une « volonté générale » que les appareils étatiques sont censés exprimer ?
les textes normatifs
Le seul service public que la constitution qualifie de « neutre » est l’enseignement organisé par les Communautés. L’orateur pense que cette qualification n’est pas exclusive mais exemplative. Le terme « pluralisme » n’appartient pas au vocabulaire de la constitution mais le régime des droits et libertés que celle-ci instaure implique la chose, tout comme la diversité que la loi organise ou favorise au sein des collectivités belges.
la doctrine et la jurisprudence
Neutralité, pluralisme : sur l’application de ces deux concepts, la doctrine et la jurisprudence ont-elles été plus loquaces ?
La doctrine distingue plusieurs types de neutralité possibles : passive, active et organisationnelle.
La « neutralité passive » consiste à ne pas tenir compte dans l’espace public des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses des personnes. Selon le Conseil d’Etat (arrêt du 20.05.2008), c’est un principe constitutionnel lié au droit à la non-discrimination et à l’égalité. Il s’applique aux institutions publiques, à leurs agents et usagers (mais pas aux mandataires publics ni aux citoyens comme tels).
La « neutralité active » fait acception de la diversité des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses : elle recherche l’équilibre ou la pondération des tendances là ou la neutralité individuelle est jugée impossible à atteindre : par exemple, dans l’information radiotélévisée (arrêt Lenaerts du 26.07.1968) ou les fonctions culturelles (loi du 16.07. 1973).
La « neutralité organisationnelle », enfin, s’applique aux programmes et au recrutement des maîtres de l’enseignement organisé par les Communautés.
Le pluralisme se déduit des articles 10 (égalité) et 11 (protection des tendances idéologiques et philosophiques) de la constitution. Il se décline sous deux formes : le pluralisme externe que manifeste la pluralité des institutions privées et publiques (enseignement, soins de santé, aide sociale etc.) et le pluralisme interne que traduit l’intégration de groupes idéologiques différents dans la direction d’une institution publique (cela va de la Banque nationale aux Transports publics en passant la sécurité sociale ou la radiotélévision…).
pour conclure :
Bref, entre la neutralité et le pluralisme, la Belgique ne choisit pas, elle conjugue et décline ces concepts sous des modes divers. Une symphonie ?
|
Voici le texte complet de la communication
du professeur Delpérée
Avant toute chose, je voudrais remercier mon ami Elio Finetti pour son invitation.
Elle me donne l’occasion de retrouver, une fois de plus, Liège, ma ville natale.
Elle me donne la chance de m’inscrire dans le sillage de conférenciers éminents. Avec eux, vous avez envisagé l’un ou l’autre aspect d’un thème important et actuel : « La neutralité ou le pluralisme », et ceci dans le cadre d’un dialogue ouvert entre les religions et les philosophies non confessionnelles.
J’ai parcouru le programme des conférences 2011-2012. Je me suis dit que j’aurais peut-être pu mieux m’exprimer sur d’autres sujets : « les catholiques dans la vie politique », « les religions dans l’Etat »... Mais ces sujets ont déjà été traités par le chanoine Eric de Beukelaer (qui a été mon étudiant à Louvain) ou ils le seront par Louis-Léon Christians (qui est mon collègue à Louvain).
Je suis juriste et donc discipliné par nature. J’essaierai ne pas empiéter sur les domaines des autres orateurs.
Comment parler aujourd’hui de la neutralité et du pluralisme ? Je vous propose trois moments distincts.
Je vous propose de nous interroger, d’abord, sur le sens ordinaire des mots que nous utilisons au cours de ce cycle de conférences. Je m’avancerai sans doute ici sur un terrain qui a déjà été profondément labouré (I).
Je voudrais ensuite, que nous nous demandions comment ces mots ont été traduits en termes et en textes juridiques — nous savons qu’il y a parfois un abîme entre le langage ordinaire et le langage, pour ne pas dire : le jargon, des juristes… — (II).
Je voudrais, enfin, m’interroger sur les interprétations que la doctrine et la jurisprudence — celle de la Cour constitutionnelle et celle du Conseil d’Etat — ont pu développer, au cours de ces dernières années, au départ de ces textes constitutionnels et législatifs. Ce qui sera aussi l’occasion de confronter la théorie à la pratique — il faudrait peut-être dire : aux pratiques — (III).
Ou, pour utiliser un autre langage, j’évoquerai successivement : les notes, la partition et la musique. En toute harmonie, je l’espère…
Chapitre premier.— Les mots (ou les notes…)[1].
« Neutralité » et « pluralisme » sont des mots simples. A première vue, ils peuvent paraître clairs. A la réflexion faite, ces mots véhiculent des imprécisions — essayons de les effacer — ou des contradictions — essayons de les lever —. Ce travail d’élucidation doit être accompli d’emblée. Il est important si nous ne voulons pas nous perdre en chemin.
Section 1. — La neutralité.
a. — Le dictionnaire Robert consacre une brève notice à la neutralité. Il nous dit que c’est l’état de ce qui est neutre. Reconnaissons que cette définition tautologique ne nous avance pas beaucoup.
Le même dictionnaire consacre, par contre, une notice importante à l’adjectif « neutre ». Il ne lui donne pas moins de six significations différentes. C’est, entre autres, une « catégorie grammaticale », celle qui ne correspond ni au masculin, ni au féminin. C’est aussi un « produit chimique », celui qui n’est ni un acide, ni une base.
b. — Le sens premier de l’adjectif « neutre » est ailleurs. Est neutre, dit le dictionnaire, celui « qui ne participe pas à un conflit », celui « qui n’est pas en guerre ».
Chacun comprend aisément le sens du mot ainsi défini.
— En 1870, la Belgique est restée neutre, elle ne s’est pas immiscée dans le conflit qui opposait la France et l’Allemagne.
— En 1914, cette même Allemagne a violé la neutralité de la Belgique.
— Durant l’entre-deux guerres, la Belgique a encore préconisé, envers et contre tout, une politique de neutralité avant de se rendre à l’évidence, de rejoindre le camp des Alliés et de participer, elle aussi, à un conflit qui durera cinq ans.
Machiavel, qui était un bon stratège ou un bon prophète, disait que « le parti de la neutralité qu’embrassent le plus souvent les princes irrésolus, (ceux) qu’effraient les dangers présents, (…) les conduit à leur ruine ».
c. — Il n’y a pas, cependant, que la réalité militaire. La neutralité n’est pas seulement le fait de l’Etat, pris globalement. Elle peut aussi être le fait des personnes, prises individuellement.
L’on dira alors qu’est neutre celui qui s’abstient de prendre parti — que ce soit dans un débat d’idées, dans un conflit social ou dans une guerre internationale.
La neutralité, c’est une forme d’abstention. La neutralité peut être imposée ou voulue, peu importe. Elle peut être organisée ou spontanée, peu importe. Mais elle requiert toujours de celui qui est neutre une attitude qui est celle de la réserve, et même du retrait. Comme disent « Les inconnus », « cela ne nous regarde pas ». Et, même si cela me regarde, j’ai décide de ne pas m’en mêler.
Section 2. — Le pluralisme.
a. — Le dictionnaire — Larousse, cette fois — définit le pluralisme comme un système, c’est-à-dire comme un ensemble cohérent de principes et de règles, qui reconnaît et valorise la diversité sous toutes ses formes, notamment celle des idées et des comportements mais aussi celle des institutions.
Le même dictionnaire donne deux exemples de ce système pluraliste. Le premier est celui du pluralisme scolaire — il faudra revenir sur la multiplicité des réseaux en Belgique —, le second est celui du pluralisme syndical. Le même exemple est utilisé dans le dictionnaire Robert.
Voyons bien comment le problème se pose. Il y a un Etat et il n’y en a qu’un seul. L’appareil public est unifié. Les autorités de cet Etat sont censées agir au nom de la volonté générale Elles font la loi, valable pour tous. Dans le même esprit, elles imposent des règlements. Elles rendent aussi la justice « au nom de la loi ».
Voilà pour la société politique. La société civile, elle, ne s’accommode pas de cette vision unificatrice. Elle ne s’accommode pas de l’unité de vues, d’attitudes ou d’institutions. La démocratie, comme dit Alain Touraine, est fondée sur le dialogue et le partage. Elle suppose le pluralisme. Elle encourage le pluralisme. Si nécessaire, elle défend et préserve le pluralisme.
La société démocratique est une société pluraliste.
b. — Quelle justification donnée à ce principe de pluralisme ? Elle est double.
Une première justification se trouve dans la vie courante. Vous connaissez la formule du fabuliste, Antoine Houdar de La Motte, un contemporain de La Fontaine. Il disait : L’ennui naquit un jour de l’uniformité. La diversité est gage de liberté et de créativité. Elle en est aussi le fruit.
Une deuxième justification est plus politique. Raymond Aron, le chantre du libéralisme politique au XXe siècle n’a pas manqué de souligner que la démocratie est ce régime constitutionnel qui présente une particularité. Il reconnaît la légitimité du pluralisme, de la concurrence et même du conflit. Mais il a la bonne idée de les inscrire dans le cadre de règles du jeu préalablement définies.
c. — Nous constatons aussitôt qu’à la différence de la neutralité, le pluralisme n’est pas une forme d’abstention. C’est plutôt un principe d’action et d’expression. Je parle, j’écris, j’interviens dans telle ou telle discussion, j’agis, je décide mais je le fais évidemment à côté d’un ensemble d’autres personnes, seules ou en groupe, qui utilisent les mêmes facultés.
L’on commettrait une erreur en opposant systématiquement la neutralité et le pluralisme. Je peux me montrer neutre, par exemple, aux fins de respecter et de faire respecter la pluralité des opinions qui se manifestent dans un groupe déterminé. Je peux me montrer neutre à côté d’autres personnes qui sont engagées et je contribue ainsi à assurer un certain pluralisme.
Chapitre II.— Les textes (ou la partition)
Voilà pour deux mots qui relèvent du vocabulaire courant. Voilà pour les idées générales — très ou trop générales peut-être… — qui concernent la neutralité et le pluralisme. Deuxième question. Comment le système juridique va-t-il recevoir ces mots et ces concepts ? Va-t-il les inscrire dans des textes ? Va-t-il transformer des réalités sociales en obligations juridiques ? Va-t-il assortir la méconnaissance de ces obligations d’un ensemble de sanctions ?
Moi, ma boussole, c’est la Constitution — celle de 1831 mais surtout celle de 2012, avec les évolutions importantes que le texte originel a pu subir depuis plus de cent quatre-vingts ans —. Je suis donc allé voir quelle était la direction que m’indiquait l’aiguille de ma boussole sur le double thème de la neutralité et du pluralisme.
Disons d’emblée que la Constitution n’est pas très loquace sur ce double terrain. A moins d’essayer de lire entre les lignes. Mais, reconnaissons-le d’emblée. La moisson risque de ne pas être très abondante. La Constitution belge, en particulier, n’est pas un texte d’allure philosophique. Elle se veut assez pragmatique, c’est ce qui en fait la richesse et la valeur.
Section 1. — La neutralité.
La Constitution ne dit pas grand-chose de la neutralité. Elle n’en parle pas. Sauf dans un cas, celui de l’enseignement. Ce silence (relatif) est interpellant.
a. — La Constitution contient une référence, et une seule, à la neutralité. C’est à propos de l’enseignement. « La Communauté, dit l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, organise un enseignement qui est neutre ».
La référence est limitée. Elle est concise aussi et demande manifestement quelque explicitation, y compris dans la Constitution.
La référence est limitée. Elle ne concerne que l’enseignement et, de manière spécifique, l’enseignement que la Communauté organise. A contrario, elle ne concerne pas l’enseignement qui n’est pas organisé et dispensé par la Communauté ou par les institutions qu’elle met en place. Cette autre forme d’enseignement ne doit pas être neutre. Elle peut répondre, comme le précise la Cour constitutionnelle, à des options pédagogiques (la méthode Freynet…) ou à des choix idéologiques (le libre examen… )qui lui sont propres.
La référence est concise. Qu’est-ce que la neutralité qui est ainsi imposée à l’enseignement de la Communauté — à quelque niveau que ce soit — ? « La neutralité, est-il précisé, implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves ». Il faudra revenir sur l’utilisation du mot « notamment » qui ouvre évidemment la porte à d’autres considérations que celle du respect des conceptions de vie des parents ou des élèves.
b. — Qu’en est-il de la neutralité en dehors de l’enseignement communautaire ? Dans l’administration, la police, l’armée, la justice, les services publics ?
La Constitution se tait. Ce silence peut être interprété de deux manières.
Première interprétation, la plus individualiste. La Constitution tolérerait, jusque dans l’organisation et le fonctionnement des autorités publiques, diverses formes d’engagement — politique, idéologique, social… — . Elle considérerait que le pluralisme mérite de l’emporter, en toute circonstance, sur la neutralité et qu’il l’empêche, en tout cas, de se déployer dans l’espace public.
Deuxième interprétation, plus institutionnelle. La neutralité est une règle traditionnelle du droit public. C’est une évidence. A un point tel que la Constitution ou la loi ne jugent pas nécessaire d’y faire explicitement référence. Dans cette deuxième hypothèse, la neutralité s’impose à toutes les autorités publiques et à leurs agents comme une sorte de règle immanente. C’est une règle d’organisation. C’est une règle de fonctionnement. Pas besoin de le dire, pas besoin de l’affirmer, pas besoin de définir les contours de la neutralité ou d’en préciser le contenu.
c. — Il va sans dire que j’opte pour la seconde hypothèse. L’Etat, les pouvoirs publics, les services publics, les fonctionnaires, les militaires ou les juges sont neutres. Ils doivent être neutres. C’est la loi de leur fonction. C’est la règle élémentaire qui commande l’exercice de leurs tâches et de leurs activités.
Dans ces conditions, la disposition inscrite dans l’article 24 de la Constitution à propos de l’enseignement, c’est un exemple, ce n’est pas une exception. Cet exemple illustre une règle qui mérite de recevoir une portée plus générale.
Section 2. — Le pluralisme.
La Constitution est tout aussi discrète sur le thème du pluralisme.
a. — La Constitution accepte — comment faire autrement dans une société démocratique… — la pluralité des opinions, celle des cultes, celle des enseignements, celle des médias, celle des associations, celle des partis… Le régime des droits et libertés qui reviennent à chacun, y compris sur le plan politique et social — « Des Belges et de leurs droits » —, engendre forcément la diversité des points de vue et celle de leur expression.
La Cour européenne des droits de l’homme — qui est censée exprimer les préoccupations démocratiques des Etats de la grande Europe — accorde une importance toute particulière à ce principe de pluralisme. Elle part de l’idée que le débat d’opinion, porté par des formations ou des courants d’idées, est au cœur même du phénomène démocratique. Elle censure les atteintes les plus légères qui pourraient être portées à ce principe.
Vous connaissez le célèbre arrêt Handyside c/ Royaume-Uni du 7 décembre 1976 (n° 5493/72). Je cite : « La liberté d'expression vaut non seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ». Avec cette explication : « Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de ‘société démocratique’ ».
b. — L’idée de pluralisme est donc bien ancrée dans les textes, les comportements et les mentalités. Elle commande la conduite des citoyens. Par contre, la Constitution ne s’interroge pas de manière approfondie sur la traduction institutionnelle des phénomènes de pluralité et de diversité. Elle ne se demande pas quelles sont les conséquences politiques qui découlent de ce postulat philosophique.
Elle ne s’engage sur cette voie que dans trois cas.
c. — Le pluralisme institutionnel s’installe à trois moments différents.
— En 1831, la Constitution reconnaît la diversité éducative. En proclamant que « l’enseignement est libre », l’article 24, § 1er, alinéa 1er, consacre le droit pour tout un chacun (Etat, communauté, région, collectivité locale, évêché, paroisse, congrégation religieuse, association de parents…) de créer une école et d’en assurer la libre administration. Ce droit, précise la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 119/2008, ne saurait être limité « de manière arbitraire ».
Ce faisant, la Constitution reconnaît et organise la pluralité des institutions d’enseignement et des réseaux. « La liberté d’enseignement… assure le droit d’organiser — et donc de choisir — des écoles basées sur une philosophie confessionnelle ou non-confessionnelle déterminée ». C’est là un aspect essentiel de ce qu’il est convenu d’appeler « la liberté active de l’enseignement » (n° 107/2009).
— En 1893, la Constitution favorise la diversité politique. Celle-ci résulte notamment de la création d’un Parlement où, depuis 1893, les forces politiques en présence se partagent le pouvoir selon les règles de la représentation proportionnelle. Et l’on sait que, depuis 1921, et l’instauration du suffrage universel, la mise en œuvre de cette règle conduit à la mise en place de gouvernement eux-mêmes pluralistes.
Les coalitions gouvernementales — à quatre, à cinq ou à six — sont peut-être les figures les plus emblématiques du pluralisme institutionnel, tel qu’il se pratique jusqu’au sommet de l’Etat.
— A partir de 1970, la Constitution instaure la diversité normative. Celle-ci résulte de l’instauration, depuis 1970, d’un système fédéral de gouvernement. E pluribus unum, comme on dit dans les milieux fédéralistes. Le pluralisme linguistique, culturel et, plus largement communautaire, ne peut être passé sous silence, même s’il devrait appeler de plus larges développements.
Pas besoin de rappeler que la loi fédérale et les lois fédérées — il faudrait aussi évoquer les règles de droit européen — sont placées sur un pied d’égalité. Elles peuvent se prévaloir de légitimités politiques différentes. Mais aucune d’elles ne saurait l’emporter sur les autres. C’est un élément essentiel de notre paysage institutionnel.
Encore faut-il rappeler une évidence : au sein de chacune des collectivités fédérées, le pluralisme s’impose également comme une règle démocratique. Le fédéralisme ne saurait avoir pour objet ou pour effet de renfermer chaque société politique particulière sur elle-même et de lui permettre de faire obstacle aux règles du pluralisme, y compris linguistique et culturel. Je le constate. Ce message-là, c’est un message qu’il est parfois difficile de faire entendre dans notre pays.
Chapitre III.— Les interprétations (ou la musique)
Les concepts utilisés sont généraux, les textes constitutionnels sont discrets… La question qui se pose est de savoir si la doctrine et la jurisprudence ont été en mesure de combler ces lacunes. Et si, au contact d’un ensemble de réalités sociales et culturelles, elles ont pu faire œuvre utile et, pour tout dire, clarificatrice.
Ma réponse risque d’être celle d’un Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les débats restent très ouverts.
D’une part, la doctrine et la jurisprudence ont fait œuvre utile en introduisant, sur des points essentiels, des distinctions élémentaires. Il faut les avoir à l’esprit si l’on veut approfondir la matière de la neutralité et du pluralisme..
D’autre part, la même doctrine et la même jurisprudence n’ont pas véritablement choisi entre les branches de l’alternative qu’elles avaient contribué à mettre en évidence. Elles ont plutôt cherché à concilier les points de vue en présence.
Le jeu interprétatif se révèle, lui aussi, pluraliste…
Section 1. — La neutralité.
Reprenons le texte constitutionnel qui est consacré à la neutralité — celle de l’enseignement communautaire. Il dit ceci. La neutralité « implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses ». Pourquoi notamment… ? Pourquoi l’article 24 de la Constitution impose-t-il « notamment » le respect de certaines conceptions ? Quelles sont les autres valeurs ou les autres considérations que la Constitution entend imposer ? Quel poids respectif faut-il donner aux conceptions de vie et à d’autres considérations ?
L’obscurité du texte — qu’éclaire à peine les travaux parlementaires — a décuplé l’imagination des interprètes. L’on a vu apparaître, dans le débat, trois notions — celles de la neutralité passive, de la neutralité active et de la neutralité organisationnelle —. De quoi s’agit-il ? Et quelle portée donner à ces nouveaux concepts ?
a. — La neutralité passive est un principe de bonne administration. Elle invite à ne pas tenir compte, dans un espace public particulier, des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses des personnes et notamment des usagers.
L’assemblée générale du Conseil d’Etat a rendu un avis important à ce sujet, le 20 mai 2008. L’avis — qui peut être considéré comme un avis de principe — se décompose en quatre points.
— Un. « La neutralité des pouvoirs publics est un principe constitutionnel ». Voilà qui clôt la controverse interprétative que j’évoquais il y a un instant.
— Deux. Le principe de neutralité « n’est pas inscrit comme tel dans la Constitution », ce que nous avions effectivement relevé, mais ce principe est « intimement lié à l’interdiction de discrimination en général et au principe d’égalité des usagers du service public, en particulier ». Autrement dit, la neutralité n’est pas faite pour l’administration. Elle est conçue à l’intention de ceux qui y ont recours.
— Trois. « Dans un Etat de droit démocratique, l’autorité se doit d’être neutre parce qu’elle est (la formule est importante) l’autorité de tous les citoyens et pour tous les citoyens ». Abraham Lincoln n’est pas loin.
— Quatre. L’autorité « doit, en principe, traiter (tous les citoyens) de manière égale sans discrimination ». Il est précisé que des régimes distincts ne sauraient se fonder ni sur la religion, ni sur la conviction, ni sur la « préférence pour une communauté ou un parti ». La neutralité s’impose tous azimuts.
Si l’on veut bien considérer que l’avis du 20 mai 2008 est un peu la « bible » de nos conceptions juridiques en matière de neutralité, il ne faut pas hésiter à en dégager des conséquences importantes. Celles-ci concernent l’Etat, les mandataires publics, les agents publics et les citoyens.
— L’Etat, tout comme ses démembrements, doit être neutre. Il doit s’afficher comme neutre.
Au risque de choquer certains d’entre vous, je dirai que le crucifix n’est pas à sa place dans une école publique, dans une maison communale ou dans un tribunal. [ ndlr du blog : sed contra, voir note 2 sous le préambule de ce "post" ]
Je ne peux aussi que déplorer la pratique qui est celle des journaux télévisés et qui revient à accoler une étiquette politique derrière le nom d’un ministre ou d’un bourgmestre. Le Ministre des Finances est le Ministre des Finances, pour tous les Belges, et pas seulement pour ceux qui se réclament du CD&V. Le bourgmestre de Liège est le bourgmestre de Liège, pour tous les Liégeois et pas seulement pour ceux qui se réclament du PS… Etcetera.
— Qu’en est-il des mandataires publics ? Sont-ils eux aussi astreints à un devoir de neutralité ? Cela n’aurait aucun sens. Les élus sont choisis en fonction de leurs convictions — majoritaires ou minoritaires —, en fonction de leurs conceptions — philosophiques ou religieuses —, en fonction de leurs options — économiques ou sociales
Ils sont les représentants d’une partie de la Nation et cette partie de la Nation les a choisis en fonction de ces caractéristiques. Leur demander d’adopter, une fois élus, un uniforme intellectuel ou vestimentaire est insensé.
Ce sont les mêmes qui ne voyaient, hier, aucun inconvénient à ce que l’abbé Pierre ou le chanoine Kir viennent en soutane à l’Assemblée nationale qui se plaignent aujourd’hui que Mahinur Ozdemir porte un joli voile sur de jolis cheveux lorsqu’elle siège au Parlement bruxellois ou au conseil communal de Schaerbeek.
— La neutralité des pouvoirs publics ne saurait être atteinte si les agents publics n’observent pas, de manière stricte, dit le Conseil d’Etat, « les principes de neutralité »[2].
Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public ne doit pas adopter une attitude ou un comportement, il ne doit pas tenir des propos, il ne doit pas porter un vêtement qui pourrait laisser croire qu’il va traiter différemment celui qui adhère aux mêmes valeurs ou aux mêmes préoccupations que lui et celui qui professe d’autres opinions. Il ne doit pas donner à penser qu’il va favoriser le premier et maltraiter le second.
L’observation vaut surtout pour l’agent public qui est au comptoir et qui se trouve en contact direct avec le public.
En dehors de l’exercice de ses fonctions, le même agent public retrouve toute liberté d’action et d’expression. Avec néanmoins un devoir de réserve vis-à-vis de son employeur public. Et un devoir de discrétion à l’égard des dossiers qu’il traite effectivement.
— En principe, le citoyen n’est pas soumis à un devoir de neutralité. Il parle, il écrit, il adopte telle ou telle attitude. Il le fait en fonction de ses conceptions politiques, philosophiques ou religieuses. Nul ne peut s’immiscer dans ces choix. Le respect de la vie privée fait aussi partie des obligations qui s’imposent à tous, en ce compris aux autorités publiques.
Il n’empêche. Ce même citoyen entre en contact avec des institutions — privées ou publiques —. Ce qui signifie que, s’il s’adresse à telle institution, il est censé souscrire aux règles que cette institution a établies — pour autant que ces règles ne portent pas atteinte aux droits et libertés des citoyens.
L’institution publique peut notamment imposer à ceux qui ont recours à ses services un ensemble de devoirs. Rien ne l’empêche de prescrire un devoir de neutralité.
Prenons l’exemple d’un hôpital. L’institution fixe ses horaires, organise le service de consultation, recrute son personnel, administre les soins, distribue les repas selon les modalités qu’il détermine. En entrant dans tel hôpital, le citoyen souscrit, au moins de manière implicite, à la charte de l’établissement. Si les règles ne lui conviennent pas, s’il souhaite disposer, par exemple, d’un plateau repas qui correspond mieux à ses choix religieux ou s’il préfère être traité par du personnel qui répond à telle ou telle condition — race, sexe, langue… —, il ira voir ailleurs. La pluralité des institutions doit lui permettre d’effectuer un choix personnel.
b. — Voilà pour la neutralité passive. Il est superflu de préciser qu’elle est bien entrée dans les esprits et dans les mœurs. Dans un avis du 1er juillet 1996, le Conseil d’Etat va jusqu’à dire que les écoles organisées par les pouvoirs publics et la Communauté qui en assure le contrôle doivent établir, je cite, « une sorte de glacis protecteur de la liberté de conscience des élèves ». Aucune influence dans un sens ou dans une autre n’est admise[3].
De temps à autre, des voix discordantes se font néanmoins entendre. Elles préconisent la neutralité active. A savoir celle qui fait délibérément acception de la diversité des appartenances philosophiques, idéologiques ou religieuses.
La neutralité active part du postulat que « c’est du choc des idées que jaillit la lumière » et, dans la foulée, la neutralité. Elle encourage l’expression des préoccupations particulières. Elle n’accepte la primauté d’aucune d’elles. Elle n’exclut ni les signes ni les insignes. Elle organise le débat. Plutôt que de repousser, notamment à l’école, l’expression des idées partisanes en dehors de ses murs et de taire les controverses politiques, économiques et sociales, elle va susciter et encourager le débat d’idées. Elle part de l’idée que chacun sera assez grand ou assez adulte pour se faire in fine ses propres convictions.
Cette préoccupation apparaît notamment dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. La neutralité d’un service public culturel ne doit pas, dit la section du contentieux, être recherchée dans le cerveau ou le cœur de chacun des agents. Cette neutralité individuelle est impossible à atteindre. Il faut plutôt compter sur la coexistence et la confrontation de diverses préoccupations — portées par ceux qui assument des missions publiques de nature culturelle — pour voir émerger une véritable neutralité.
L’arrêt Lenaerts du 26 juillet 1968 est rendu à propos du fonctionnement du service public de la radiodiffusion[4]. Selon le Conseil d’Etat, une information objective et équilibrée ne peut être obtenue que dans une équipe de rédaction où coexistent différentes tendances politiques ou philosophiques — on suppose que c’est au prorata de leur force respective dans les Parlements de communauté.
Cette même préoccupation apparaît dans la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite loi du pacte culturel. Elle mériterait de larges développements. Il me suffit de citer l’article 20 qui compose un chapitre IX (Des garanties relatives au personnel). L’article 20 concerne les membres du personne qui exercent « des fonctions culturelles dans les établissements et organismes culturels ». En fonction de quels critères seront-ils recrutés, désignés ou promus ? La réponse est simple. Il faut respecter le principe de l’égal accès aux emplois publics. Mais la loi précise aussitôt qu’il y a lieu aussi de tenir compte d’une nécessité — le terme est fort —, celle d’assurer une « répartition équilibrée des fonctions, attributions et affectations entre les différentes tendances représentatives », en clair des partis politiques.
Ma question est simple. Qui peut croire que ces créatures politiques, choisies selon des critères politiques, vont, lorsqu’elles auront été nommées, faire abstraction de ces appartenances politiques, se conduire comme des vierges et pratiquer une politique de neutralité ?
c. — Neutralité passive, neutralité active… La neutralité organisationnelle renvoie à une autre réalité encore. Elle s’impose dans le domaine de l’enseignement. Elle requiert que l’institution de la Communauté à laquelle est imposée l’obligation de neutralité réponde dans l’aménagement de ses programmes et dans le recrutement de ses maîtres à des exigences spécifiques.
La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dite loi du « pacte scolaire », indique, par exemple, que seules peuvent être considérées comme neutres les écoles qui « respectent toutes les conceptions philosophiques ou religieuses des parents qui leur confient leurs enfants et dont au moins trois quarts du personnel enseignant sont porteurs d’un diplôme de l’enseignement officiel ou neutre ».
Section 2. — Le pluralisme.
L’idée de pluralisme se prête-t-elle à des applications plus commodes ?
L ’article 10 de la Constitution énonce la règle fondamentale selon laquelle « les Belges sont égaux devant la loi ». L’article 11 ajoute que « la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ». Passons sur le « notamment » qui s’apparente à un tic langagier de la part du pouvoir constituant — il a peur d’oublier quelque chose en chemin —. Interrogeons-nous plutôt sur la protection des minorités idéologiques et philosophiques. Les commentateurs du texte s’accordent pour dire qu’il est mal rédigé et qu’il aurait fallu parler de la protection des « tendances » idéologiques et philosophiques — les majoritaires comme les minoritaires —. C’est ce que fait la loi dite loi du pacte culturel.
Ladite loi attire notre attention sur deux formes, à vrai dire fort différentes, de pluralisme. Externe et interne.
a. — Il y a le pluralisme externe. Celui qui se traduit par la pluralité des institutions, chacune d’elles répondant à un courant particulier d’idées. C’est le phénomène bien connu de la « pilarisation ». Des écoles libres et des écoles officielles, des hôpitaux libres et des hôpitaux publics, des syndicats et des caisses publiques de chômage. Et ainsi de suite.
En Belgique, la pluralité des institutions, qu’elles soient publiques ou privées, a toujours paru être un gage de liberté. C’est la traduction du principe du libre choix. C’est aussi un élément de notre histoire sociale. Il présente néanmoins l’inconvénient de m’obliger à décliner, aux différents moments de ma vie, un ensemble d’appartenances. Mais il est vrai que celles-ci ne sont pas définitives et qu’elles ne sont pas non plus exclusives.
Dans la mesure où la sixième réforme de l’Etat entend transférer certaines compétences sociales aux communautés et aux régions, la question se pose, avec acuité, de savoir qui va recueillir de telles compétences. Sur le plan normatif, la question se pose de avoir qui de la communauté et de la région va recevoir telle compétence. Sur le plan de la distribution des prestations sociales — les allocations familiales ou les aides à l’emploi — faut-il recourir à une structure publique unifiée ou faut-il, comme aujourd’hui, faire confiance à des caisses patronales ou syndicales diversifiées ? .
b. — Il y a aussi le pluralisme interne. C’est celui qui se traduit par l’intégration de groupes répondant à un courant particulier d’idées dans une même institution. C’est le phénomène bien connu de la participation. Des partenaires sociaux qui disposent chacun de leur autonomie siègent, par exemple, ensemble dans les conseils d’administration d’un ensemble d’institutions publiques — cela va de la Banque nationale de Belgique jusqu’à l’Office national de sécurité sociale, en passant par la SNCB ou les TEC —.
L’exemple montre d’ailleurs que le pluralisme externe et le pluralisme interne ne s’excluent pas mais qu’ils peuvent s’inscrire dans un mouvement de complémentarité.
*
Le programme académique de cette année s’intitule : « Neutralité ou pluralisme ». La préposition « ou » est significative. Elle induit cette idée : « Neutralité versus pluralisme… ».
Le système belge montre peut-être qu’il est aussi possible de concilier « la neutralité et le pluralisme ». L’un et l’autre ne sont pas contradictoires.
Pas besoin de rappeler que le pluralisme des idées politiques qui prévaut au niveau parlementaire doit se concilier avec la neutralité qui s’impose aux autorités gouvernementales et administratives.
Pas besoin de rappeler que le pluralisme des institutions d’enseignement doit se concilier avec la neutralité qui s’impose à certaines d’entre elles.
Pas besoin de rappeler que la neutralité qui s’impose aux établissements de l’enseignement communautaire s’accompagne de l’obligation de créer des cours de religion ou de morale non-confessionnelle.
Pas besoin de rappeler que le pluralisme de la société civile peut s’accorder avec la neutralité des pouvoirs publics.
Ce qui est une manière de dire que l’espace public n’est jamais clos. Pour une raison simple. Il y a des hommes et des femmes qui se meuvent dans l’espace public. Chacun d’eux est porteur de son propre bagage. Le rôle de l’Etat est de faire coexister, de la manière la plus harmonieuse qui soit, cet ensemble de personnes. Non pas en imposant brutalement — j’allais dire : bêtement — une règle de neutralité à tous et à toutes mais en leur permettant de se reconnaître, s’ils le veulent, dans des organisations neutres ou, s’ils le préfèrent, dans des organisations qui répondent à leurs préoccupations ou à leurs convictions.
La neutralité et le pluralisme sont appelés, c’est le vœu que je forme, à faire bon ménage. Ou, pour continuer dans la veine musicale, à vivre en harmonie.
oOo
[1] Je ne suis pas Raymond Devos (tant pis pour vous, cela aurait été plus drôle). Mais, comme lui, je me dis qu’il faut parfois se méfier des mots qui meublent notre langage. Nous pensons volontiers que le sens des mots est accepté par tous. Nous imaginons que, dans le meilleur des cas, ils ont fait l’objet d’une définition en bonne et due forme. Nous sommes prêts à consulter l’un ou l’autre dictionnaire pour dissiper les équivoques — mais les dictionnaires peuvent nous renvoyer à plusieurs significations.
[2] Comme l’écrit François Luchaire, dans un ouvrage sur La protection constitutionnelle des droits et libertés, « la neutralité interdit à un membre de l’enseignement public de s’en prendre à une religion ou à une croyance ou, au contraire, de chercher à l’imposer à ses élèves ; une propagande religieuse ou antireligieuse ne lui est pas permise » (p. 315).
[3] L’école est incolore, inodore et insipide, si je puis utiliser cette formule. Les identités sont déposées au seuil de l’école. Elles sont du domaine du for intérieur. Elles ne sauraient s’exprimer qu’à l’extérieur des bâtiments scolaires.
[4] Cet arrêt est contredit par un arrêt du 15 juillet 1993 dela Cour d’arbitrage : « Un tel système emporte inévitablement que des agents puissent se voir défavorisés, en dépit de leurs mérites, en raison de leurs convictions idéologiques et philosophiques ».