EGLISE DU SAINT-SACREMENT
Boulevard d’Avroy, 132 à Liège

|
DIMANCHE 2 FEVRIER 2014 FÊTE DE LA CHANDELEUR Présentation de Jésus au Temple et purification de Marie
Cette fête est une des plus anciennes, sinon la plus ancienne des fêtes mariales. Célébrée à Jérusalem dès le IVe siècle, la fête de la Purification passa ensuite à Constantinople, puis à Rome, où on la trouve au VIIe siècle, associée, le 2 février, à une procession qui semble être antérieure à la fête de la Vierge. Plusieurs mélodies du graduel romain encore en usage pour cette solennité sont manifestement d’origine byzantine. |
10 heures, bénédiction et distribution des cierges suivies de la messe en grégorien (missel de 1962)
Antienne « Lumen ad revelationem gentium », Propre de la messe « Suscepimus », Kyriale IX « cum jubilo » (XIIe s.), chantés par la schola grégorienne. A l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers
11h15, bénédiction et distribution des cierges suivies de la messe en français (missel de 1970)
Antienne « Lumen ad revelationem gentium » et chants de la « messe des anges » A l'orgue, Mutien Omer Houziaux, et au violoncelle Octavian Morea.
 Les chrétiens sont toujours en fête ; ils ont pour chaque jour du calendrier un nouveau motif de se réjouir de la bonté et de la beauté de la création, chaque jour une bonne raison de fêter la puissance de la grâce du Christ. La Chandeleur est une de ces nombreuses fêtes qui émaillent le cycle de l'année liturgique. Et ces fêtes sont bien réelles ; elles ne sont pas de simples inventions de croyants, car la création est réellement très belle et les œuvres de la grâce encore plus belles.
Les chrétiens sont toujours en fête ; ils ont pour chaque jour du calendrier un nouveau motif de se réjouir de la bonté et de la beauté de la création, chaque jour une bonne raison de fêter la puissance de la grâce du Christ. La Chandeleur est une de ces nombreuses fêtes qui émaillent le cycle de l'année liturgique. Et ces fêtes sont bien réelles ; elles ne sont pas de simples inventions de croyants, car la création est réellement très belle et les œuvres de la grâce encore plus belles.
En cette fête de la Chandeleur, on porte un cierge en procession, symbole de la vraie lumière qui luit dans les ténèbres. Les visages se trouvent ainsi irradiés, des plus jeunes aux plus anciens, de toutes conditions, par ces flammes vacillantes qui pourtant éclairent et réchauffent.
Le vieillard Siméon a porté, lui aussi, sa bougie ; c'était la Lumière du monde, et son âme en fut toute illuminée. Comme le chante l'alleluia de la messe de ce jour : « Le vieillard portait l'enfant, mais c'est l'enfant qui conduisait le vieillard » ! L'Esprit Saint ne lui avait-il pas promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu l'Oint du Seigneur ? Alors il avait attendu toute sa vie… confiant en la promesse.
L'attente de ce fils d'Israël apparaît ainsi comme une dimension intérieure au christianisme, face au mystère qui attend sa révélation ultime. Il y a en chacun de nous un Siméon qui attend. Ah ! Si seulement nous avions pu voir quelle joie pétillait dans les yeux de ce vénérable vieillard quand il sut que l'enfant qu'il tenait dans ses bras était l'Envoyé du Seigneur ! Mais peut-être la verrons-nous, cette joie, sur un visage illuminé, pendant la procession aux flambeaux ? Une simple bougie peut-elle éclairer autant un visage ? Assurément, un mystère est là, au cœur de cette flamme, qui nous attire, nous illumine et nous réchauffe.Réf. ici Chant grégorien au Thoronet : antienne de procession pour la Chandeleur
« Daigne, Seigneur, faire briller de la lumière de la bénédiction céleste ces cierges que nous, tes serviteurs, désirons porter rutilants de lumière : en sorte que dignes nous-mêmes de t'en faire l'hommage, nous méritions d'être aussi présentés dans le temple sacré de ta gloire ». (bénédiction des cierges)
Antienne "Lumen ad revelationem gentium":




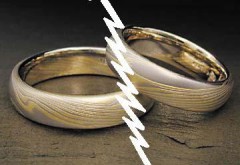 Le pape François a convoqué un synode sur la famille pour l’automne 2014. On y traitera notamment de la délicate question des personnes divorcées-remariées et de leur accès à l’Eucharistie.
Le pape François a convoqué un synode sur la famille pour l’automne 2014. On y traitera notamment de la délicate question des personnes divorcées-remariées et de leur accès à l’Eucharistie.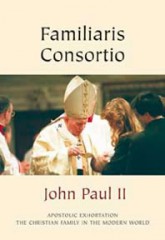 évêques, Jean-Paul II, au n. 68, se posait la grave question de savoir si l’on pouvait accorder la célébration d’un mariage chrétien à qui ne vit pas la foi (et dont la demande répond par exemple à des motivations de caractère social). S’appuyant sur le droit fondamental au mariage et sur le fait que, pour un catholique, il n’y a pas de mariage en dehors du sacrement, le pape considérait que la simple demande du sacrement traduisait le minimum de foi nécessaire. Cette attitude manifeste la sollicitude maternelle de l’Eglise pour tous ses fidèles.
évêques, Jean-Paul II, au n. 68, se posait la grave question de savoir si l’on pouvait accorder la célébration d’un mariage chrétien à qui ne vit pas la foi (et dont la demande répond par exemple à des motivations de caractère social). S’appuyant sur le droit fondamental au mariage et sur le fait que, pour un catholique, il n’y a pas de mariage en dehors du sacrement, le pape considérait que la simple demande du sacrement traduisait le minimum de foi nécessaire. Cette attitude manifeste la sollicitude maternelle de l’Eglise pour tous ses fidèles. Ces deux textes évoquent deux voies de solution. La première est « curative » : pour ceux qui ont eu recours au divorce, il faut, comme le dit Mgr Müller, examiner s’ils sont vraiment mariés. Si leur mariage est nul, leur divorce est inexistant et ils peuvent, dûment préparés, se marier à l’Eglise et bien évidemment recevoir l’Eucharistie. Il ne faut pas cacher que cette voie entraîne un défi, celui de prouver, devant le tribunal ecclésiastique, que manquait le discernement concernant les propriétés essentielles du mariage au moment de sa célébration. C’est sans doute l’une des questions qui sera abordée par le synode sur la famille convoqué par le pape François pour l’automne 2014.
Ces deux textes évoquent deux voies de solution. La première est « curative » : pour ceux qui ont eu recours au divorce, il faut, comme le dit Mgr Müller, examiner s’ils sont vraiment mariés. Si leur mariage est nul, leur divorce est inexistant et ils peuvent, dûment préparés, se marier à l’Eglise et bien évidemment recevoir l’Eucharistie. Il ne faut pas cacher que cette voie entraîne un défi, celui de prouver, devant le tribunal ecclésiastique, que manquait le discernement concernant les propriétés essentielles du mariage au moment de sa célébration. C’est sans doute l’une des questions qui sera abordée par le synode sur la famille convoqué par le pape François pour l’automne 2014.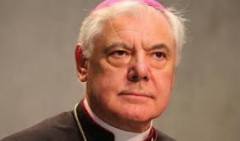

 r ? Veut-il se révéler à tous ou à quelques privilégiés? Que signifient ces jeux d’ombre et de lumière entre Lui et nous? En réalité, Dieu se révèle en se cachant et il se cache en se révélant. S’il agit de la sorte c’est par amour pour nous, car sa lumière est trop forte pour nos yeux, sa toute-puissance trop bouleversante pour notre fragilité : « L’homme ne peut me voir sans mourir » (Ex 33, 20), dit-il à Moïse, car il y a un abîme entre la sainteté de Dieu et l’indignité de l’homme, souligne la Bible de Jérusalem en commentant ce verset. Cette prévenance divine, cette souveraine délicatesse est la modeste porte d’entrée qui nous permet d’accéder au sens chrétien du mystère. : les sacrements ne sont rien d’autre que de simples fenêtres ouvertes sur l’infini, des signes matériels tangibles qui révèlent et voilent en même temps des réalités spirituelles agissantes et concrètes quoique ineffables et indicibles. Sous d’humbles apparences matérielles (pain, vin, eau, huile, souffle…), c’est l’Esprit de Dieu qui accepte de se donner par les pauvres mains et les paroles de l’homme. Pourra-t-on jamais mesurer l’humilité d’un tel Dieu qui, par pur amour, ose s’abandonner à nous ! Quand le prêtre élève l’hostie consacrée, c’est non seulement Jésus-Christ qui se montre sous les apparences du pain, c’est aussi le cosmos et tout ce qu’il renferme qui s’offre à nous, car c’est par Lui que tout fut créé (Jn 1, 3), Lui que le Père a aimé avant la fondation du monde (Jn 17, 24). Ainsi, par la foi, nous sont offerts l’amour et la « connaissance du Christ qui surpasse tout » (Ph 3, 8). Or, cette connaissance mystique ne s’analyse pas comme une règle de physique ou de mathématique, elle ne se cherche pas à la manière de l’alchimie quêtant la pierre philosophale, dans la numérologie, dans les astres, le spiritisme ou les cartes à jouer : comme l’écrit saint Paul, elle s’offre à nous et par nous à la manière d’un « parfum » (2 Co 2, 14).
r ? Veut-il se révéler à tous ou à quelques privilégiés? Que signifient ces jeux d’ombre et de lumière entre Lui et nous? En réalité, Dieu se révèle en se cachant et il se cache en se révélant. S’il agit de la sorte c’est par amour pour nous, car sa lumière est trop forte pour nos yeux, sa toute-puissance trop bouleversante pour notre fragilité : « L’homme ne peut me voir sans mourir » (Ex 33, 20), dit-il à Moïse, car il y a un abîme entre la sainteté de Dieu et l’indignité de l’homme, souligne la Bible de Jérusalem en commentant ce verset. Cette prévenance divine, cette souveraine délicatesse est la modeste porte d’entrée qui nous permet d’accéder au sens chrétien du mystère. : les sacrements ne sont rien d’autre que de simples fenêtres ouvertes sur l’infini, des signes matériels tangibles qui révèlent et voilent en même temps des réalités spirituelles agissantes et concrètes quoique ineffables et indicibles. Sous d’humbles apparences matérielles (pain, vin, eau, huile, souffle…), c’est l’Esprit de Dieu qui accepte de se donner par les pauvres mains et les paroles de l’homme. Pourra-t-on jamais mesurer l’humilité d’un tel Dieu qui, par pur amour, ose s’abandonner à nous ! Quand le prêtre élève l’hostie consacrée, c’est non seulement Jésus-Christ qui se montre sous les apparences du pain, c’est aussi le cosmos et tout ce qu’il renferme qui s’offre à nous, car c’est par Lui que tout fut créé (Jn 1, 3), Lui que le Père a aimé avant la fondation du monde (Jn 17, 24). Ainsi, par la foi, nous sont offerts l’amour et la « connaissance du Christ qui surpasse tout » (Ph 3, 8). Or, cette connaissance mystique ne s’analyse pas comme une règle de physique ou de mathématique, elle ne se cherche pas à la manière de l’alchimie quêtant la pierre philosophale, dans la numérologie, dans les astres, le spiritisme ou les cartes à jouer : comme l’écrit saint Paul, elle s’offre à nous et par nous à la manière d’un « parfum » (2 Co 2, 14). Sans le savoir, les sciences occultes ont recherché de tous temps cette « bonne odeur du Christ » (2 Co 2, 15) dans les taillis touffus de la connaissance et les âpres maquis de la gnose. Les mythes païens, la connaissance gnostique n’étaient pas inconnus de saint Paul, mais l’Apôtre des nations vouait à la destruction la « sagesse de ce monde et des princes de ce monde » (1 Co 2, 6). Selon Origène (v. 185-v. 253), Paul faisait ainsi référence à la « prétendue philosophie secrète des
Sans le savoir, les sciences occultes ont recherché de tous temps cette « bonne odeur du Christ » (2 Co 2, 15) dans les taillis touffus de la connaissance et les âpres maquis de la gnose. Les mythes païens, la connaissance gnostique n’étaient pas inconnus de saint Paul, mais l’Apôtre des nations vouait à la destruction la « sagesse de ce monde et des princes de ce monde » (1 Co 2, 6). Selon Origène (v. 185-v. 253), Paul faisait ainsi référence à la « prétendue philosophie secrète des  clefs de l’amour et de la connaissance. Si Moïse a été initié aux mystères de Dieu pour tenir tête aux prêtres égyptiens et à leur magie, c’est qu’il fut « l’homme le plus humble que la terre ait porté » (Nb 12, 3). Quant à la mère du Christ, épouse de l’Esprit Saint, qui forma en son sein la Sagesse éternelle, elle peut être à juste titre qualifiée de sedes sapientiae, siège de la Sagesse. Son cœur immaculé fait déborder la connaissance divine sur ceux qui la vénère d’un cœur simple et droit.
clefs de l’amour et de la connaissance. Si Moïse a été initié aux mystères de Dieu pour tenir tête aux prêtres égyptiens et à leur magie, c’est qu’il fut « l’homme le plus humble que la terre ait porté » (Nb 12, 3). Quant à la mère du Christ, épouse de l’Esprit Saint, qui forma en son sein la Sagesse éternelle, elle peut être à juste titre qualifiée de sedes sapientiae, siège de la Sagesse. Son cœur immaculé fait déborder la connaissance divine sur ceux qui la vénère d’un cœur simple et droit. 
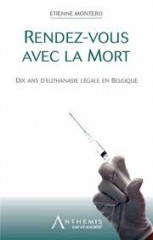
 Le mercredi 27 novembre dernier, les Commissions réunies des Affaires sociales et de la Justice du Sénat de Belgique ont adopté par 13 voix contre 4 la proposition de loi qui vise à étendre le cadre légal autorisant l'euthanasie, dans certaines conditions, aux mineurs d'âge dont un psychologue aura reconnu la capacité de discernement. Seuls les mineurs faisant face à des souffrances physiques insupportables et inapaisables, en phase terminale, pourront, encadrés par une équipe médicale, et moyennant l'accord parental, bénéficier de l'euthanasie qu'ils auront sollicitée. Les socialistes et les libéraux, francophones et néerlandophones, les Verts, ainsi que la N-VA ont voté en faveur de la proposition de loi. Les élus cdH, CD&V et Vlaams Belang ont voté contre. Le texte doit ensuite être examiné en séance plénière
Le mercredi 27 novembre dernier, les Commissions réunies des Affaires sociales et de la Justice du Sénat de Belgique ont adopté par 13 voix contre 4 la proposition de loi qui vise à étendre le cadre légal autorisant l'euthanasie, dans certaines conditions, aux mineurs d'âge dont un psychologue aura reconnu la capacité de discernement. Seuls les mineurs faisant face à des souffrances physiques insupportables et inapaisables, en phase terminale, pourront, encadrés par une équipe médicale, et moyennant l'accord parental, bénéficier de l'euthanasie qu'ils auront sollicitée. Les socialistes et les libéraux, francophones et néerlandophones, les Verts, ainsi que la N-VA ont voté en faveur de la proposition de loi. Les élus cdH, CD&V et Vlaams Belang ont voté contre. Le texte doit ensuite être examiné en séance plénière 17 contre) à la Chambre jusqu’à la signature du Roi, il reste encore un chemin à parcourir pour conclure : sera-ce avant les élections générales de mai 2014 ? Si non, la proposition devra être relevée de caducité (dans un contexte nouveau: le sénat va perdre sa capacité législative). La majorité gouvernementale (celle-ci ou la suivante) jouera-t-elle les « ponce-pilate » en se lavant les mains, comme d’habitude, dans l’eau de la liberté de conscience ?
17 contre) à la Chambre jusqu’à la signature du Roi, il reste encore un chemin à parcourir pour conclure : sera-ce avant les élections générales de mai 2014 ? Si non, la proposition devra être relevée de caducité (dans un contexte nouveau: le sénat va perdre sa capacité législative). La majorité gouvernementale (celle-ci ou la suivante) jouera-t-elle les « ponce-pilate » en se lavant les mains, comme d’habitude, dans l’eau de la liberté de conscience ? 
 Sur le site de « La Vie » (14.10.2013, extraits) Anne-Cécile Juillet note que « (…) dans la nouvelle traduction française de la Bible liturgique, diffusée en France par les éditions Mame/Fleurus à partir du 22 novembre 2013, on ne lira plus "Et ne nous soumets pas à la tentation", mais "Et ne nous laisse pas entrer en tentation". En effet, cet été, le Vatican a donné son accord à la publication d'une nouvelle traduction française complète de la bible liturgique (qui comprend l'Ancien Testament, les psaumes et le Nouveau Testament), dont la dernière version remontait à 1993 ».
Sur le site de « La Vie » (14.10.2013, extraits) Anne-Cécile Juillet note que « (…) dans la nouvelle traduction française de la Bible liturgique, diffusée en France par les éditions Mame/Fleurus à partir du 22 novembre 2013, on ne lira plus "Et ne nous soumets pas à la tentation", mais "Et ne nous laisse pas entrer en tentation". En effet, cet été, le Vatican a donné son accord à la publication d'une nouvelle traduction française complète de la bible liturgique (qui comprend l'Ancien Testament, les psaumes et le Nouveau Testament), dont la dernière version remontait à 1993 ».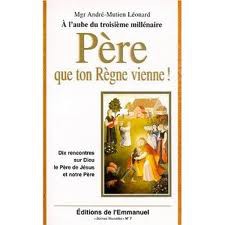 tentation ». Après Vatican II, on introduisit un contresens théologique en traduisant le grec de référence « καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν » par « ne nous soumets pas à la tentation ». N’eût-il pas été possible de dire plutôt : "ne nous soumets pas à l’épreuve", le substantif « peirasmos » ayant aussi parfois ce sens ? De bons linguistes classiques assurent que non.
tentation ». Après Vatican II, on introduisit un contresens théologique en traduisant le grec de référence « καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν » par « ne nous soumets pas à la tentation ». N’eût-il pas été possible de dire plutôt : "ne nous soumets pas à l’épreuve", le substantif « peirasmos » ayant aussi parfois ce sens ? De bons linguistes classiques assurent que non.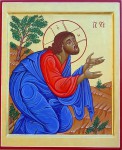 Mais par la suite, l'expression allait forcément être mal comprise et prêter à scandale. Le problème est résolu si, instruit de ces petites ambiguités linguistiques, on traduit : « Fais que nous n’entrions pas dans la tentation » ou « Garde-nous de consentir à la tentation ». De ce point de vue, l’ancienne traduction française du « Notre Père » était moins heurtante que l’actuelle (sans être parfaite), puisqu’elle nous faisait dire : « Et ne nous laissez pas succomber à la tentation ». La même difficulté existant dans de nombreuses langues européennes, plusieurs onférences épiscopales ont entrepris de modifier la traduction du « Notre Père » en tenant compte du problème posé par la version actuelle. Espérons que les conférences épiscopales francophones feront un jour de même. Si nous traduisons correctement la sixième demande (« Garde nous de consentir à la tentation » !) alors tout s’éclaire. Dans la cinquième demande, nous avons prié le Père de nous remettre nos dettes passées. Dans la septième, nous allons lui demander de nous protéger, à l’avenir, du Tentateur. Dans la sixième, nous lui demandons logiquement, pour le présent, de nous préserver du péché en nous gardant de succomber à la tentation ».
Mais par la suite, l'expression allait forcément être mal comprise et prêter à scandale. Le problème est résolu si, instruit de ces petites ambiguités linguistiques, on traduit : « Fais que nous n’entrions pas dans la tentation » ou « Garde-nous de consentir à la tentation ». De ce point de vue, l’ancienne traduction française du « Notre Père » était moins heurtante que l’actuelle (sans être parfaite), puisqu’elle nous faisait dire : « Et ne nous laissez pas succomber à la tentation ». La même difficulté existant dans de nombreuses langues européennes, plusieurs onférences épiscopales ont entrepris de modifier la traduction du « Notre Père » en tenant compte du problème posé par la version actuelle. Espérons que les conférences épiscopales francophones feront un jour de même. Si nous traduisons correctement la sixième demande (« Garde nous de consentir à la tentation » !) alors tout s’éclaire. Dans la cinquième demande, nous avons prié le Père de nous remettre nos dettes passées. Dans la septième, nous allons lui demander de nous protéger, à l’avenir, du Tentateur. Dans la sixième, nous lui demandons logiquement, pour le présent, de nous préserver du péché en nous gardant de succomber à la tentation ». Les fêtes du mystère de la Nativité se sont clôturées ce samedi 4 janvier 2014 à l’église du Saint-Sacrement : trois cents fidèles y ont pris part à la messe solennelle de l’Epiphanie. Mozart lui-même était parmi eux, grâce à l’excellente interprétation de sa « Missa Brevis » par le chœur de Sainte-Julienne dirigé par Margaret Todd et accompagné à l’orgue par Patrick Wilwerth : une prestation alliant aussi un florilège de chants de noël et le propre grégorien du jour au service de l’esprit de la liturgie. Celle-ci était célébrée par les abbés Jean Schoonbroodt, Louis-Dominique Kegelin (diacre) et Claude Germeau (sous-diacre). Un merci amical s’adresse à eux comme aux servants de messe : Jacques, Ghislain, Raphaël et à tous les prestataires de l’église pour leur active contribution : les deux Luc, Emmanuel, Jacqueline , Anne-Marie, Alain et les autres…
Les fêtes du mystère de la Nativité se sont clôturées ce samedi 4 janvier 2014 à l’église du Saint-Sacrement : trois cents fidèles y ont pris part à la messe solennelle de l’Epiphanie. Mozart lui-même était parmi eux, grâce à l’excellente interprétation de sa « Missa Brevis » par le chœur de Sainte-Julienne dirigé par Margaret Todd et accompagné à l’orgue par Patrick Wilwerth : une prestation alliant aussi un florilège de chants de noël et le propre grégorien du jour au service de l’esprit de la liturgie. Celle-ci était célébrée par les abbés Jean Schoonbroodt, Louis-Dominique Kegelin (diacre) et Claude Germeau (sous-diacre). Un merci amical s’adresse à eux comme aux servants de messe : Jacques, Ghislain, Raphaël et à tous les prestataires de l’église pour leur active contribution : les deux Luc, Emmanuel, Jacqueline , Anne-Marie, Alain et les autres…