PAUL VAUTE: PLAIDOYER POUR LE VRAI *
in "Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle"
n° 111, été 2019

Paul Vaute est né à Mons en 1955. Doublement master en histoire et en communication de l’université de Liège, enseignant puis journaliste, il fut jusqu’il y a peu le chef d’édition de la Libre Belgique-Gazette de Liège.
de Liège, enseignant puis journaliste, il fut jusqu’il y a peu le chef d’édition de la Libre Belgique-Gazette de Liège.
Sous le titre « Plaidoyer pour le vrai. Un retour aux sources » il vient de publier, dans la collection « Religions et spiritualité » des éditions L’Harmattan, un essai remarqué au carrefour de la philosophie et de l’histoire.
Nous publions ci-dessous la première partie de la recension que l’abbé Marc-Antoine Dor, conseiller spirituel de note association et recteur de l’église du Saint-Sacrement à Liège, consacre à cet ouvrage.
LA CRISE DE LA VERITE
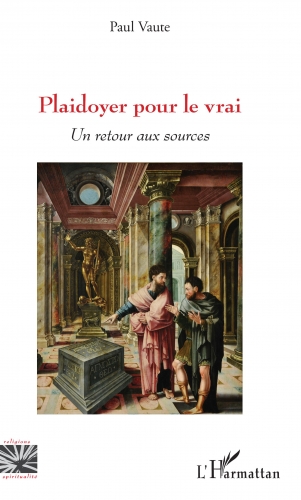
-I-
LA CRISE DE LA VERITE
Un constat : le discrédit de la notion de vérité
« Dans le monde industrialisé, le concept de vérité… suscite chez le plus grand nombre au mieux la méfiance, au pire le rejet sans appel. Qu’elle s’applique à l’éthique, à la politique, à l’économie, à l’art, à l’histoire, à l’actualité, à la théologie, voire à la science…, l’idée du vrai est malade de la culture occidentale » (p. 13).
Pour beaucoup de nos contemporains, « la vérité, c’est qu’il n’y a pas de vérité » (p. 13). Cette défiance actuelle vis-à-vis de la vérité s’est nourrie du développement des moyens d’information et de communication, de la révolte contre les ordres établis, de la crainte des fanatismes, de l’écroulement des idéologies politiques et du repli sur les seules solutions techniques.
Le scepticisme généralisé envers toute idée d’objectivité s’est paradoxalement accompagné d’une totale soumission aux impératifs de convenance politique, sociale et culturelle. Les droits de l’homme sont devenus « une véritable vulgate de notre temps » (p. 16). « Le scepticisme… cesse d’être une vertu pour devenir une sorte de perversion de l’esprit » (p. 17) quand il prétend rendre compte du climat, de l’euro, du compte en banque ou de l’état de santé.
Mais dès que nous abandonnons les aléas quotidiens pour réfléchir aux fondements supérieurs de la vie, toute idée de vérité est systématiquement disqualifiée.
Le propos : un plaidoyer pour le vrai
Convaincu de l’universalité du vrai, du beau et du bien, monsieur Paul Vaute entend « rendre leur place à ce qu’on n’ose plus appeler les fondamentaux » (p. 18), ces « données premières mises en lumière à l’aide des facultés de l’esprit humain » et véhiculées par le double héritage grec et judéo-chrétien.
Soutenu par de très nombreuses citations parfaitement référenciées, son livre constitue une « défense et illustration » de l’idée de vérité.
Dans cette quête, point de fanatisme ou de triomphalisme : « Nous ne possédons pas la vérité ; nous ne sommes qu’à son service, humblement et conscient qu’elle nous dépasse » (p. 19).
Loin de nuire à la liberté et à l’honnêteté de cette entreprise, la lumière de foi fait connaître le terme de la route sans que nous puissions « pleinement décrire ce qu’il recèle », même si nous savons qu’il est « la plénitude à laquelle nous aspirons » (p. 20).
La démarche : retrouver les racines de la faillite du vrai, proposer un discernement

Une première partie (« L’épreuve du temps », pp. 25-68) brosse à grands traits « l’émergence et l’évolution des grandes approches auxquelles a donné lieu la question du vrai ». Dans cette épopée, trois « grands phares » (p. 21) apportent à l’humanité une incomparable lumière : Jérusalem, Athènes et Rome. Mais les bases de la grande synthèse scolastique du XIIIe siècle s’ébranlent peu à peu sous le choc des crises du XIVe siècle, des ruptures de la Renaissance et la Réforme, ainsi que des Lumières du XVIIIe siècle.
Une deuxième partie (« L’ère du relativisme », pp. 69-153) éclaire la contestation de l’aptitude à discerner et affirmer le vrai et le faux avec certitude. Le doute heurte d’abord les données de la foi et de la morale, puis s’exerce contre toute activité de l’esprit, sans finalement épargner les sciences exactes.
Après avoir exposé les errements de la pensée et leurs conséquences (individualisme, collectivisme de l’opinion publique, idéalisme), la dernière partie (« Impasses et cheminements », pp. 155-317), recherche comment renouer avec l’ « adæquatio rei et intellectus ». Au service du vrai, les cheminements philosophiques et théologiques (raison et foi en une Révélation) peuvent concorder. Reste enfin à déterminer la place de l’idée de vérité dans une société pluraliste.
Pour faciliter la lecture de ce plaidoyer, essayons de dégager les principales articulations de son argumentation.
Recours à l’histoire
Comment comprendre l’actuelle allergie à toute idée de vérité ? L’histoire reste « maîtresse de vie »[1]. Il ne s’agit pas d’esquisser une caricature simpliste prétendant tout expliquer par une conjuration occulte et généralisée contre la vérité. Scruter l’expérience des Anciens et les découvertes des Modernes permet de transmettre aux prochaines générations une tradition fructifiée et vivifiante.
Sans nous borner aucunement à « l’argument de l’autorité indépassable des Anciens » (p. 22), nous devons tirer profit « du neuf et de l’ancien » (Mt 13, 52). En plein milieu du XIIe siècle, selon Jean de Salisbury, Bernard de Chartres déclarait : « Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu’eux, ce n’est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c’est parce que nous sommes élevés par eux »[2].
Au lieu d’en faire une succession d’avis contradictoires ou un jeu perpétuel de destruction des systèmes, n’est-ce pas cette façon de parcourir l’histoire des courants philosophiques que nous propose l’auteur ?
Une philosophie en quête de la vérité
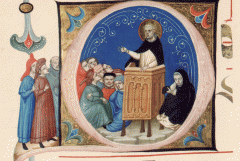
Parménide, Socrate et Platon font émerger et s’affiner le concept de vérité. Un, immuable et éternel, lié au bien et au beau, le vrai établit un rapport de conformité, basé sur les critères de l’exactitude de la représentation : c’est l’adéquation entre ce qui est dit et ce qui est. Face aux sophismes, le principe de non-contradiction établit qu’une même chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport.
Le réalisme intégral d’Aristote oriente les intelligences vers le réel et non plus vers les Idées platoniciennes. La recherche de la vérité passe par l’analyse de la réalité (déduction, classification, recherche des causes) ; dès lors le langage, par quoi la vérité est symbolisée et communiquée, dérive de la réalité qu’il signifie. Les notions d’acte et de puissance permettent de rendre compte de la permanence et du changement (auquel la philosophie d’Héraclite était si sensible).
L’Incarnation du Verbe oriente l’intelligence vers une disponibilité à la vérité qu’enseigne Jésus, qui se définit lui-même comme « Voie, Vérité et Vie » (Jn 14, 6). La notion de révélation divine renverse la conception d’un homme assurant lui-même son salut par sa seule connaissance (gnosticisme).
Pour un chrétien, l’impossibilité de renier les exigences de la foi n’aboutit pas nécessairement à une intolérance civile pratique. Ce fut d’ailleurs un adversaire acharné du christianisme, l’empereur Julien l’Apostat, qui chercha à imposer l’enseignement « des doctrines conformes à l’esprit public » (édit du 17 juin 362, pp. 41-42).
Aux XIIe et XIIIe siècles, la scolastique se met à l’école de l’argumentation « secundum Aristotelem et veritatem rei » (selon Aristote et la vérité de la chose réelle, p. 36) et récuse les théories d’une double vérité (une proposition vraie en philosophie et fausse en religion). D’ailleurs, « le christianisme n’est pas une religion du Livre, mais une religion de l’interprétation du Livre » (pp. 44-45). Chez saint Thomas d’Aquin, la raison est en adéquation au réel (« adæquatio rei et intellectus », p. 46) et s’accorde harmonieusement avec la foi.
Déconstruction de la philosophie médiévale
La dislocation de la synthèse thomiste commence bien avant l’ère des Lumières.
Dès le dernier quart du XIIIe siècle, le déchirement de la Chrétienté (malgré l’union réalisée au concile de Lyon II, en 1274, Latins et Byzantins vivent dans une séparation de plus en plus effective), l’échec des dernières croisades, les luttes continuelles de l’Empire et de la Papauté, l’émergence des Etats, l’anticléricalisme des légistes, le prestige du droit romain antique manifestent un malaise grandissant et compromettent la vision des grandes synthèses scolastiques.
L’essoufflement du réalisme se précipite au XIVe siècle, avec l’essor des nominalistes pour lesquels seuls le singulier et le sensible sont réels et premiers ; l’universel et l’intelligible sont alors perçus comme des productions artificielles de l’esprit. Conjointement avec un littéralisme biblique, l’unité de la théologie et des sciences est remise en cause. La foi et la raison semblent ne pas concorder, voire se dresser l’une contre l’autre. Les critiques contre l’interprétation thomasienne d’Aristote se multiplient.
La redécouverte des auteurs grecs et l’apparition de l’imprimerie, puis la Renaissance contribuent à relativiser l’héritage thomasien réaliste ; à la lecture thomasienne de la philosophie aristotélicienne sont substitués les courants néo-platoniciens. La théologie s’enferme dans le carcan nominaliste et la méfiance envers les capacités de la raison. Les différents courants de la Réforme remettent en cause l’autorité du Magistère et favorisent une libre interprétation de la Bible et des dogmes.
Le « Cogito » cartésien marque une nouvelle étape en faisant "table rase du passé" ; le sujet pensant devient à lui-même son seul sujet digne d’intérêt.
Se dressant contre la vérité éternelle et immuable, rejetant l’humble docilité au réel, les penseurs dès la fin du XVIIe siècle ne voient plus dans la raison une capacité de connaître rationnellement, mais désignent sous ce nom « une faculté critique dirigée contre les autorités religieuses et les pouvoirs politiques » (p. 58).
Les progrès des sciences exactes font découvrir un cosmos illimité qui heurte la conception ancienne d’un univers fini et hiérarchiquement ordonné.
La pensée se coupe du monde

Dès l’âge classique se multiplient les théories qui soumettent la vérité non plus au réel, aux données de l’expérience, mais aux critères des sciences mathématiques (Leibniz), aux axiomes (Spinoza), aux propriétés internes de l’idée.
Depuis Descartes, la pensée philosophique s’est concentrée sur la critériologie. Avant de se tourner vers le réel, c’est la pensée qu’il faut interroger ; finalement celle-ci ne peut être certaine que de son propre contenu.
« Les essences des choses, les principes fondamentaux de la logique, de la mathématique, de la morale et de la physique sont le résultat d’une institution arbitraire de la part de Dieu. A l’encontre de saint Thomas d’Aquin pour qui les vérités éternelles font partie de la vérité de Dieu, Descartes professe qu’elles sont créées » (p. 63). Le divorce de la science des vérités éternelles d’une part, de la vérité de Dieu et de l’ontologie d’autre part, est consacré.
Les philosophes du XVIIIe invoquent la Raison et le Progrès contre les supposés « obscurantismes ».
Sur ce terreau intellectuel germent l’idée de l’infaillibilité de la volonté générale, et la confiscation sartrienne par l’homme de la « liberté créatrice que Descartes a mise en Dieu » (p. 65).
Selon la belle formule d’Antoine de Saint-Exupéry, « les hommes ont fait l’essai des valeurs cartésiennes. Hors les sciences de la nature, ça ne leur a guère réussi » (p. 63).
Vers l’idéalisme absolu (p. 65)
Selon Kant, la réalité existante est inconnaissable. « Nul besoin de fondement théologique : l’homme seul atteint le vrai par sa seule sensibilité (réalisme empirique) et par les seules catégories de son entendement (idéalisme transcendantal) » (p. 65). « L’esprit impose ses lois universelles au réel » (p. 66).
Aux yeux de Fichte, « la réalité n’est plus seulement inconnaissable, elle est niée. Seul demeure le sujet pensant » (p. 66).
D’après Hegel, « seule demeure la pensée se développant selon ses exigences intérieures. La contradiction entre l’aspiration de l’homme à la vérité et l’impossibilité de progresser en ce sens sans rencontrer des désaccords (est) surmontée historiquement par la dialectique » (p. 66). L’éternité est en marche dans le devenir humain. « La vérité est en perpétuel développement » et se révèle dans le processus dialectique (thèse, antithèse, synthèse).
Ainsi tout pourrait devenir fonction du temps et de l’histoire : « La révélation historique laisse la place à une histoire révélatrice » (p. 67). Ce n’est plus Dieu, c’est l’Humanité qui est « capable d’instituer le Royaume ».
Les penseurs ont abandonné l’approche réaliste de la vérité.
(A suivre)
Abbé Marc-Antoine Dor
(*) Paul Vaute, Plaidoyer pour le vrai. Un retour aux sources, in 4°, br., 336 pp., 34€, Editions l’Harmattan, coll. « Religions et spiritualité », ISBN 978-2-343-16233-1, 20.12. 2018.
_______
[1] Selon l’expression célèbre de Cicéron (De Oratore, II, 36) : « Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ, magistra vitæ, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur ? » ; « L’histoire enfin, témoin des temps, lumière de la vérité, vie de la mémoire, maîtresse de vie, messagère du passé, quelle voix, sinon celle de l’orateur, peut la rendre immortelle ? »
[2] « Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur et extollimur magnitudine gigantea » (Jean de Salisbury, Metalogicus (1159), livre III, chapitre 4).
Dès avant 1123, Guillaume de Conches développait la même idée dans ses Gloses sur Priscien à propos des grammairiens récents plus perspicaces que leurs prédécesseurs : « Unde sumus quasi nanus aliquis humeris gigantis superpositus » (cf. Edouard Jeauneau, « Deux rédactions des Gloses de Guillaume de Conches sur Priscien », dans Recherches de théologie ancienne et médiévale 27 (1960), pp. 212-47).
-II-
L'ERE DU RELATIVISME:
SES MANIFESTATIONS POLYMORPHES
Dans la première partie de son Plaidoyer pour le vrai, monsieur Vaute avait brossé à grands traits l’apparition de la notion de vérité chez les Grecs, son affinement dans la chrétienté médiévale, puis la désaffection progressive à son égard de la part des philosophes, des « sages » et des intellectuels à partir du XIVe siècle.[1]
Une deuxième partie (« l’ère du relativisme ») s’attache à décrire les conséquences ultimes du refus de tout concept de vérité. Ayant recherché les racines historiques de ce rejet, notre auteur examine maintenant les fruits de cette désaffection mortifère.
L’héritage de l’Aufklärung (des Lumières)

Ce qui n’était qu’élucubrations philosophiques de certaines « élites » à l’époque de l’Aufklärung (des Lumières) est devenu la nourriture quotidienne de nos contemporains en Occident. « Le bien, le beau, le vrai seront minés, dénigrés, vilipendés, battus en brèche dans une interaction constante avec la transformation des mœurs, les propagandes politiques, littéraires et plus tard mass-médiatiques, la remise en question scientifique des critères de vérité et de réalité, sans omettre la perte de crédit des valeurs traditionnelles sous l’effet de leur trop fréquente instrumentalisation hypocrite par la société bourgeoise » (71).
Si la vérité n’est que conformité à un système scientifique, le monde doit être réorganisé sur la base de quelques principes : toutes les idéologies et totalitarismes des XIXe et XXe sont ici en germe.
Aujourd’hui « le credo politique, social, philosophique, religieux esthétique dominant du monde occidental, c’est de ne pas en avoir, hormis la vulgate démocratique et humanitaire convenue » (73). C’est le règne de l’anti-dogmatisme, l’extermination des certitudes, l’identification du bien et du vrai aux choix fluctuants de l’opinion publique.
L’élargissement des connaissances et la fascination des variétés des civilisations ont favorisé une relativité généralisée qui « frappe de suspicion toute idée d’une vérité transcendant les multiples formes historiques » (74).
Même chez les chrétiens, s’est glissée l’idée d’une nécessaire conversion au Progrès, à l’Evolution et aux attentes du Monde, sous prétexte d’ouverture d’esprit.
Pour nombre de philosophes actuels, la vérité n’est pas une adéquation de l’intelligence à la réalité, mais un instrument linguistique et purement logique, totalement déconnecté d’une réalité intelligible.
La vérité scientifique sur la sellette
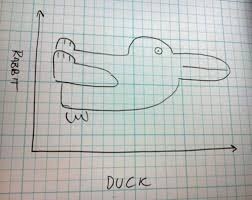
Finalement « la négation du vrai devait forcément se retourner, tôt ou tard, contre les disciplines qui l’avaient cultivée et promue » (81), les sciences humaines (sociologie, anthropologie…), puis les sciences de la nature, enfin les sciences exactes.
L’observation passe désormais pour être « une construction du sujet, et non d’abord la découverte de quelque chose qui serait là indépendamment du sujet observant » (82).
Les sciences expérimentales ne sont plus d’abord confrontées aux faits, mais reposent sur des théories intellectuelles, qui ne sont pas « vraies », mais qui entendent provisoirement rendre compte des phénomènes observés jusque-là.
Il n’y a plus de vérités rendant compte de la réalité, il y a des systèmes d’interprétation et de lecture, a priori tous possibles.
La « vériphobie » triomphante

Puisque sont rejetées « les pierres d’angle » (Chantal Delsol), « le trio de tête des maîtres-penseurs du temps est aussi, selon l’expression de Paul Ricoeur, celui des maîtres du soupçon » (88) : Marx, Nietzsche et Freud.
S’il n’y a plus de vérité objective, « tout est faux ! tout est permis ! » (Nietzsche, 90). Il n’y a plus ni enracinement ni ancrage ; la vérité est le devenir, « la marche, une marche sans chemin, sans sens, sans commencement, sans but » (90).
La théorie de la relativité générale est passée du champ des sciences physiques à tous les autres domaines. « Tout est relatif », entend-on aujourd’hui fréquemment. Les critères immuables du bien et du mal, du vrai et du faux, du beau et du laid ne seraient que des faits de culture dont les sciences sociales montreraient la relativité. En résultent la revendication du « droit à la différence » et l’égale légitimité de toutes les hiérarchies de normes.
L’exact et l’erroné n’importent plus : ce qui compte, c’est l’effet médiatique. On accuse la vérité de complicité avec les intérêts et l’autorité d’un parti cherchant à asseoir son pouvoir. Toute autorité spirituelle ou temporelle est récusée, tout comme les idées de nature et de normalité (ou de folie). Ultimement ce serait le rejet « de tout ce qui peut faire sens, signification, affirmation » (96). « La liberté, l’authenticité, la créativité sont érigées comme autant de remparts contre les contraintes, les conventions, les traditions » (105). A la recherche de la vérité se sont substituées les critères d’utilité et de succès, le « vivre ensemble » comme support de l’édifice social, la recherche du plaisir, la conformité à l’esprit du temps, les émotions, les enquêtes sociologiques ou ethnologiques.
« Vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux » (Gn 3, 5) : telle fut la tentation primordiale de nos premiers parents. Ne se retrouve-t-elle pas dans l’idée que l’existence de Dieu fait obstacle au progrès et au règne de l’homme, qui devrait être « roi du monde et juge infaillible du bien et du mal » (112) ?
Mais quand est proclamée la mort de Dieu, la mort de l’homme n’est-elle pas en fait imminente ?[2] Refusant de recevoir sa nature, « l’homme qui s’idolâtre comme puissance ne s’aime pas comme sujet et s’acharne dès lors à se déconstruire » (114). « L’homme finit par s’auto-engloutir et disparaître pour n’avoir pas pu s’ouvrir à autre chose que lui-même » (115).
Il suffit de rappeler que le XXe siècle est par excellence « le siècle des génocides, des épurations raciales et idéologiques, de l’avortement et de l’euthanasie de convenance personnelle ou sociale » (115), et des camps de la mort. Les tenants de la « deep ecology » ne voient-ils pas dans la présence de l’homme sur terre « un fléau dont elle appelle de ses vœux l’extinction par dénatalité » (116) ?
Capharnaüm dans l’Eglise

De nos jours, les chrétiens également sont mal à l’aise avec la notion de vérité. Selon le diagnostic porté en 1999 par le cardinal Ratzinger, la crise profonde du christianisme en Europe « repose sur la crise de sa prétention à la vérité » (118).
« La liberté tous azimuts et l’anti-doctrinarisme » (119) ont séduit bien des élites catholiques. Ainsi lit-on avec affliction un prêtre considérer que : « l’Eglise catholique est malade, gravement. C’est un cancer qui la ronge. Ce cancer, c’est le dogme » (119). Au lieu de chercher à perfectionner l’édifice thomiste là où ses limites se font sentir, on est passé « avec armes et bagages dans le camp du relativisme ambiant » (120).
D’aucuns se tournent alors vers le syncrétisme, d’autres se rallient aux oracles des enquêtes sociologiques, d’autres encore restent plongés dans l’immanentisme (« tout phénomène de conscience est issu de l’homme en tant qu’homme », 120), qui fut père du modernisme condamné par saint Pie X.
« Les postulats sur lesquels repose notre civilisation étant réputés infaillibles, ce sont les données de la foi qui doivent se purger de tout ce qui les contredit » (127). Où sont le témoignage prophétique et le martyre s’il faut seulement se rallier aux modes dictées par le Monde ?
Paul Vaute n’oublie pas de relever les « aspects qu’on peut porter à l’actif du courant progressiste chrétien » (125) : une relation dynamique avec la vérité suprême, l’intérêt du dialogue pluri-convictionnel, une meilleure perception des limites du pouvoir spirituel, l’engagement social.
Mais il constate aussi les manifestations du relativisme chez les chrétiens : renonciation à l’idée de vérité et à sa prédication, dissociation de l’amour de Dieu et de sa vérité, tri des dogmes, incompréhension du rôle de l’Eglise, rejet du magistère au nom de la liberté du croyant, lecture dialectique opposant artificiellement (à l’encontre de Vatican II) dans l’Eglise le peuple de Dieu, la société organisée hiérarchiquement et le Corps mystique du Christ.
Désacralisation de la liturgie, dissociation de la vie religieuse et de la culture dans laquelle elle s’incarne, effondrement de la pratique religieuse, attrait des « contre-cultures » de mort, des sectes et des croyances de substitution (magie, superstitions, divinisation des stars, idolâtrie, etc.), déracinement des jeunes, montée de l’Islam, etc. : l’étouffement du christianisme en Occident n’apparaît-il pas inéluctable .
Ayant ainsi exposé les racines et les causes de la crise de la vérité (1ère partie), puis ses fruits ou manifestations polymorphes (2e partie), il nous reste à découvrir les jalons que l’auteur propose dans sa dernière partie pour discerner les remèdes[3].
(à suivre)
Abbé Marc-Antoine Dor,
recteur de l’église du Saint-Sacrement à Liège
[1] Voir Vérité et Espérance/Pâque nouvelle, n. 110, 1er trimestre 2019, pp. 8-11.
[2] « On entend beaucoup parler, aujourd’hui, des droits de l’homme. Dans de très nombreux pays, ils sont violés. Mais on ne parle pas des droits de Dieu. Et pourtant, droits de l’homme et droits de Dieu sont étroitement liés. Là où Dieu et sa loi ne sont pas respectés, l’homme non plus ne peut faire prévaloir ses droits. Nous l’avons constaté en toute clarté à la lumière du comportement des dirigeants nationaux-socialistes. Ils ne se souciaient pas de Dieu et persécutaient ses serviteurs ; et c’est ainsi qu’ils ont traité inhumainement les hommes à Dachau, aux portes de Munich, comme à Auschwitz, aux portes de mon ancienne résidence épiscopale de Cracovie. Aujourd’hui vaut encore ce principe : les droits de Dieu et les droits de l’homme sont respectés ensemble ou ils sont violés ensemble. Notre vie ne sera en bon ordre que si nos rapports avec Dieu sont en bon ordre » (saint Jean-Paul II, homélie à Munich le 3 mai 1987 pour la béatification de Rupert Mayer).
[3] Pour faciliter notre exposé, nous rattachons la dernière section (« Où en est la nuit ? », pp. 137-153) à la présentation des « impasses et cheminements » proposés par l’auteur.